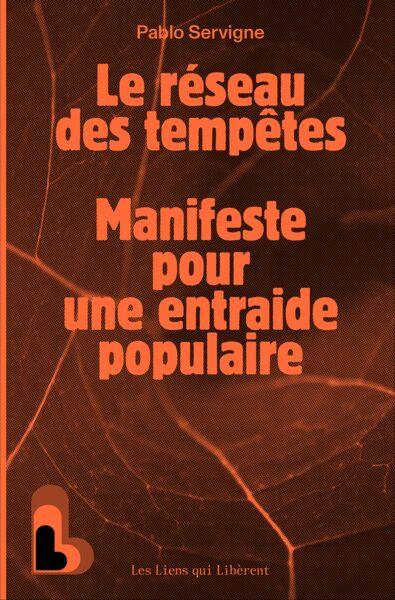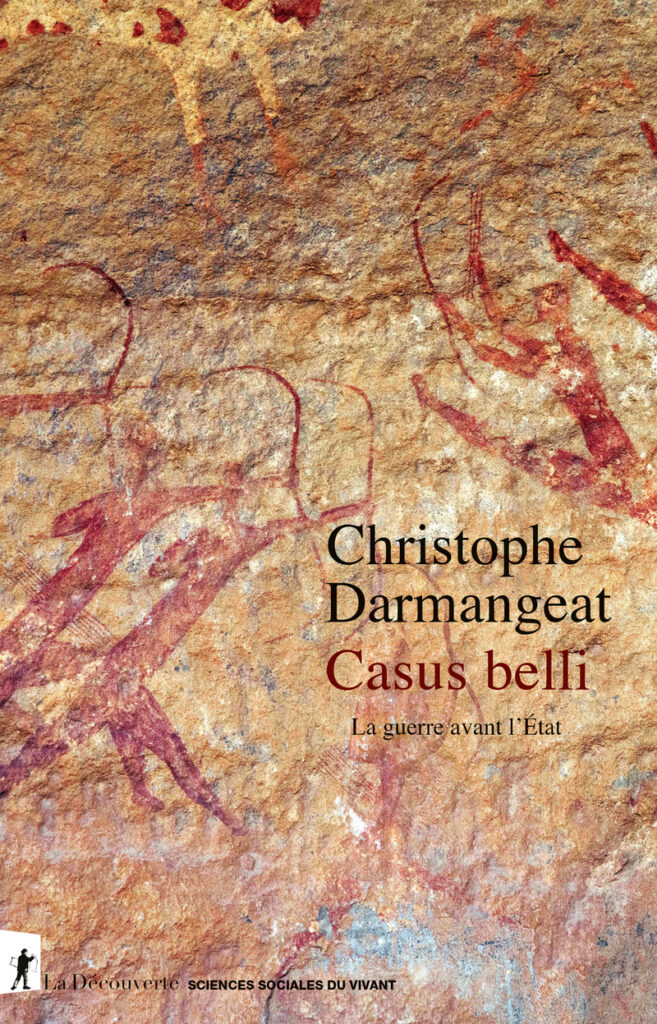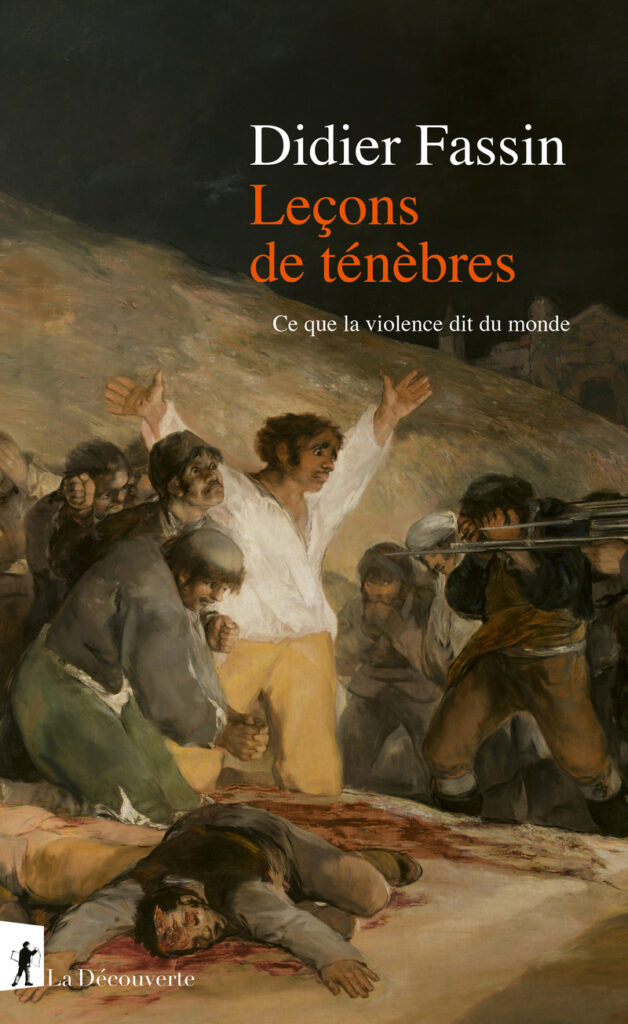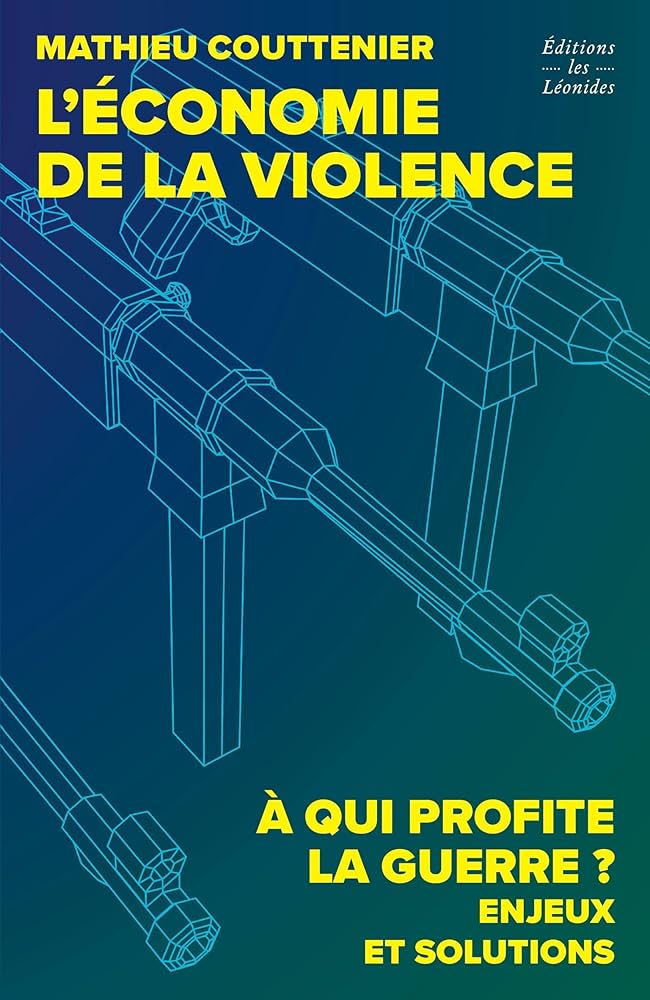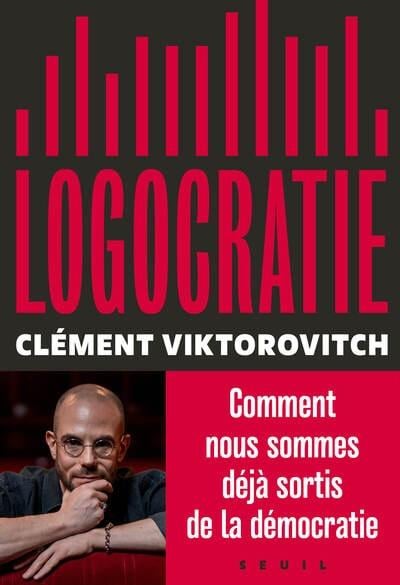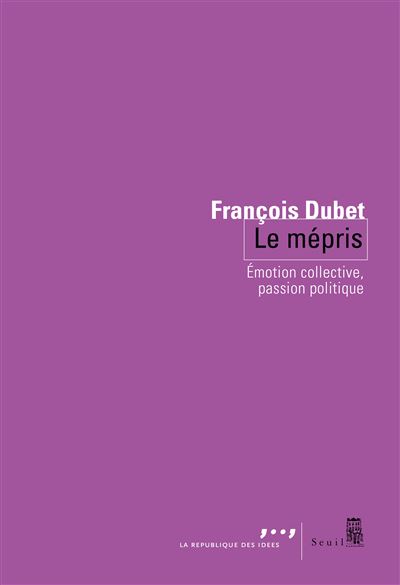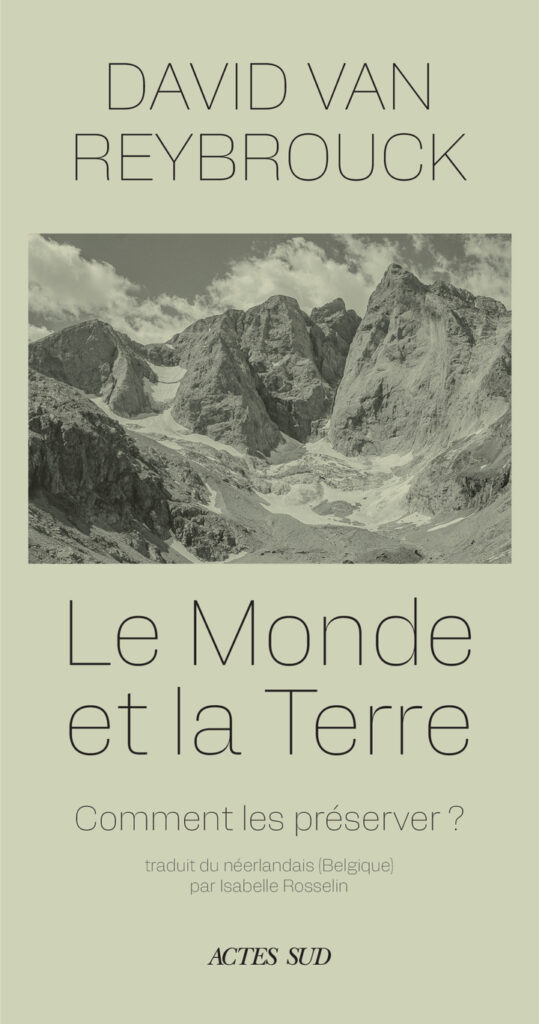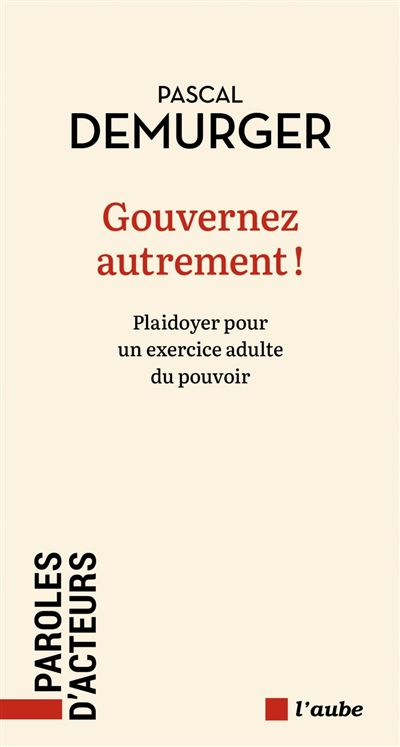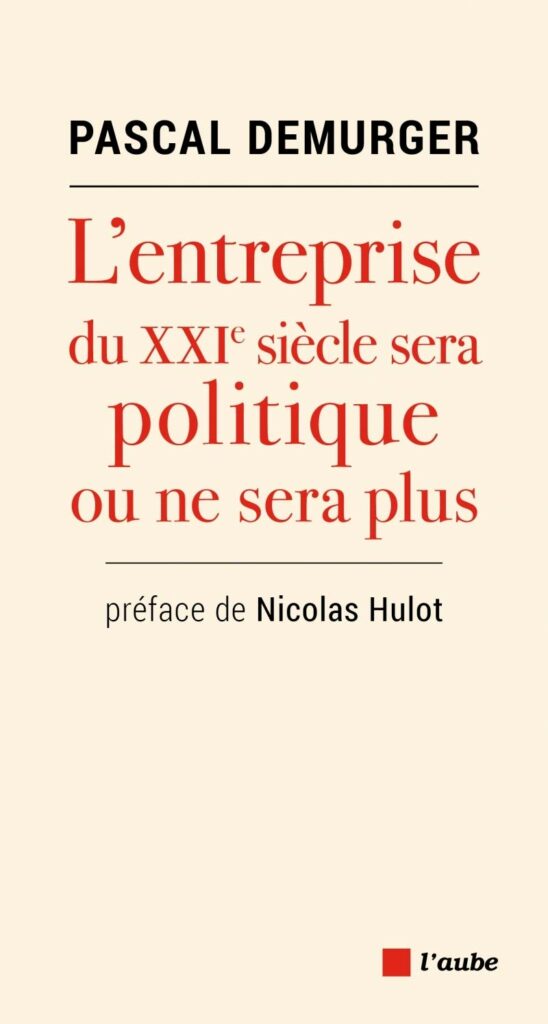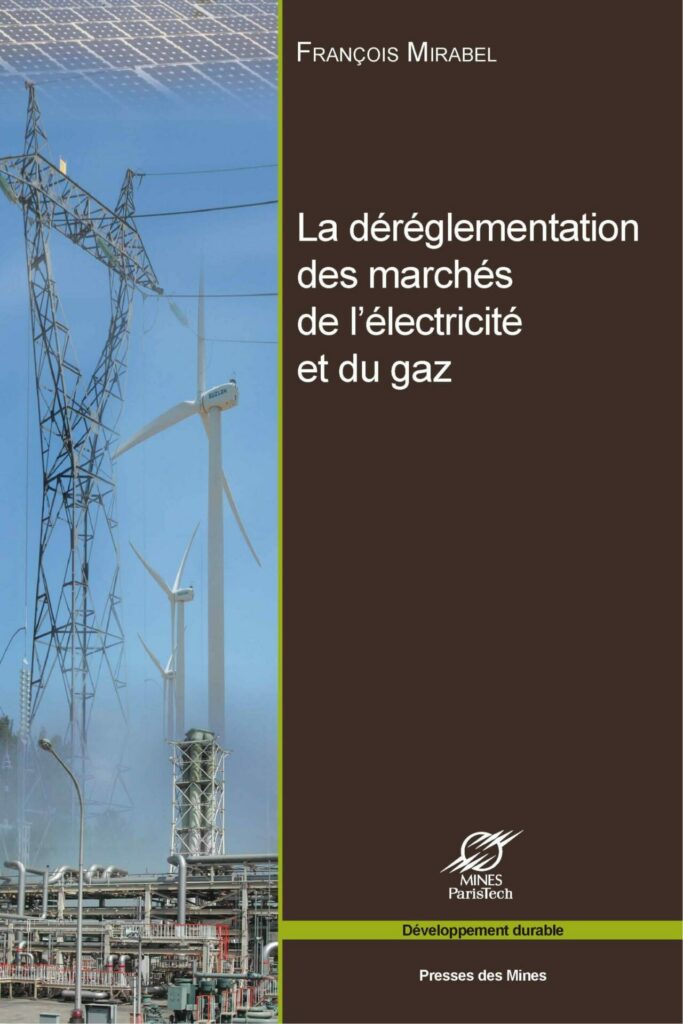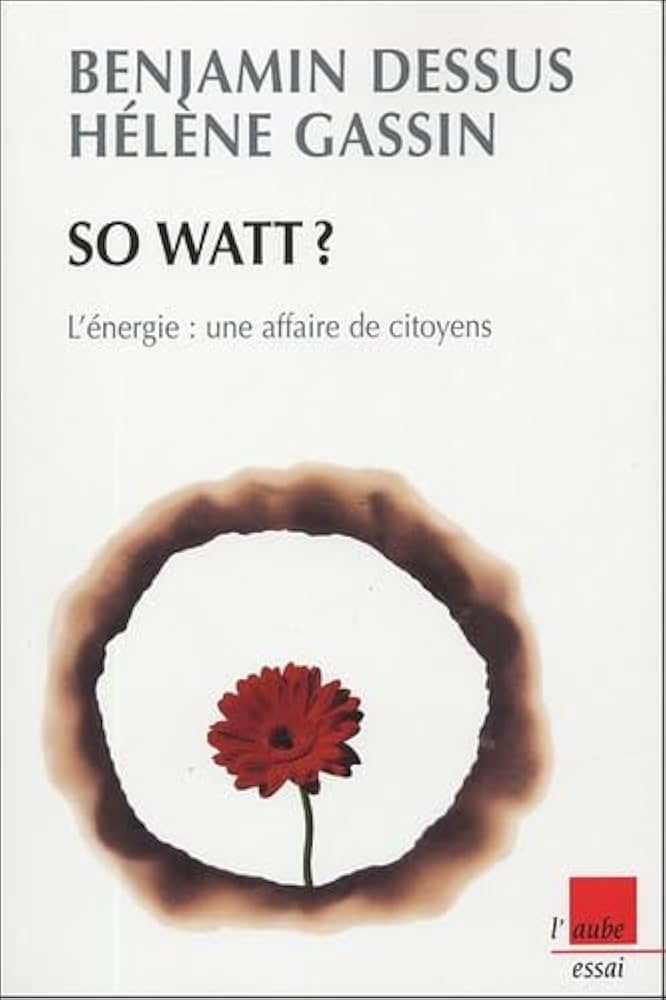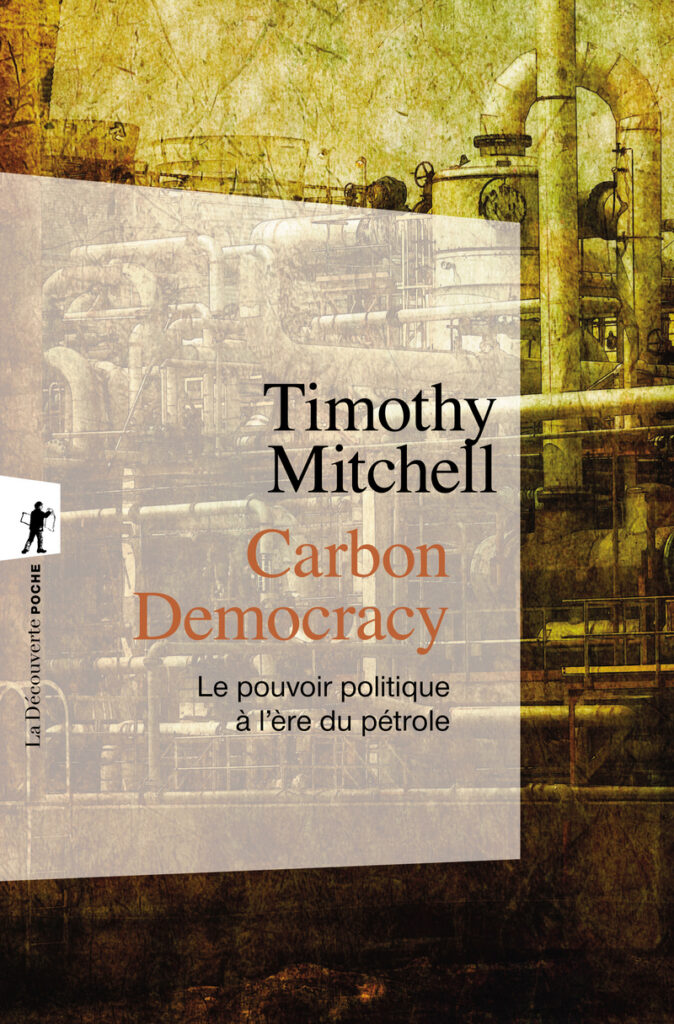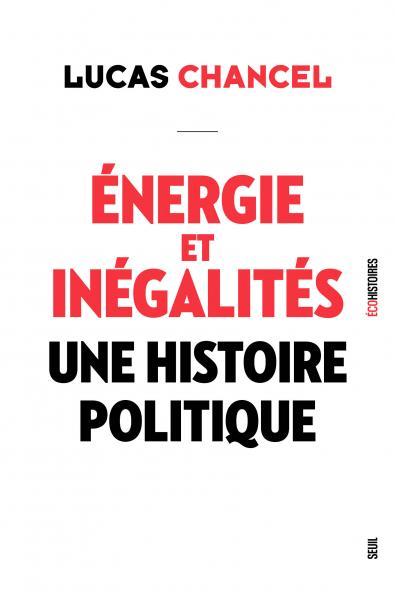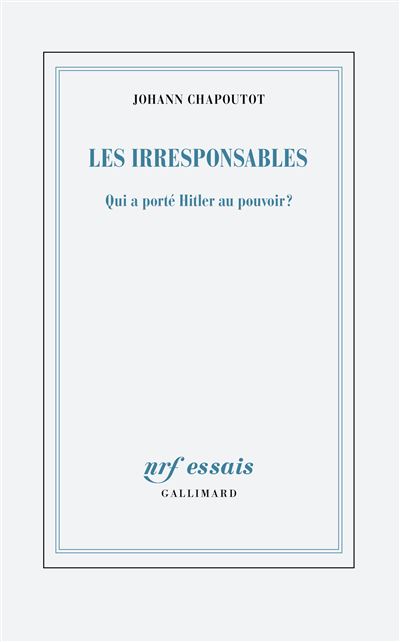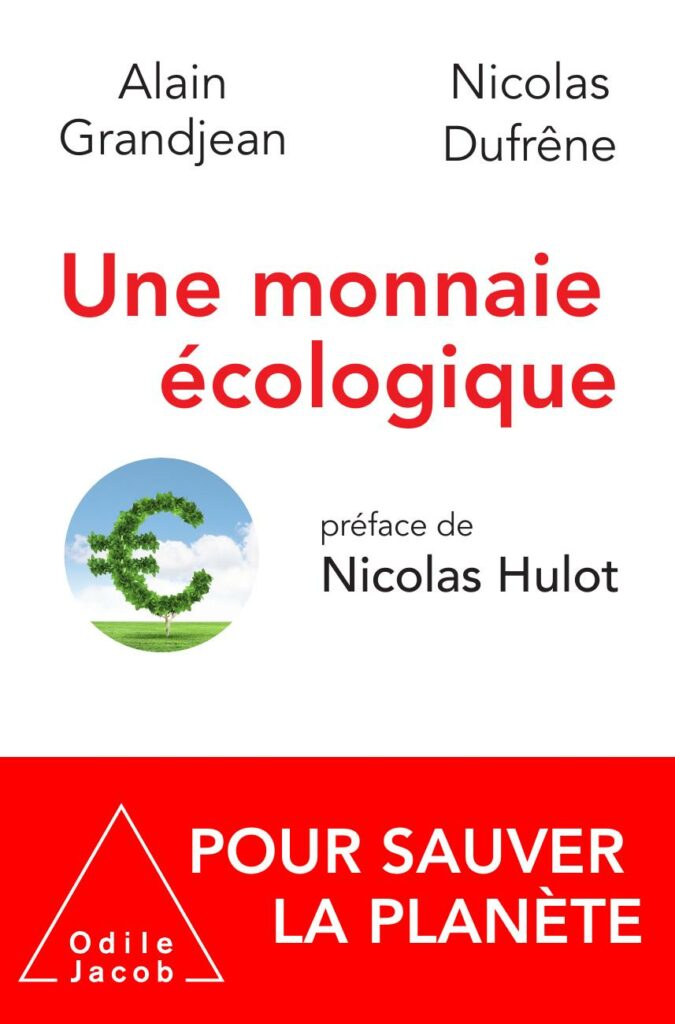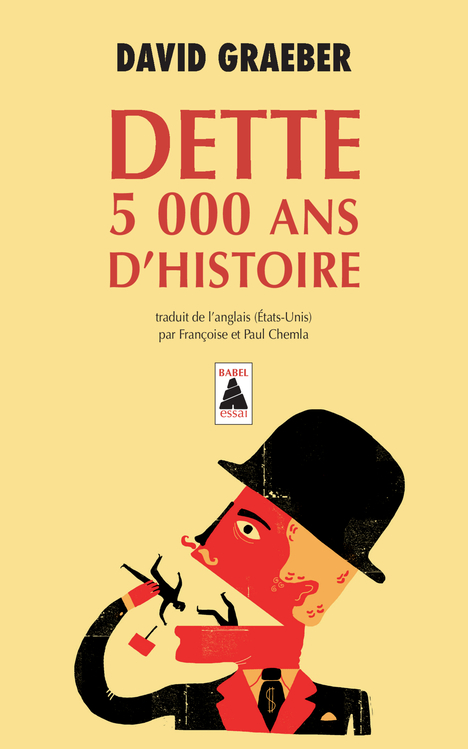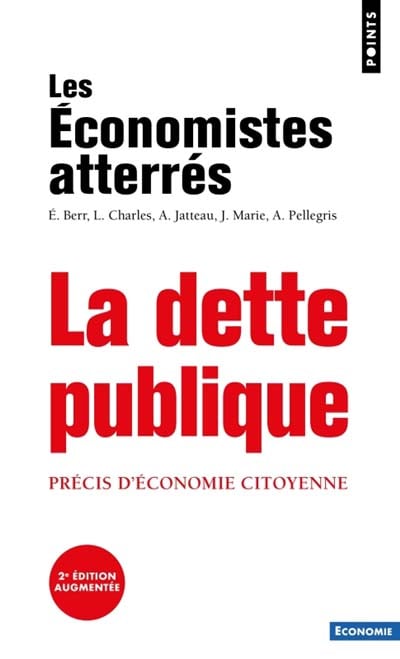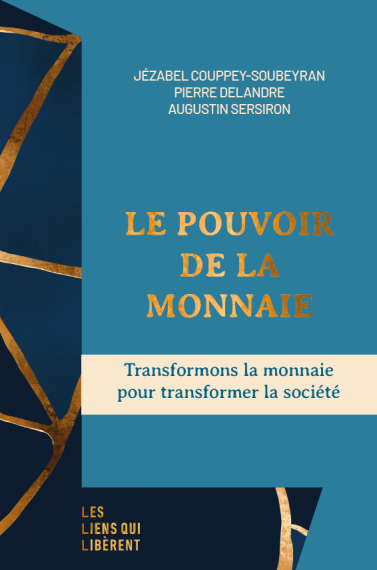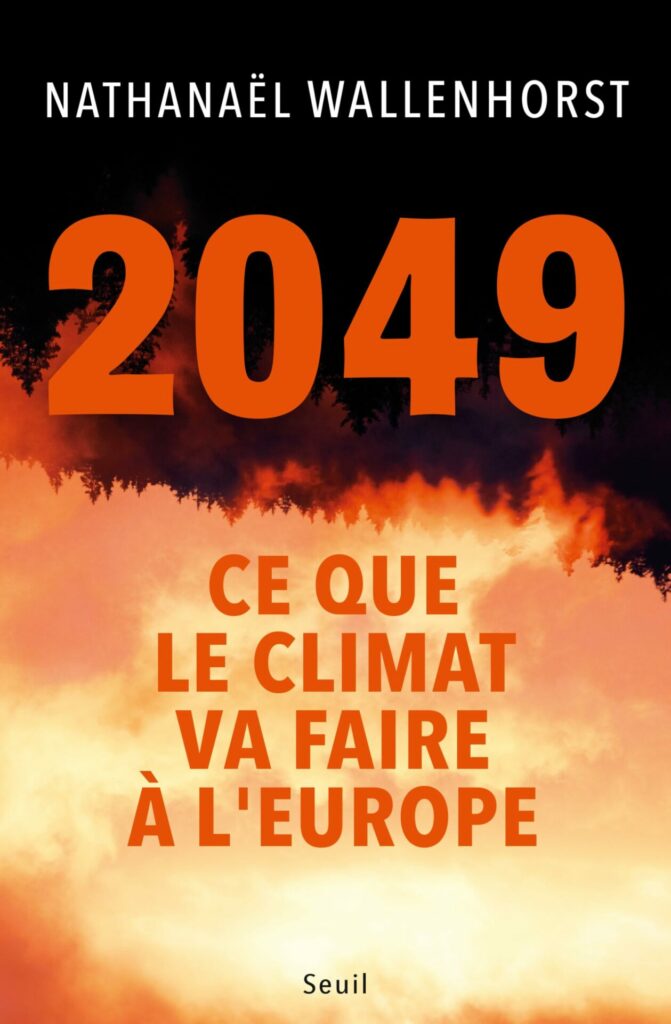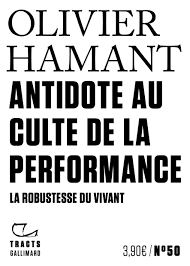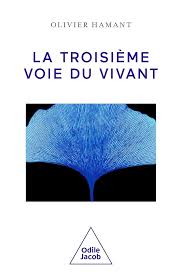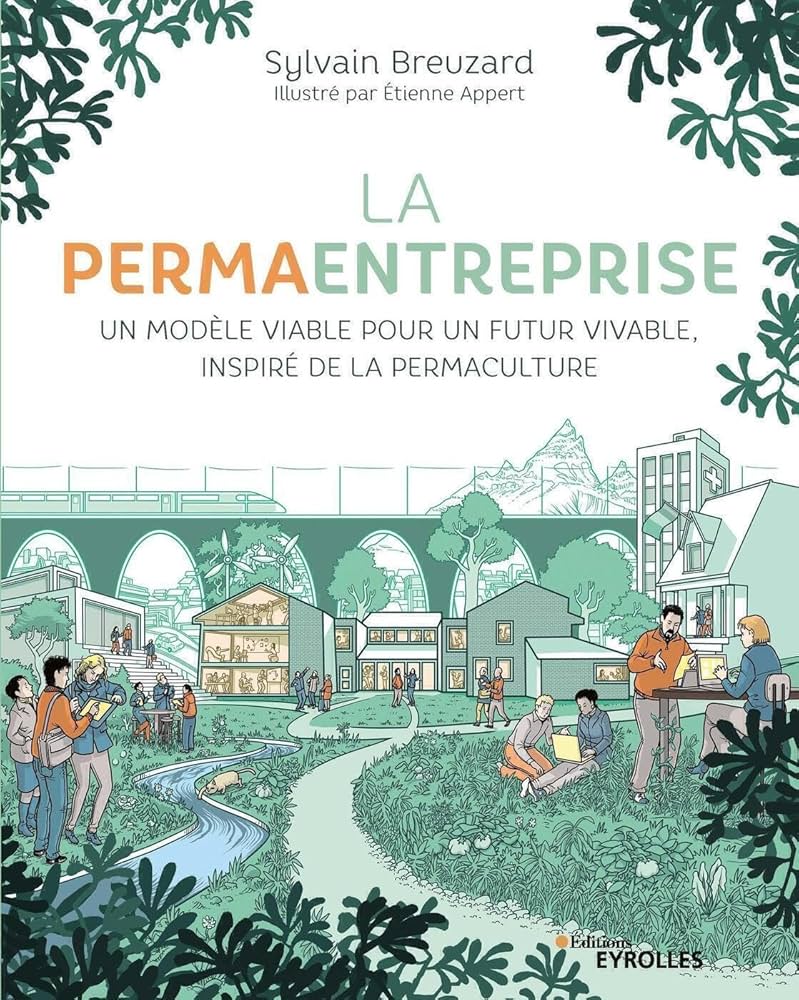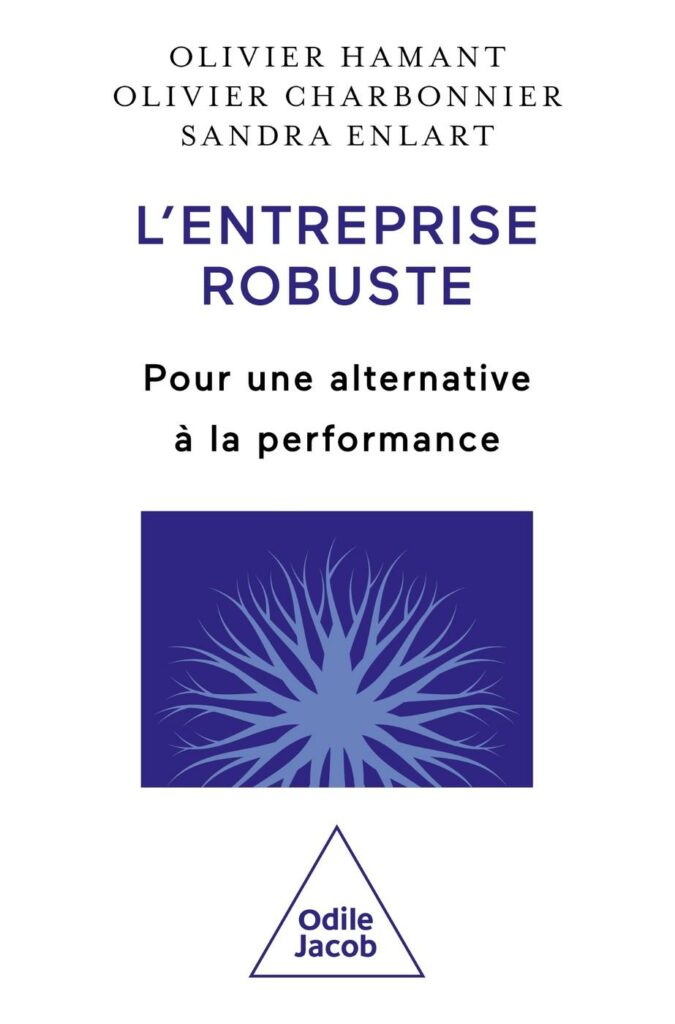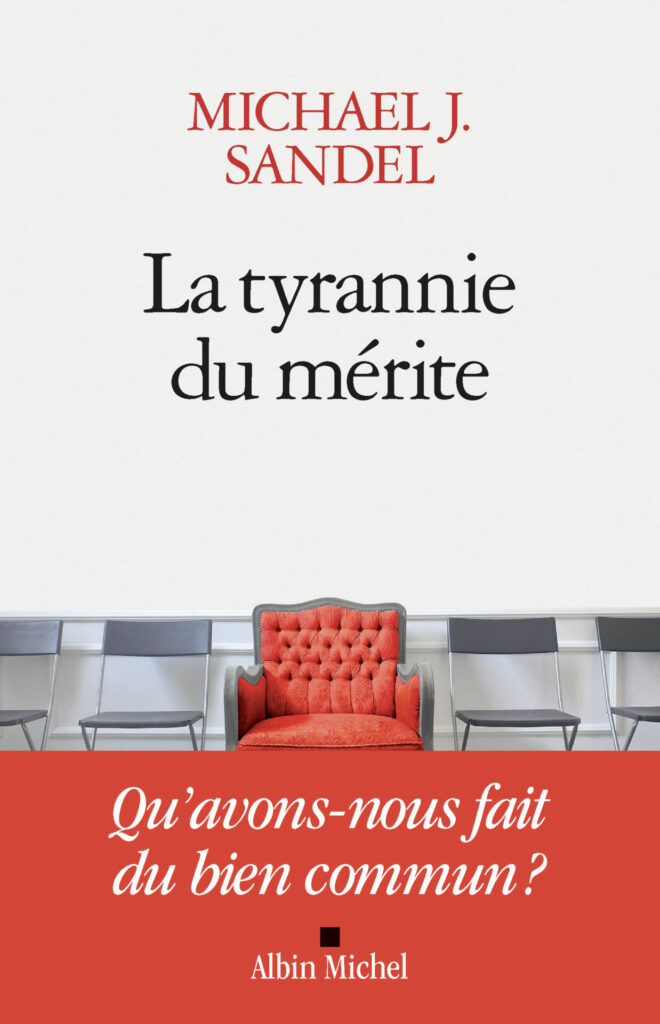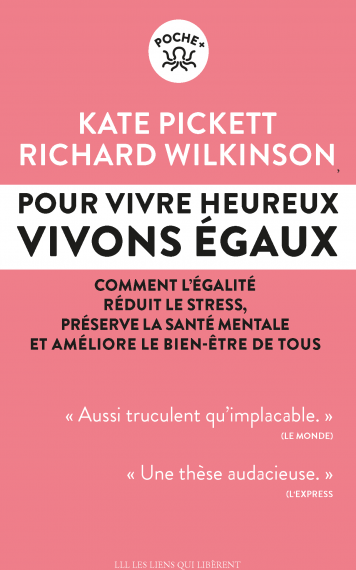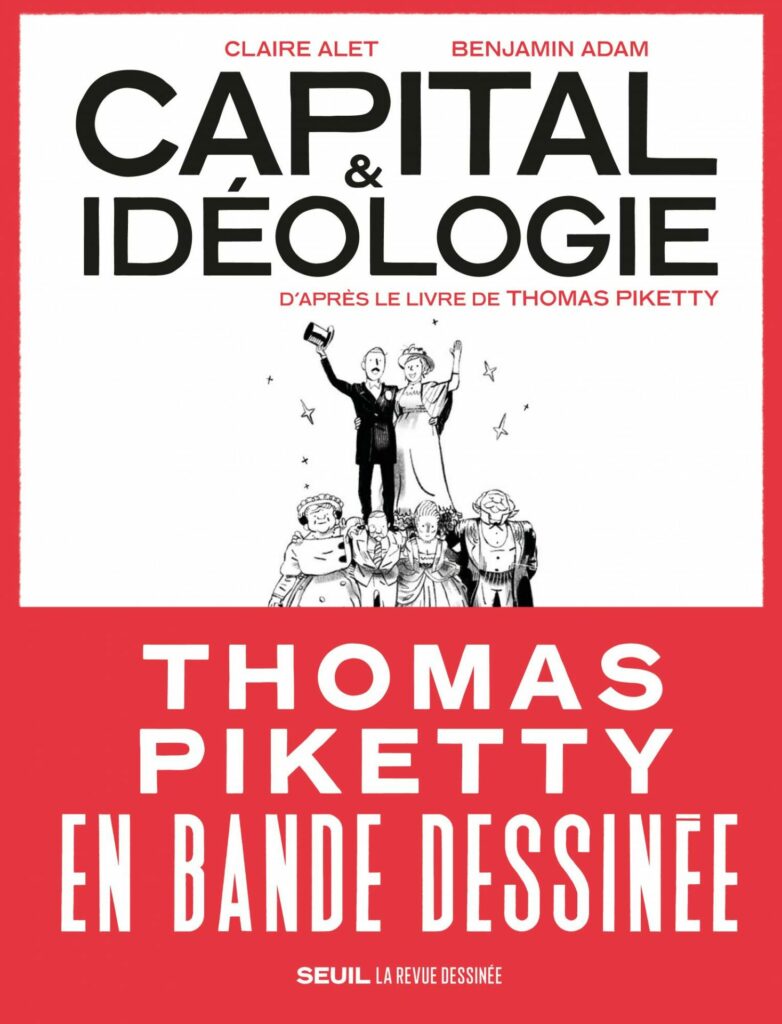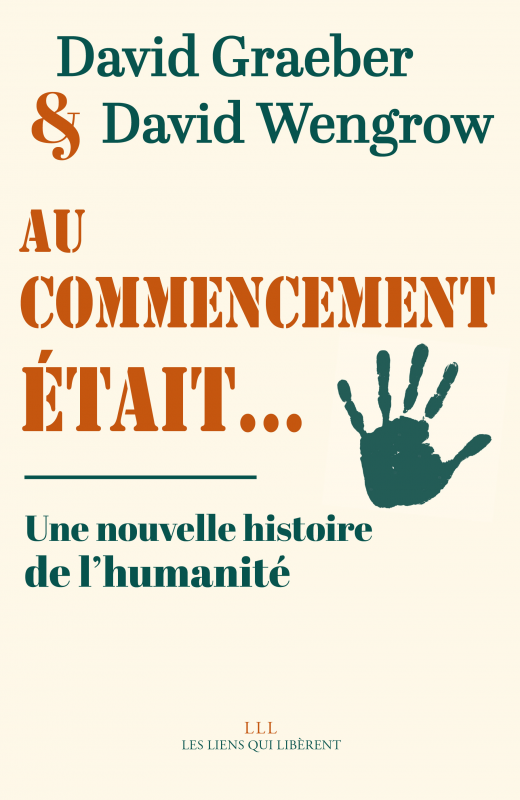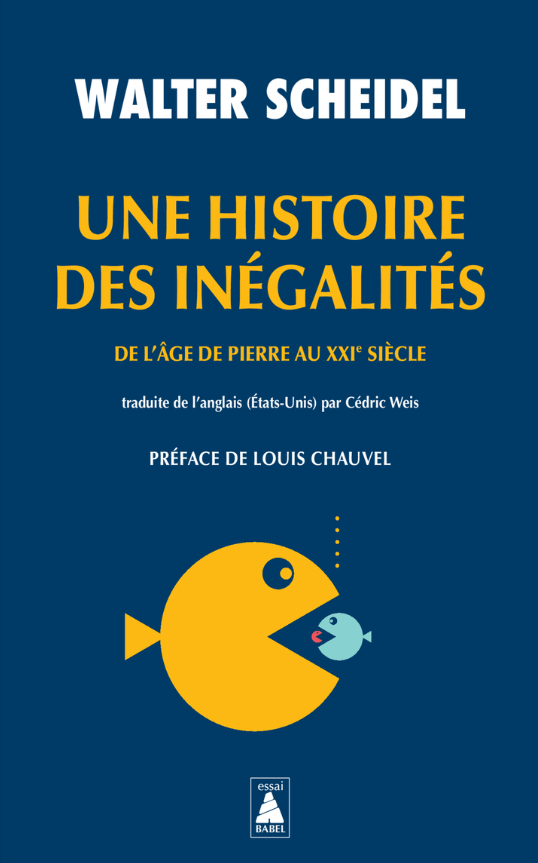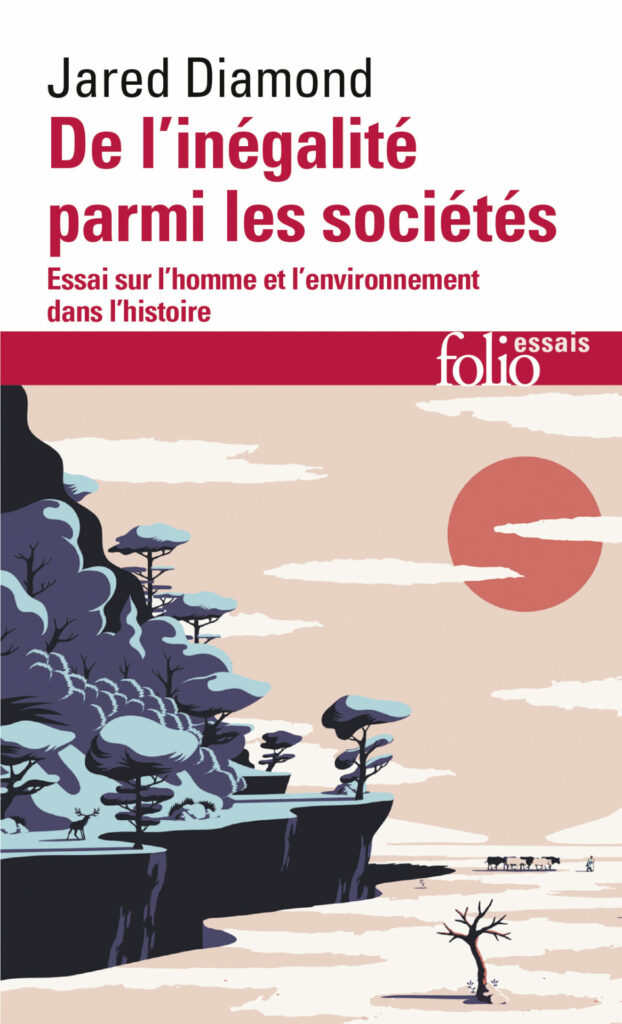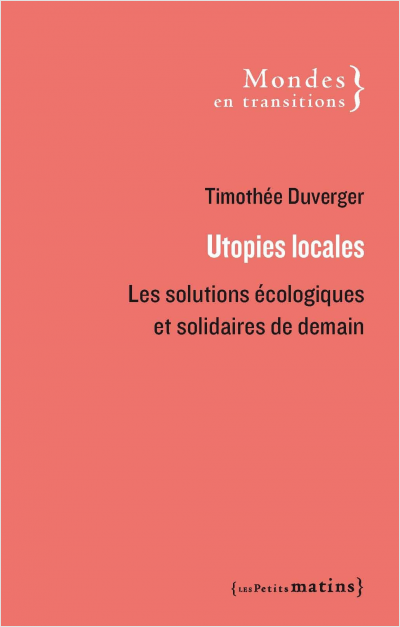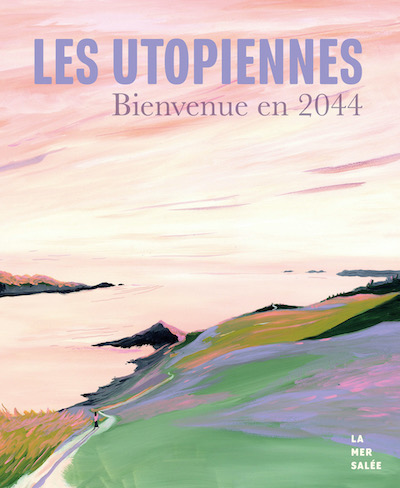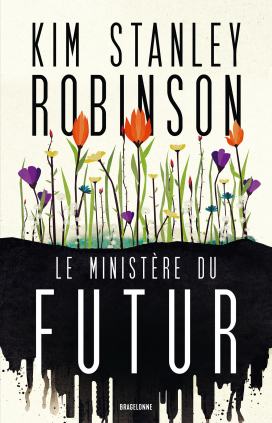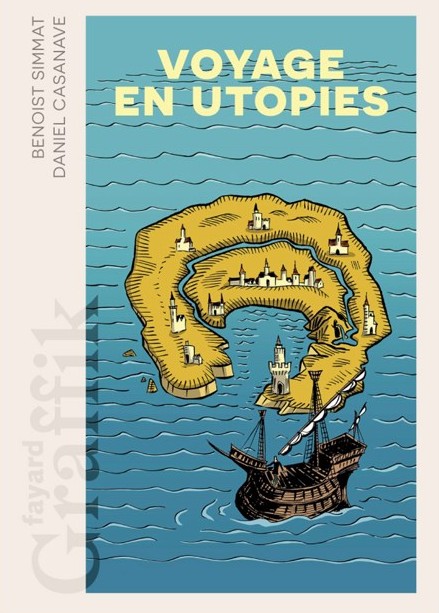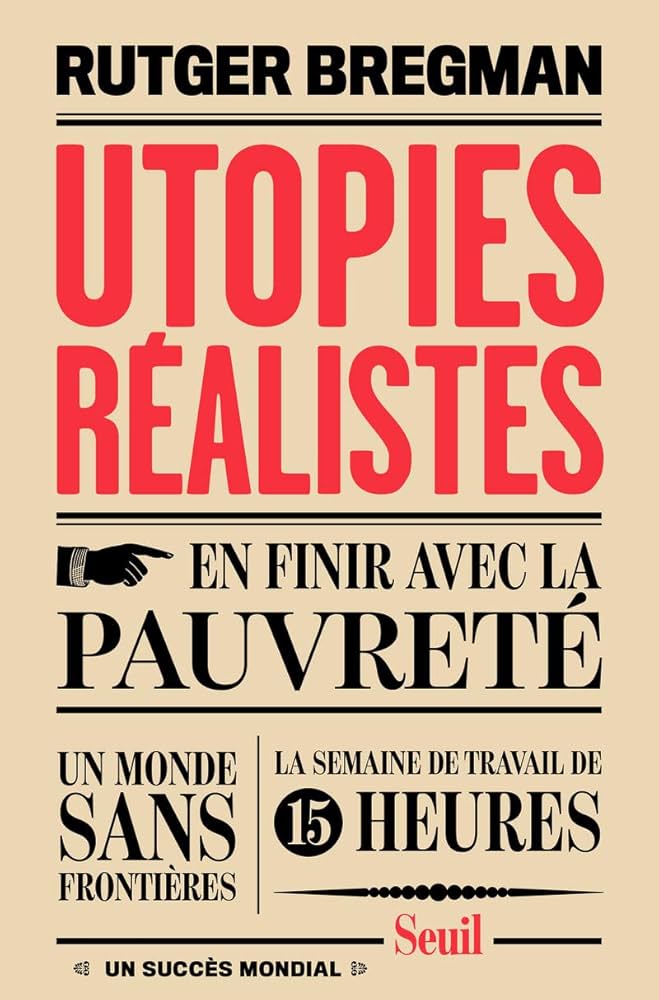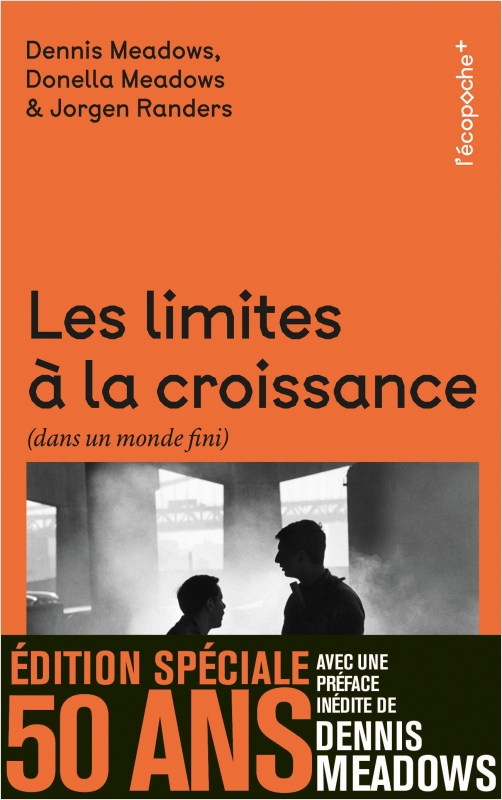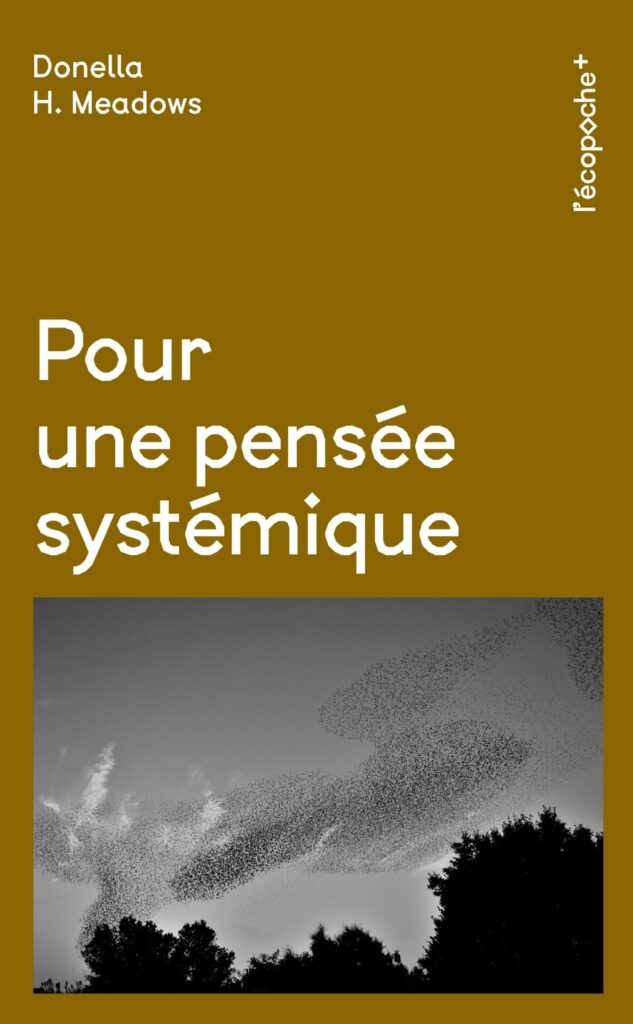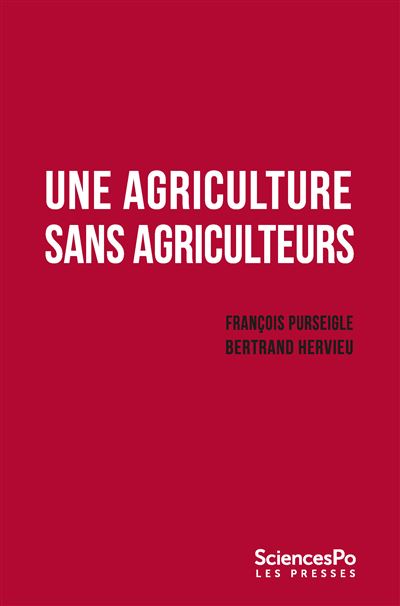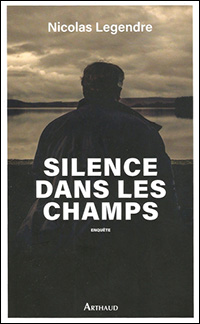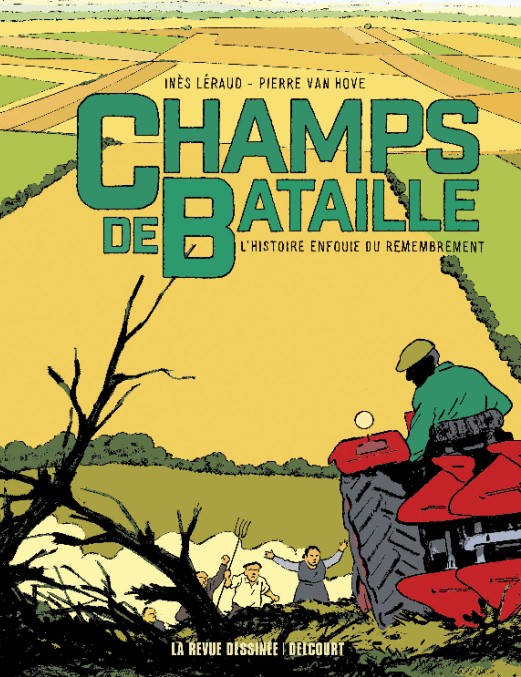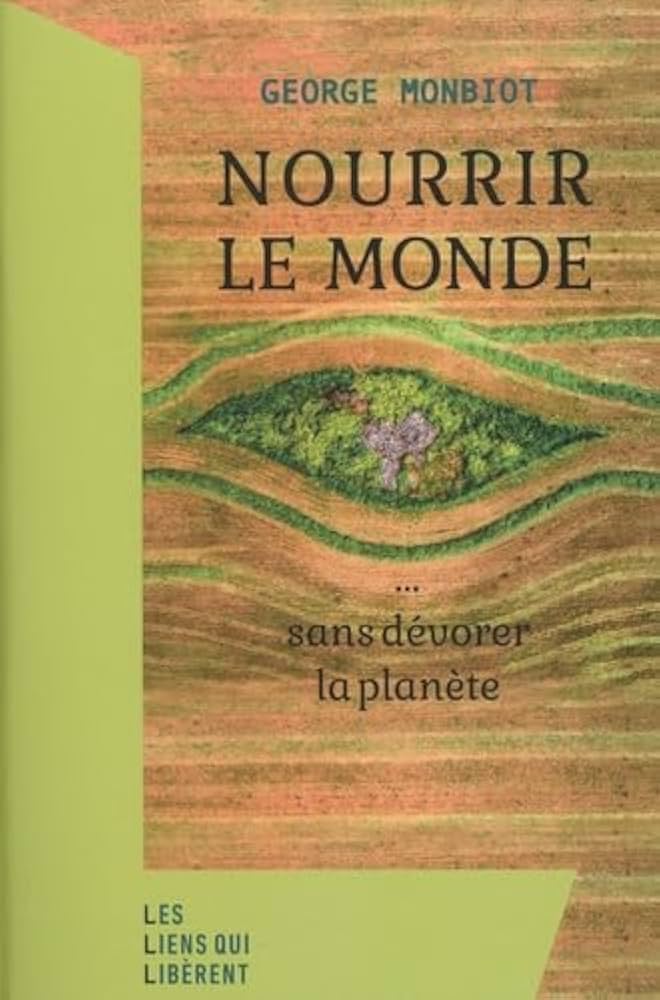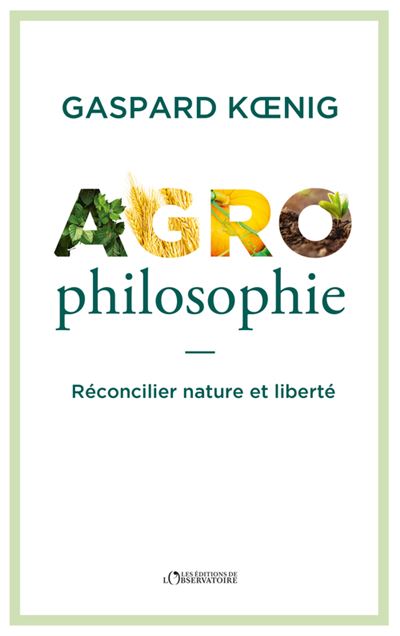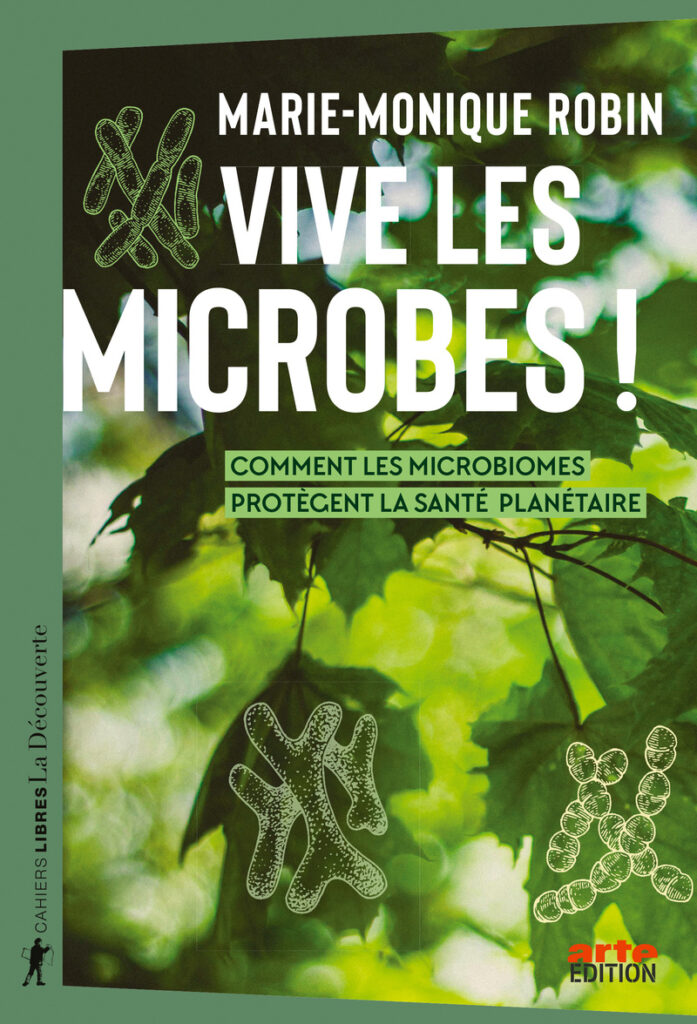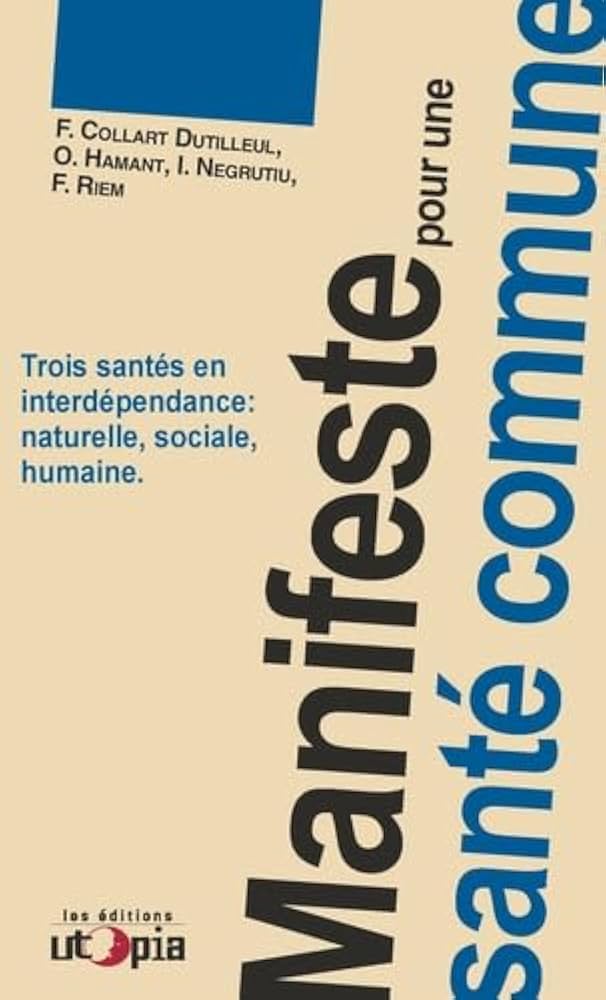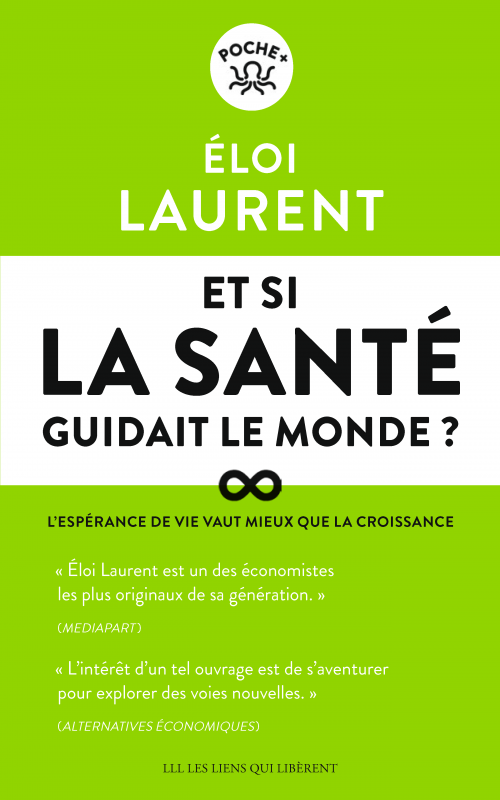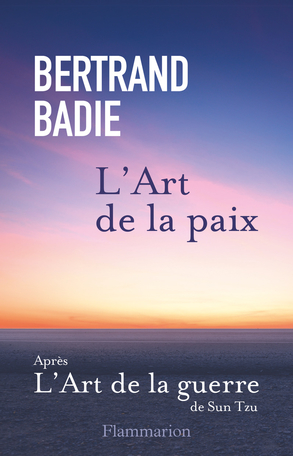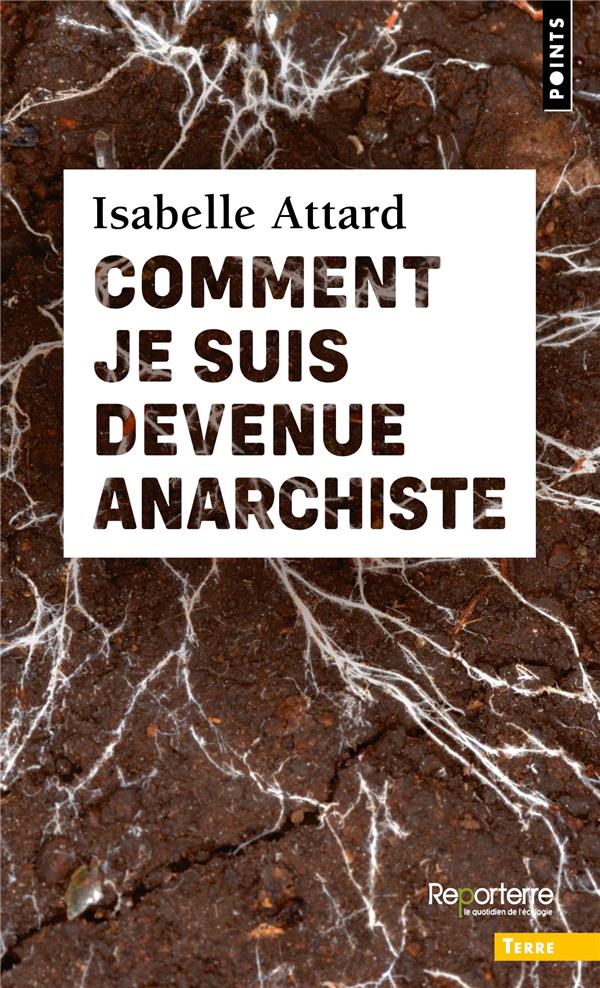Ce que le climat va faire à l’Europe
Nathanaël Wallenhorst, Éditions du Seuil, 2025
Le dérèglement climatique est un fait scientifiquement établi et des multitudes d’études scientifiques s’attachent à comprendre les effets de ce dérèglement sur les différents compartiments de notre vie quotidienne. S’appuyant sur toutes ces études, Nathanaël Wallenhorst s’emploie a traduire de la manière la plus pédagogique possible ce que ce dérèglement climatique signifierait pour la vie quotidienne des Européens si nous ne prenons pas collectivement des mesures fortes pour l’atténuer.
Pour cela, il se positionne dans le scenario du GIEC considéré comme le plus probable par la majorité des chercheurs, « la poursuite de ce que nous vivons, une pluralité politique et une attention disparate à la réduction de notre empreinte environnementale ». Autrement dit Business As Usual…
Le premier chapitre traite d’une notion difficile à appréhender pour nous qui avons l’expérience de la linéarité et de la continuité. Les « tipping points », ou point de basculement, ces moments où « s’engage un processus dont les conséquences sont non proportionnelles avec ce qui les a déclenchés ». Et pourtant beaucoup d’études scientifiques montrent que, dans certains cas, nous ne sommes pas loin de ces points de basculement : effondrement de la calotte glaciaire du Groenland, modification drastique des courants océaniques profonds, dégel du permafrost… « Le potentiel de destruction de ces tipping points du système terre aux quatre coins du monde est immense. Ils peuvent anéantir nos sociétés à la vitesse de l’éclair ».
Les chapitres suivants traitent chacun d’un aspect de l’impact du changement climatique sur notre vie quotidienne, avec chaque fois des exemples concrets pris dans l’actualité récente et une extrapolation de ce qui pourrait advenir en 2049 : chaleur mortelle, pénurie d’eau, disparition de la biodiversité, pollutions, faim, migrations et guerres. L’auteur consacré un chapitre à l’imprévisible, ces événement dont on ne peut prévoir l’arrivée. « Ce que nous savons de 2049 est que l’imprévisibilité sera au cœur de nos existences, fragilisant toute dynamique de projet ou de préparation de l’avenir .
Dans le dernier chapitre, Nathanaël Wallenhorst se penche sur la manière dont les économistes analysent l’impact économique du dérèglement climatique. Même si l’on exclut certaines publications « pétries de non sens », il n’en reste pas moins que globalement « Les prévisions concernant les dommages économiques du changement climatique sont bien plus optimistes que celles des scientifiques concernant les dommages causés à la biosphère. Comme si la population mène était préservée par rapport aux autres vivants ».
L’auteur conclut par un appel à regarder la situation en face et à agir. « 2049 est ce que je vois, chaque jour. 2049 est ce que chacun d’entre nous doit apprendre à voir. 2049 est là pour que nous l’évitions, qu’elle n’advienne jamais ».
En lisant cet ouvrage j’ai pensé à « Comment tout peut s’effondrer », l’ouvrage de Pablo Servigne et Raphaël Stevens paru il y a maintenant 10 ans. Nathanaël Wallenhorst actualise très bien la présentation faite à l’époque. En 10 ans les signaux faibles sont devenus des signaux presque forts : tout au long du livre de Nathanaël Wallenhorst, on trouve des exemples concrets très récents de chaleur mortelle, de pénurie d’eau, de pandémies, d’inondations, de méga incendies. Certes , ces exemples sont ponctuels, mais ils préfigurent bien ce qui arrivera de manière systémique en 2049.
Mais contrairement à Pablo Servigne et Raphaël Stevens qui proposaient une réflexion sur l’acceptabilité psychologique des données qu’ils présentaient, Nathanaël Wallenhorst se limite au constat. Et c’est là que je vois une limite à l’intérêt de cet ouvrage.
Pour les gens connaissant le sujet – et je suis dans ce cas – c’est une très belle actualisation avec des exemples récents et de nombreuses références scientifiques. Mais pour les gens qui ne sont pas familiers avec le sujet, le déversement brutal de toutes ces données scientifiques et techniques, plutôt angoissantes, peut être contre productif et susciter une réaction de rejet. Georges Marshall avait très bien expliqué en 2017 dans « Le syndrome de l’Autruche », pourquoi notre cerveau veut ignorer le changement climatique. Je crains qu’un tel ouvrage ne permette pas de passer la barrière du déni qui est la réaction première d’une frange encore importante de la population.