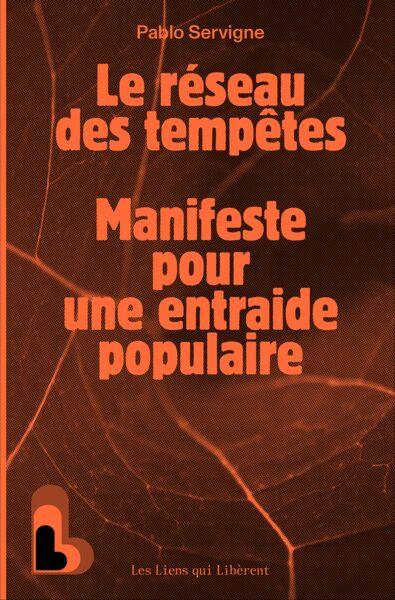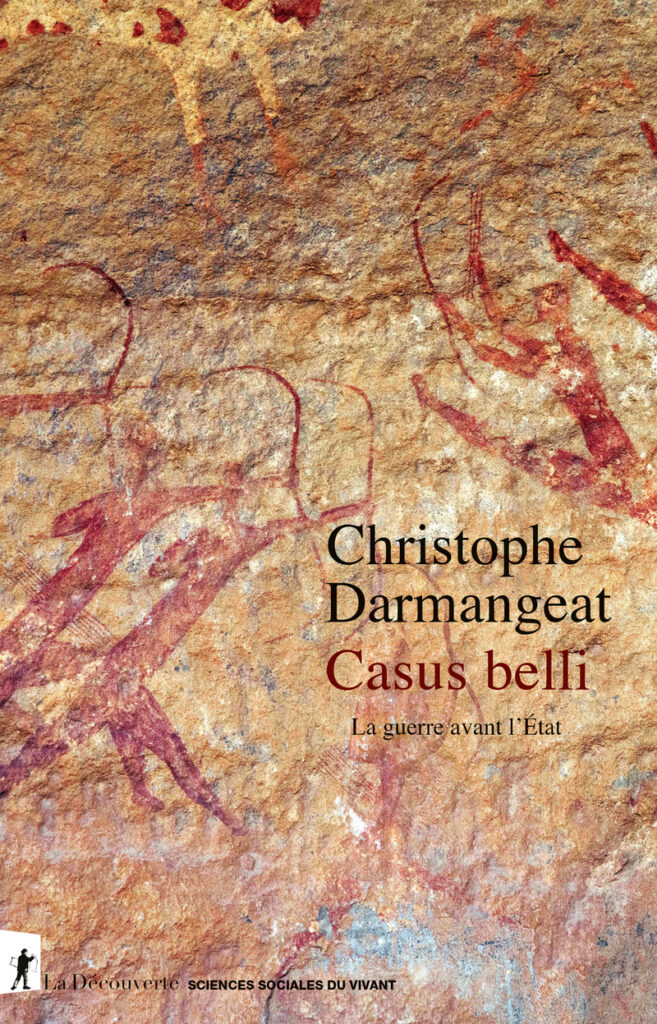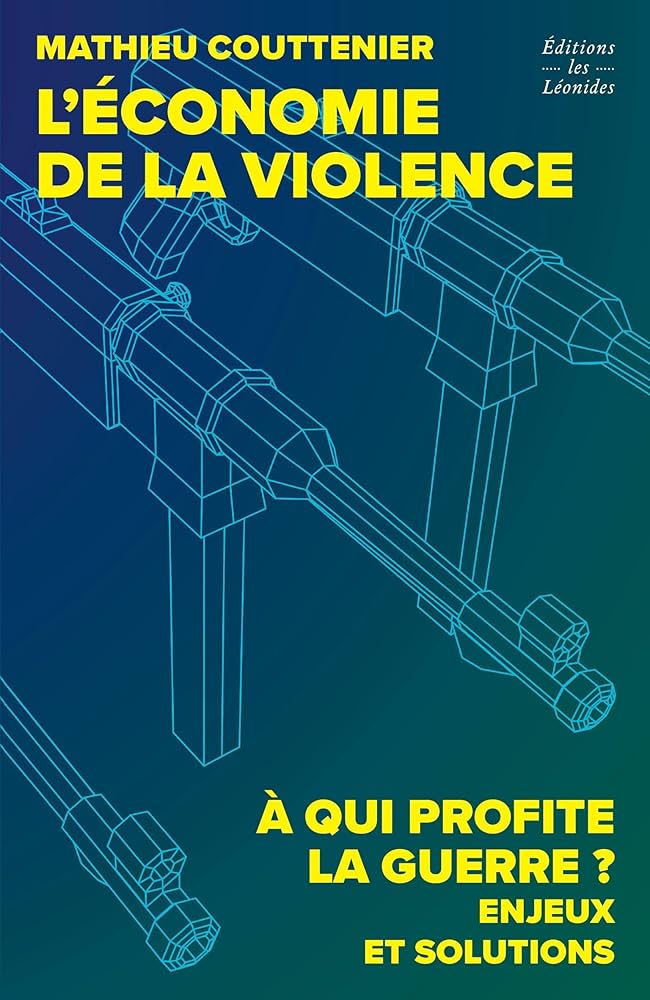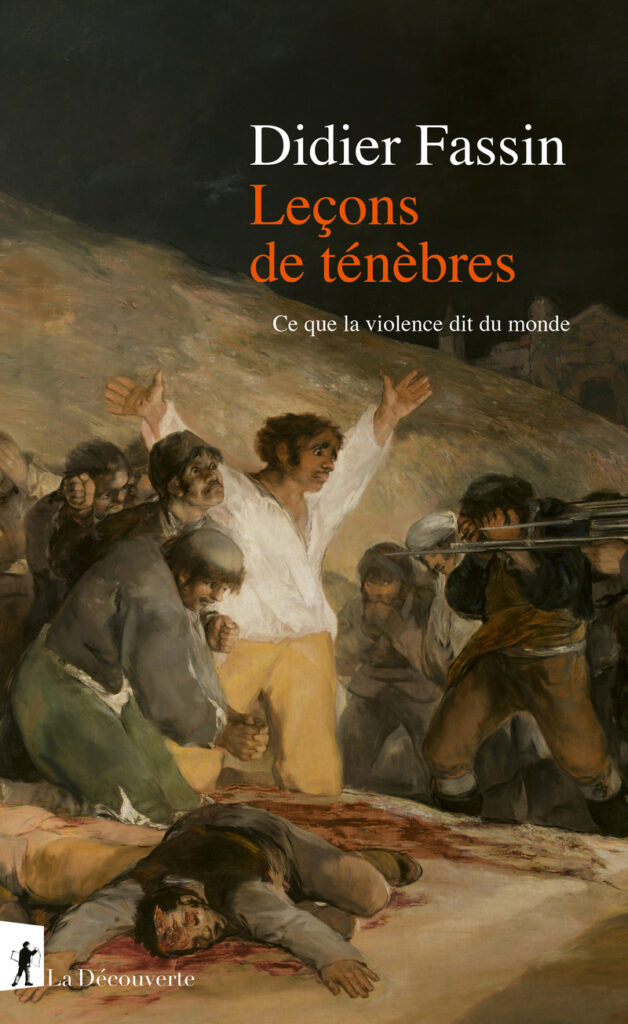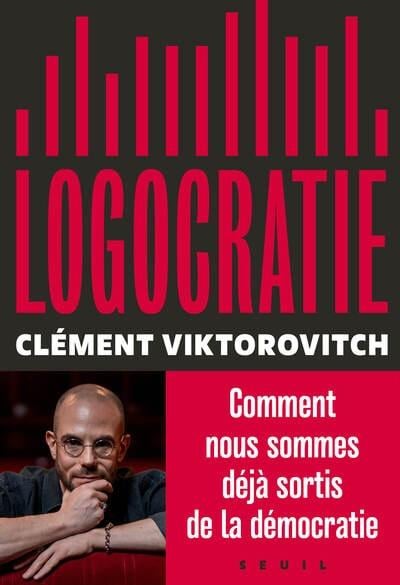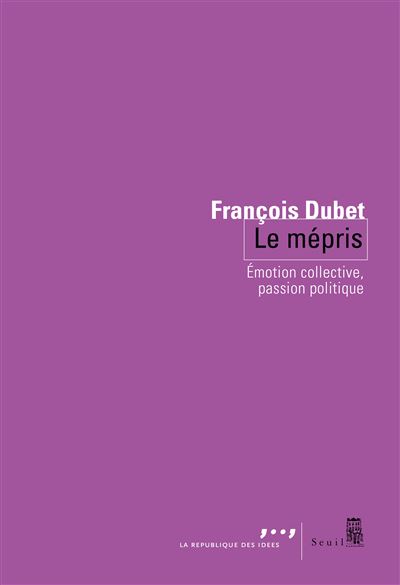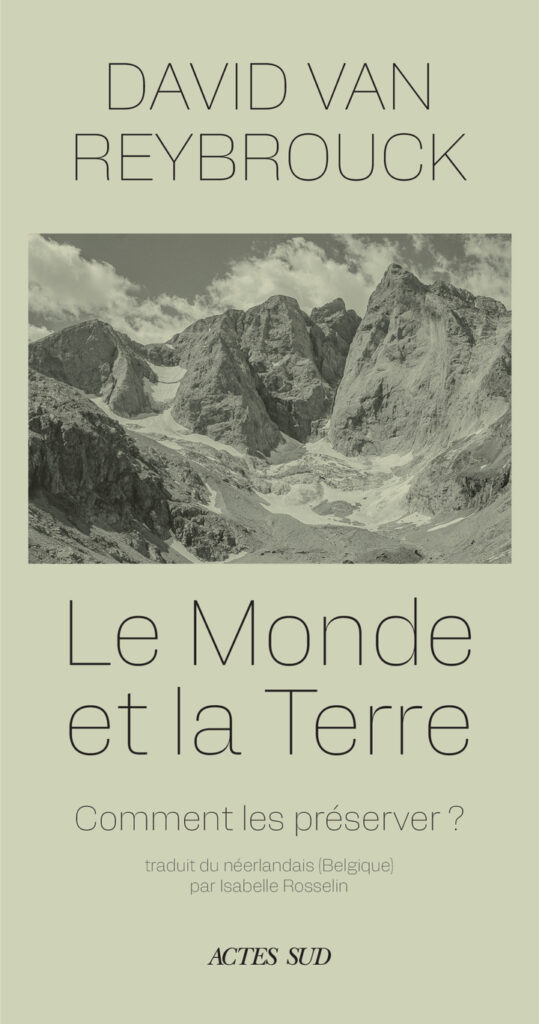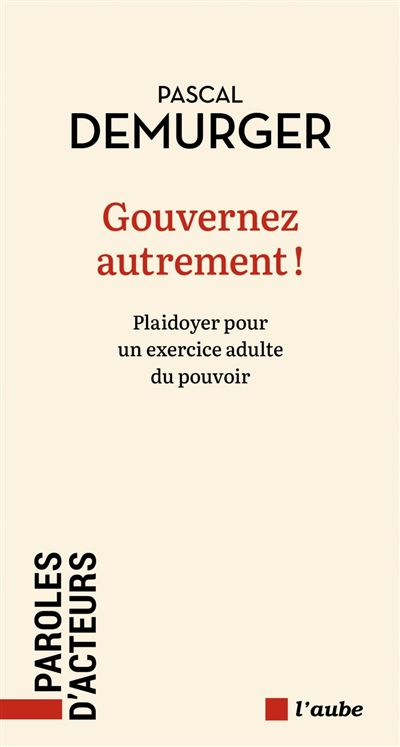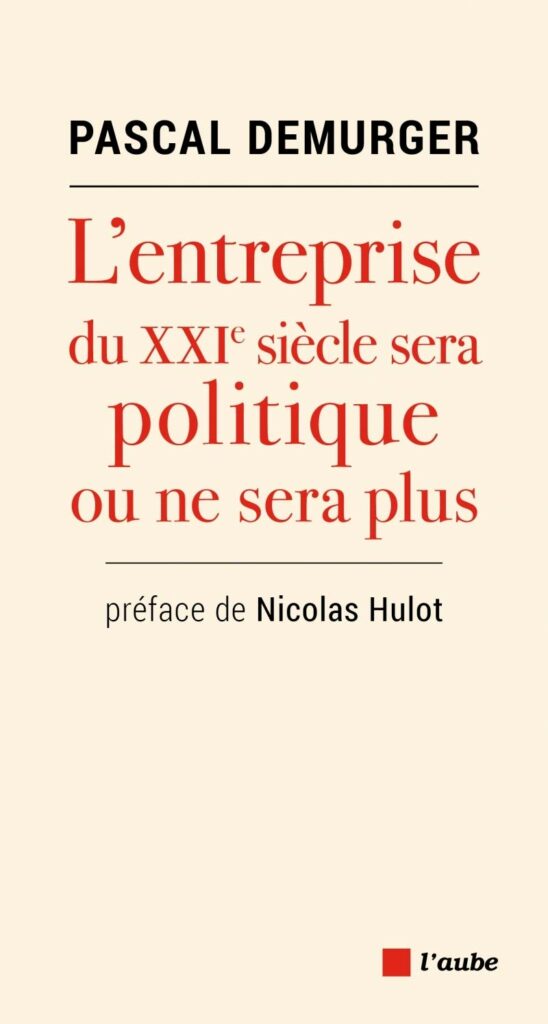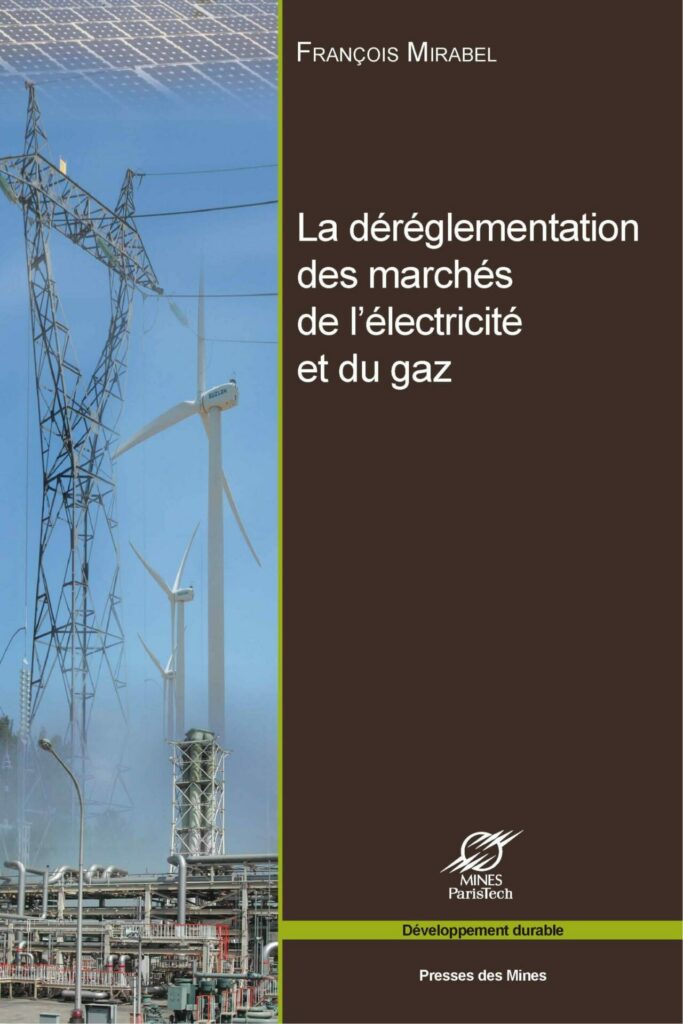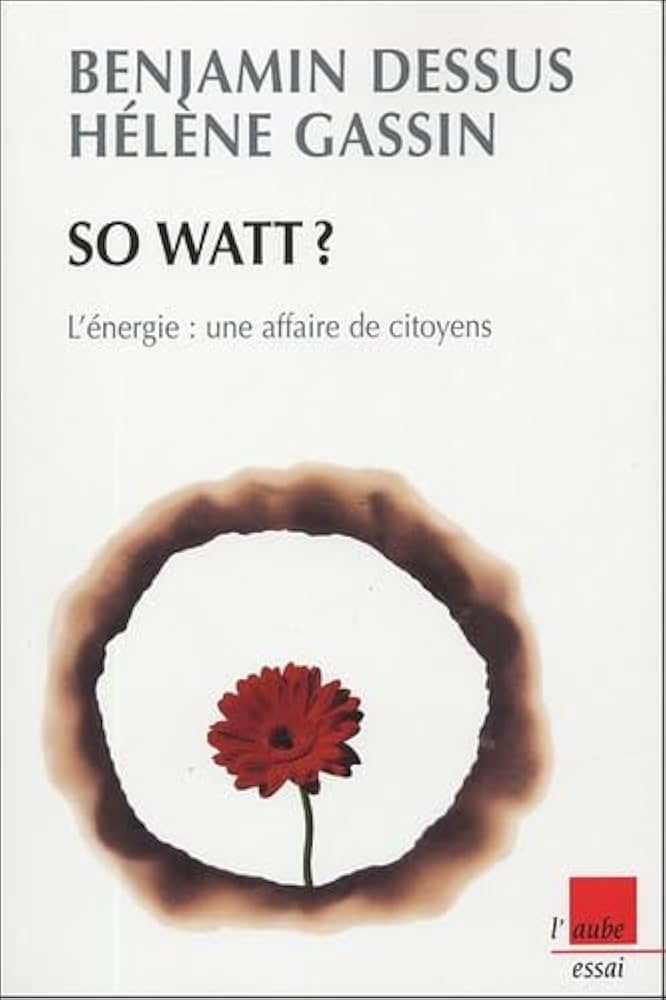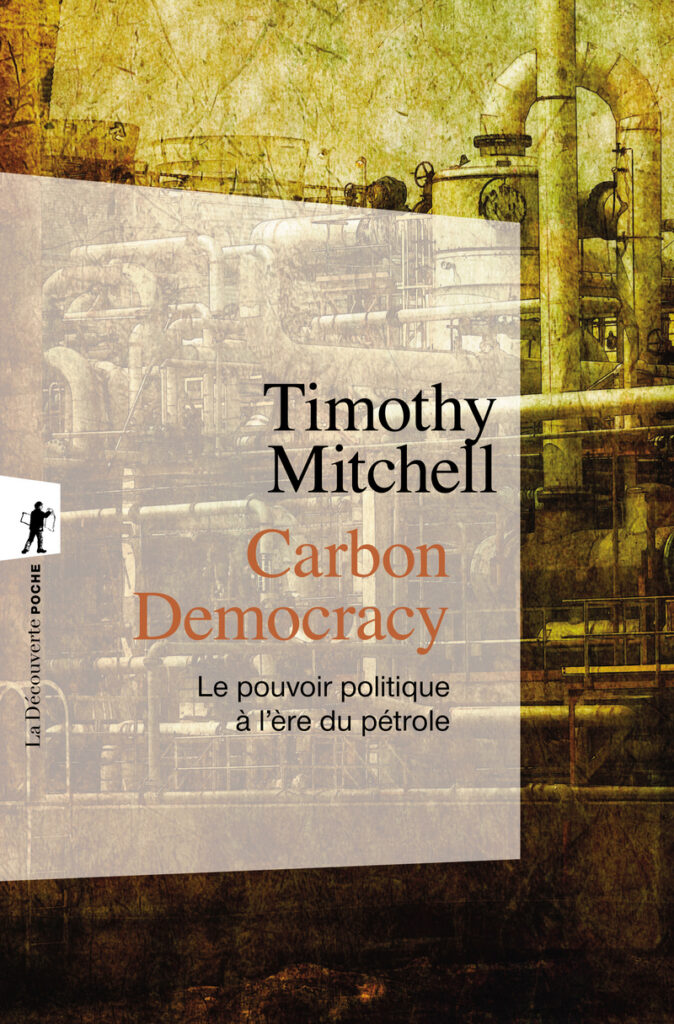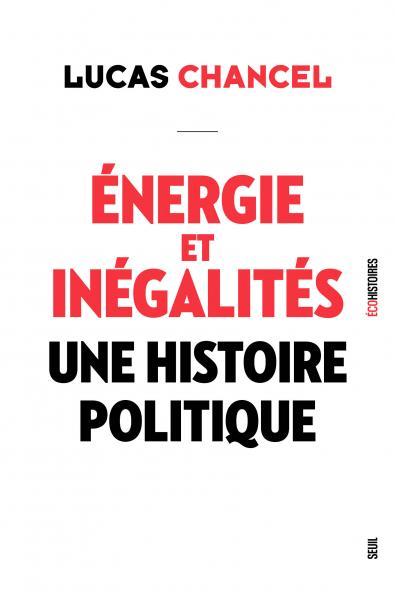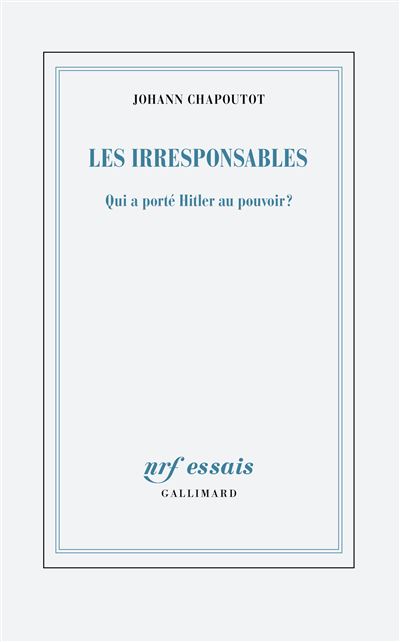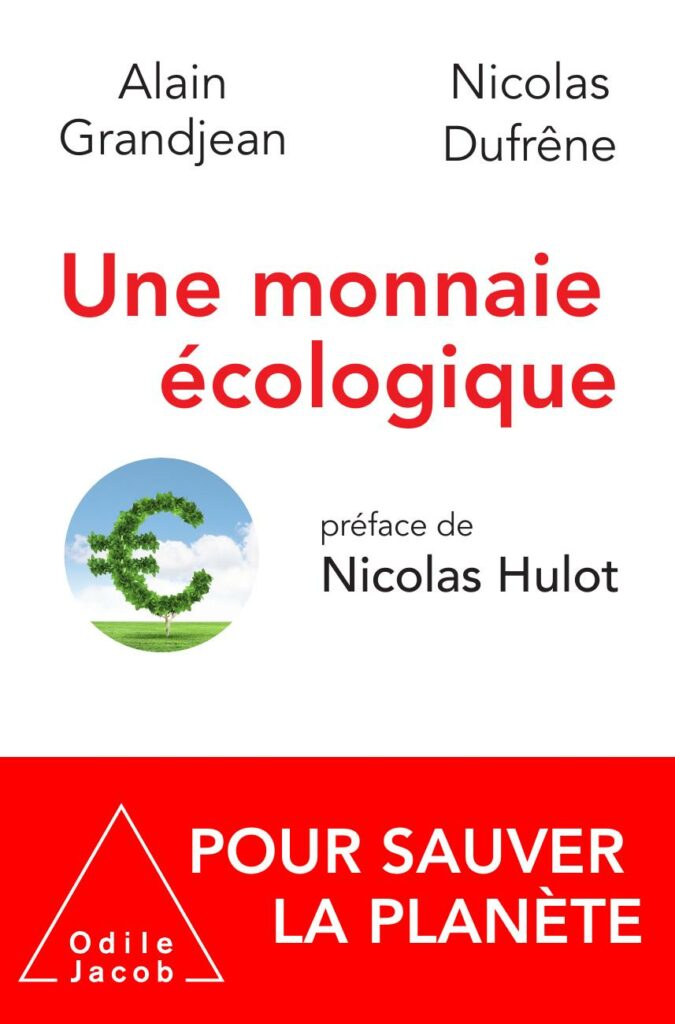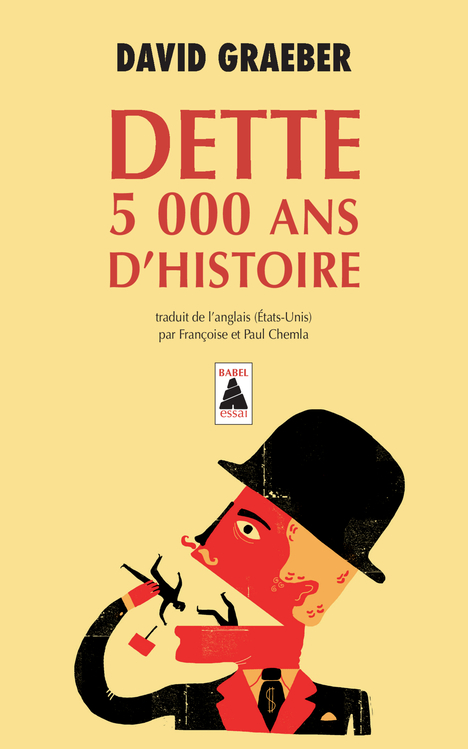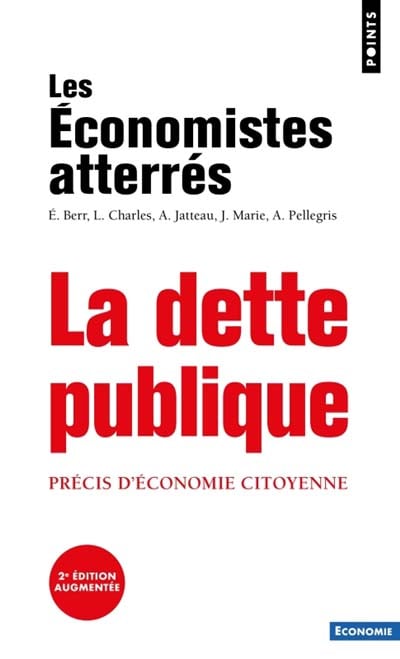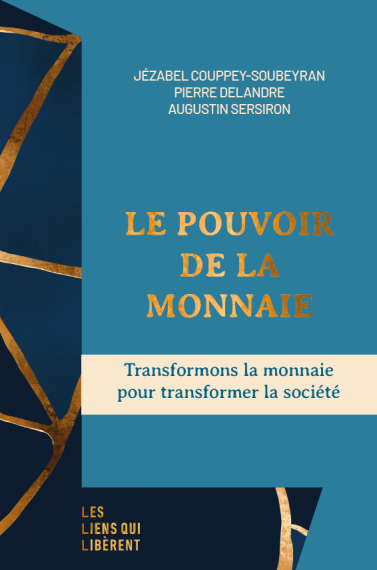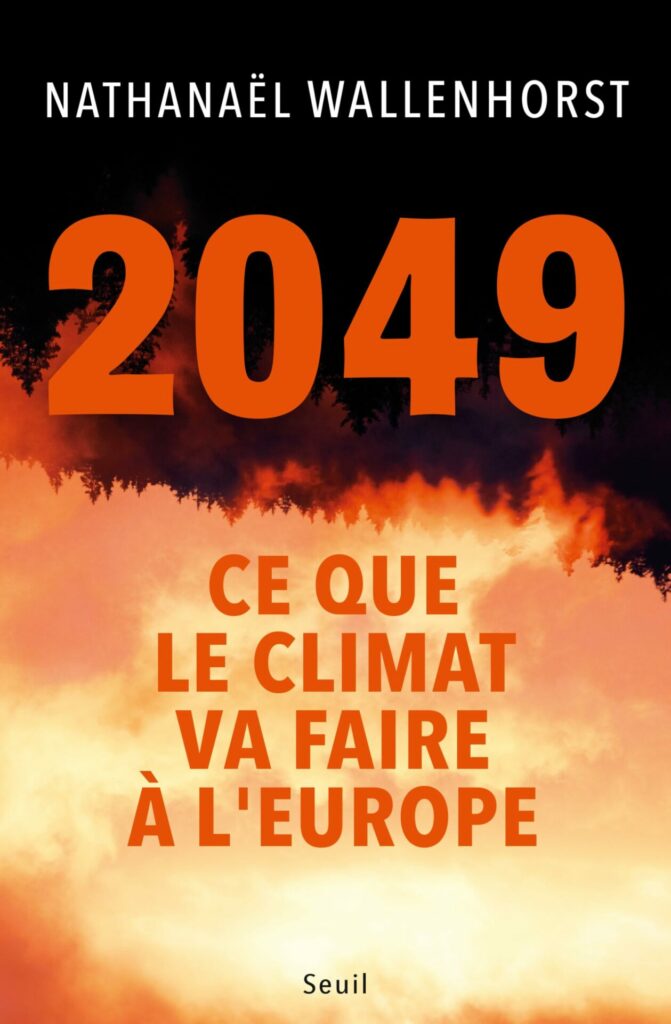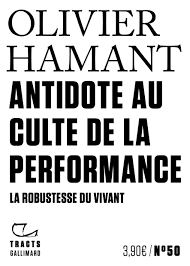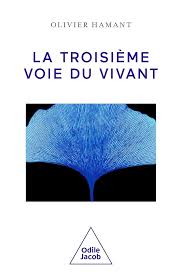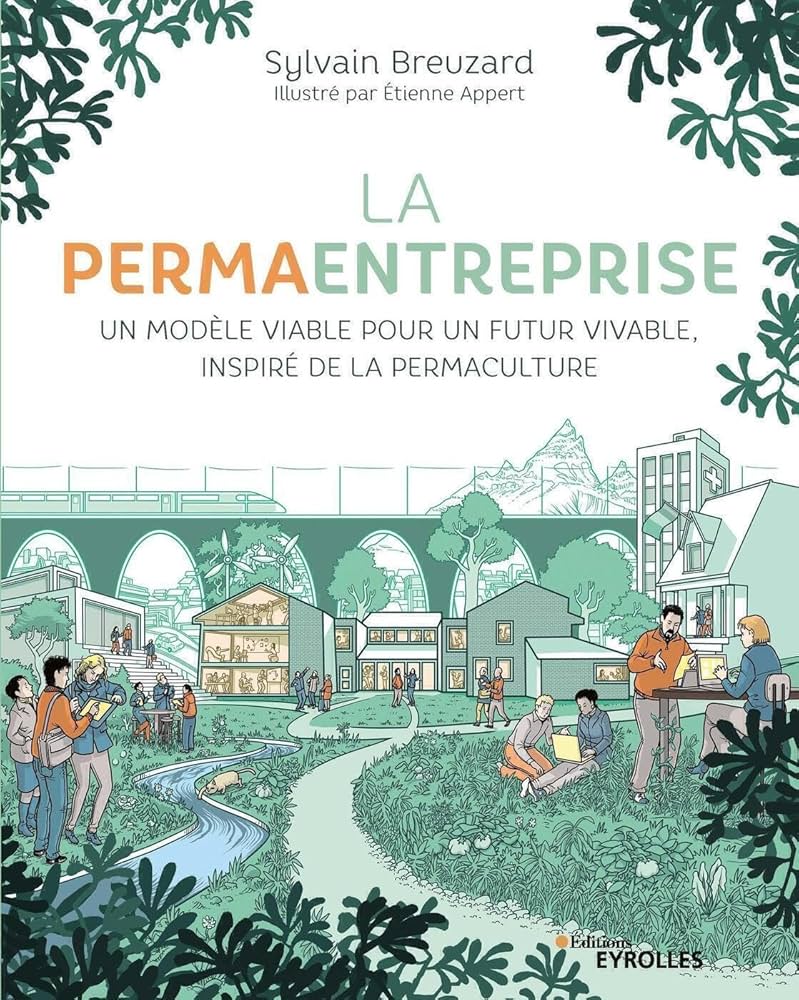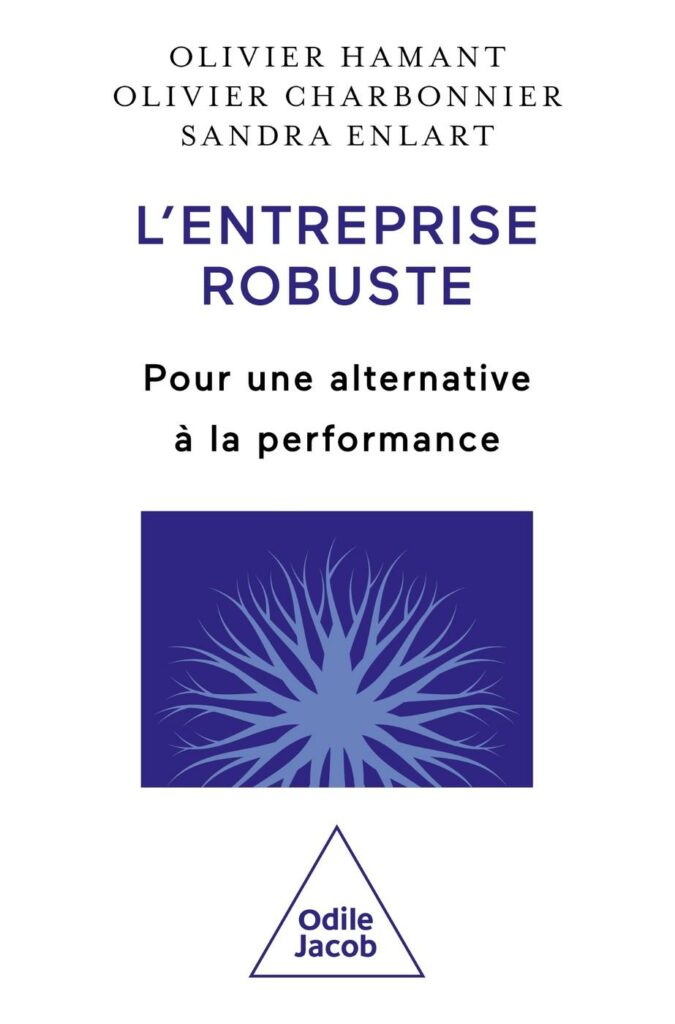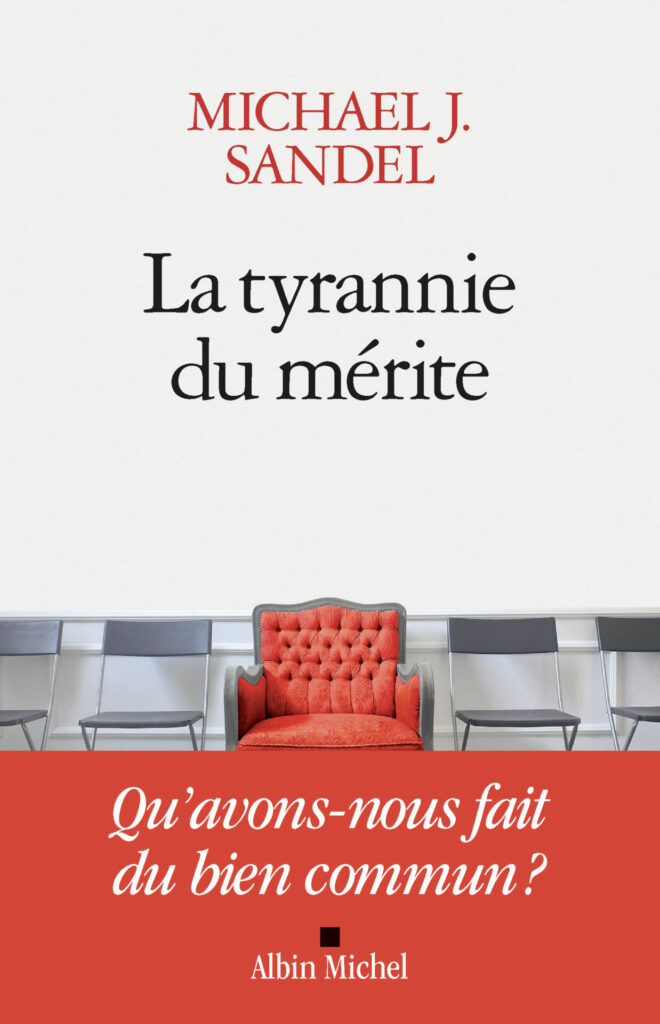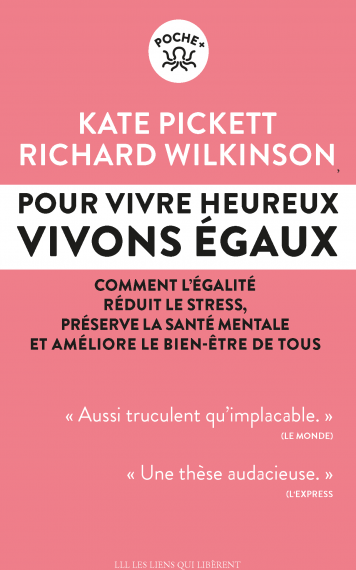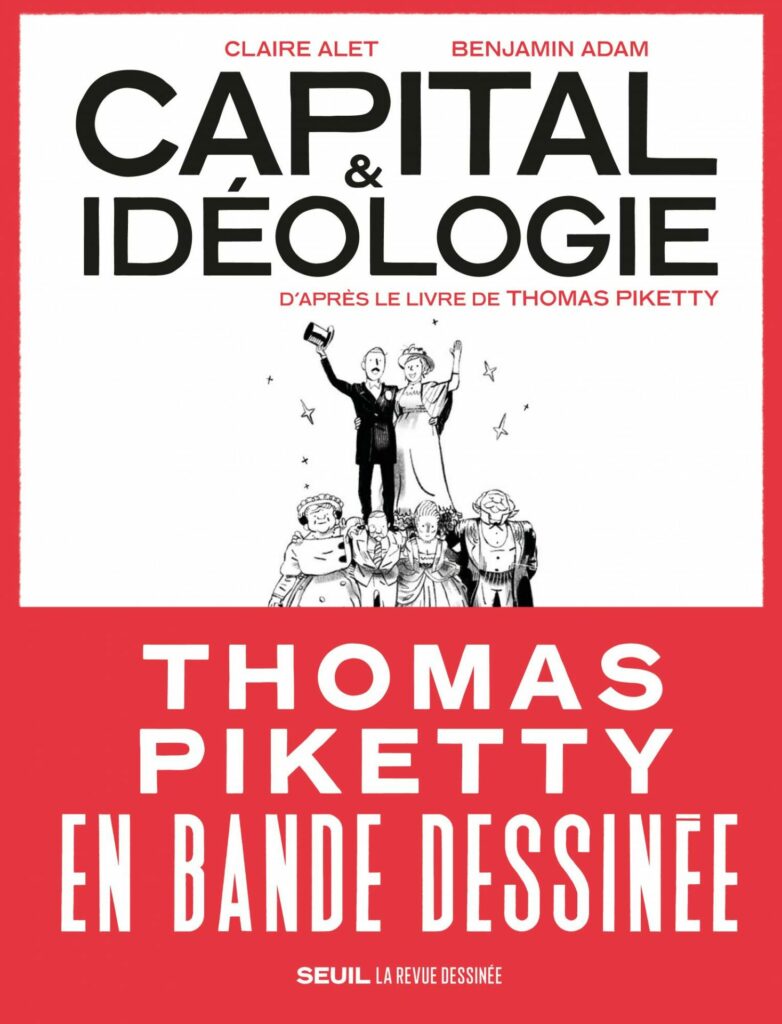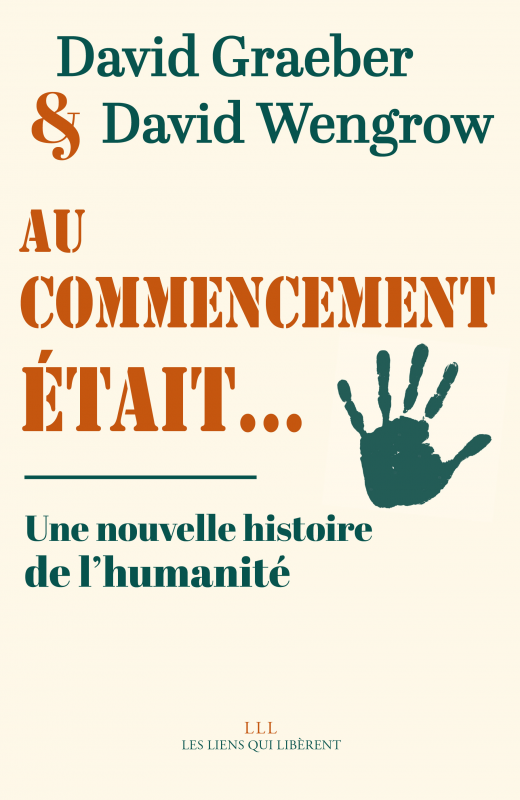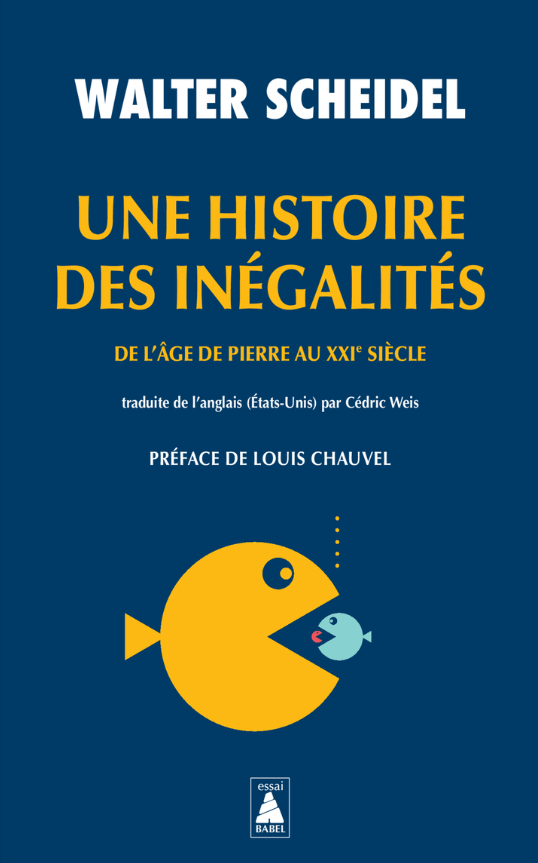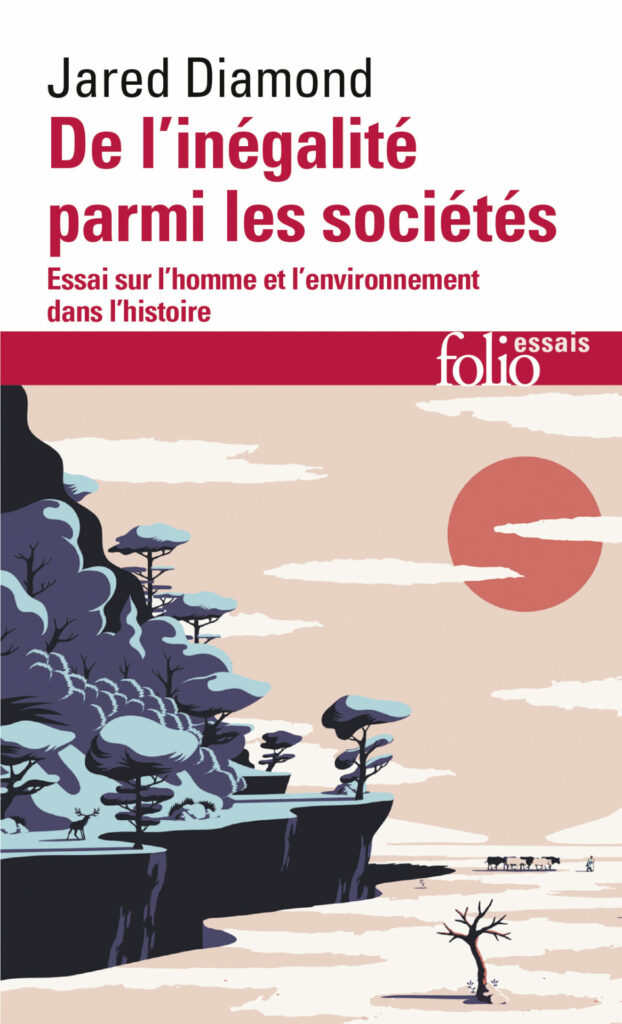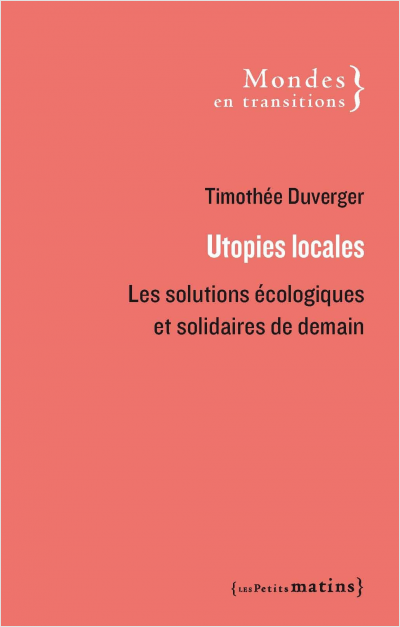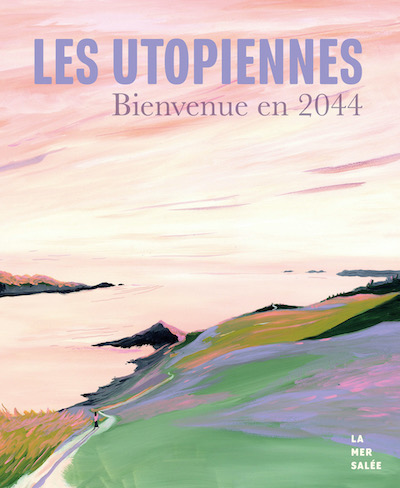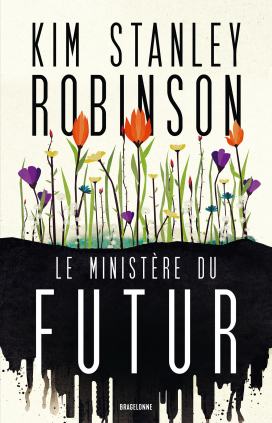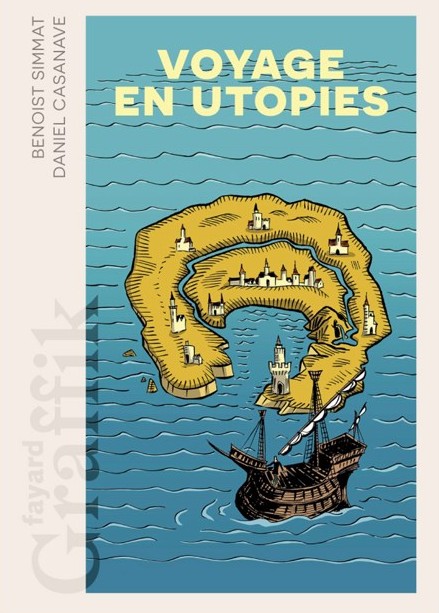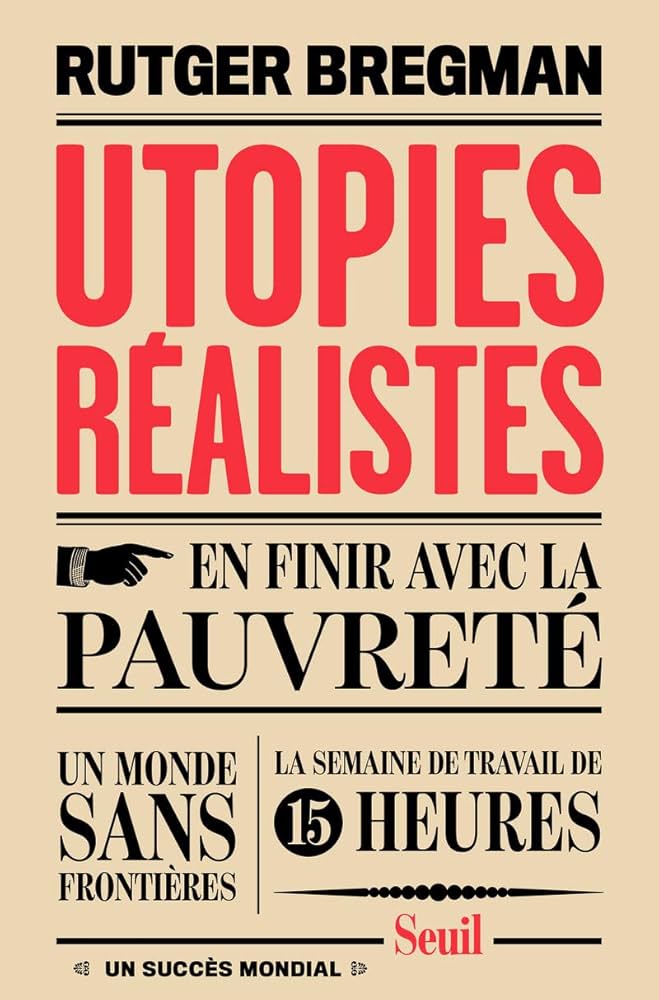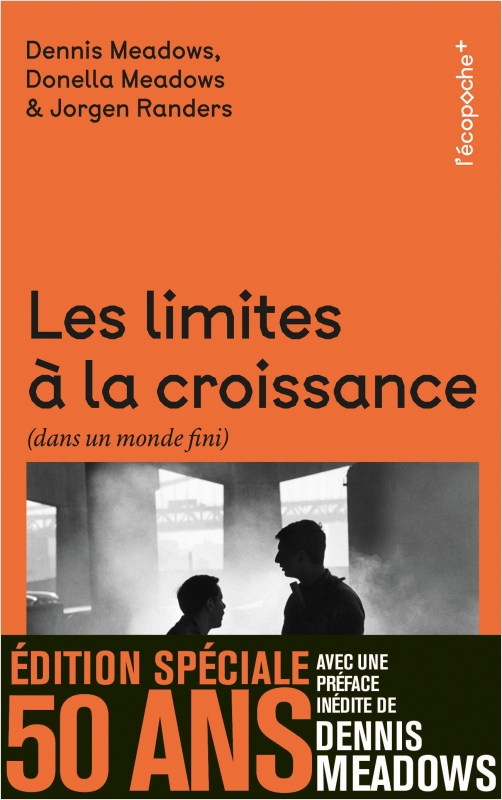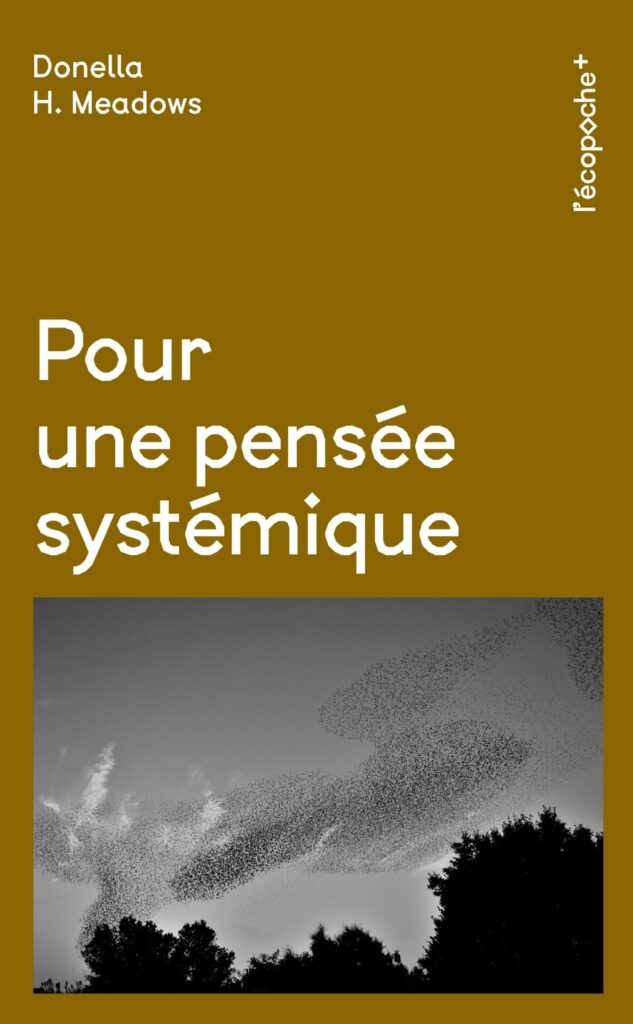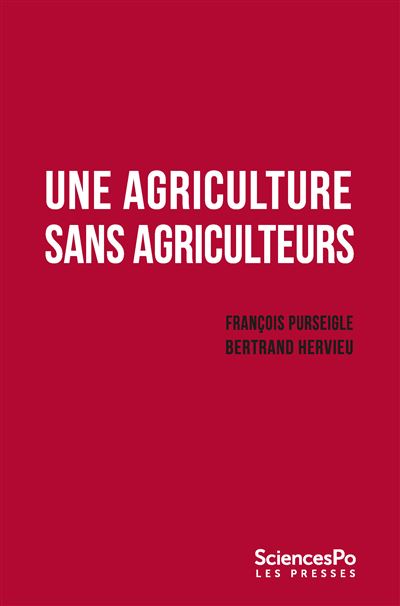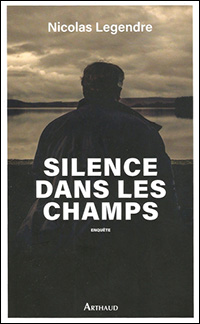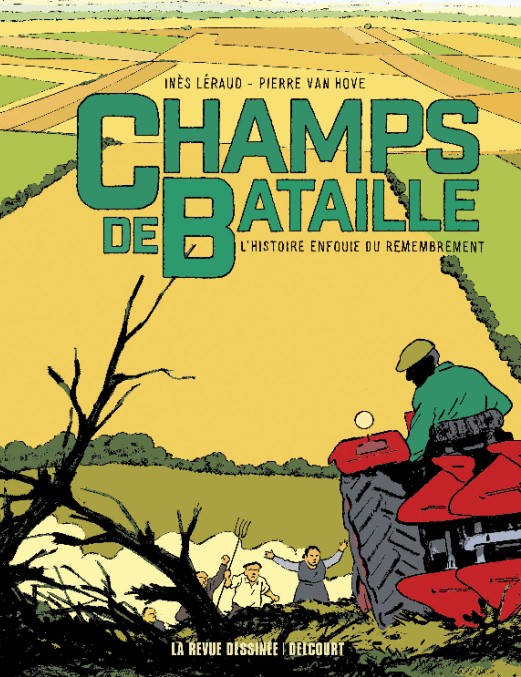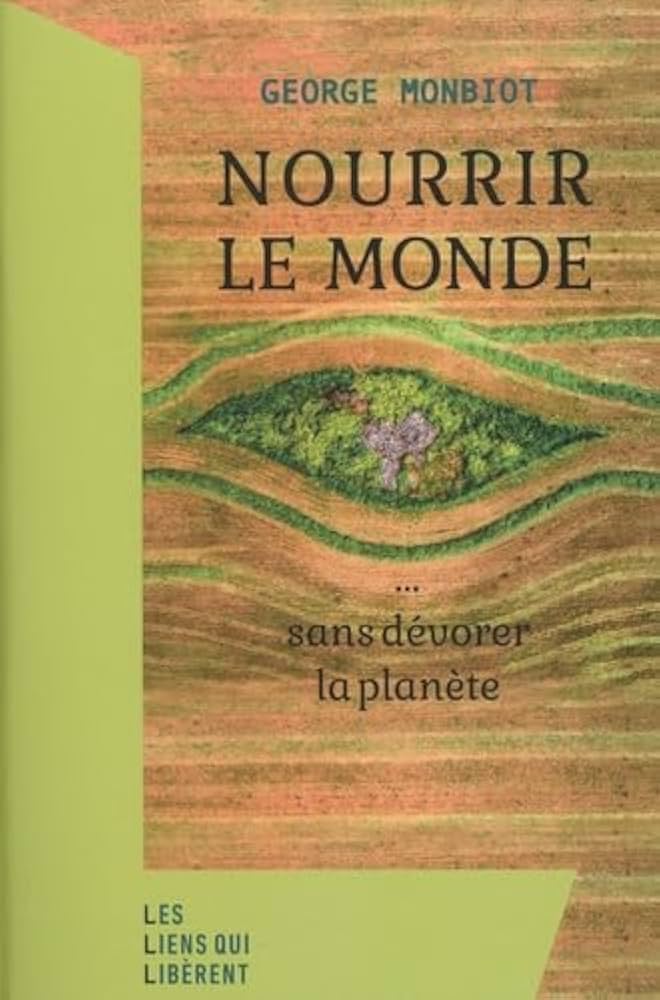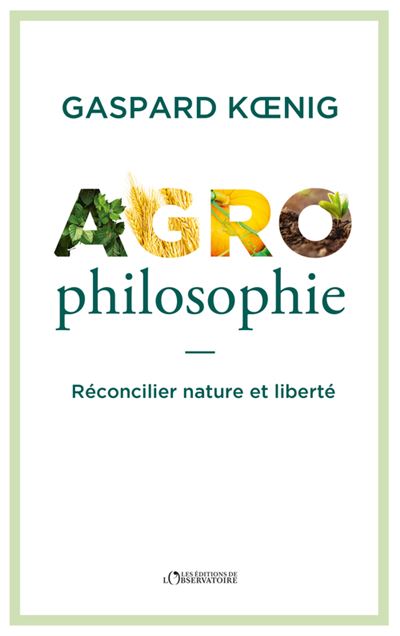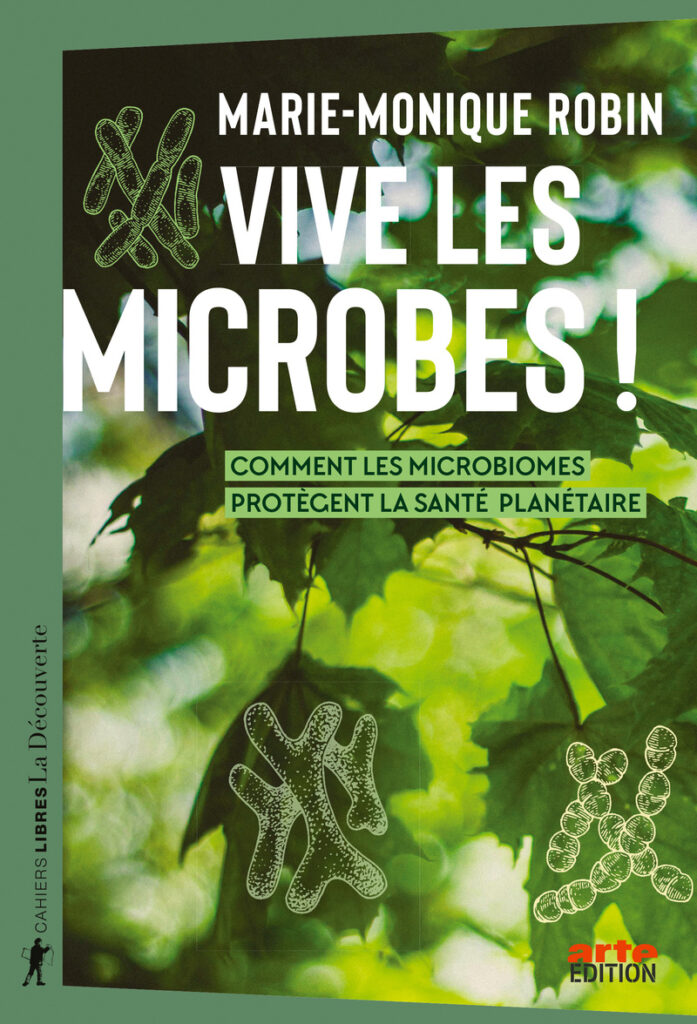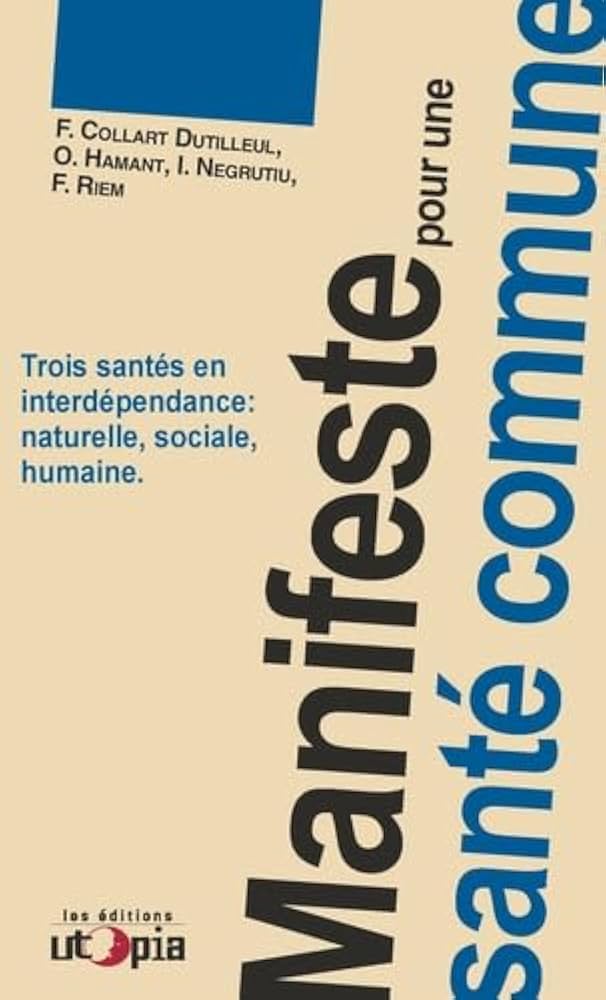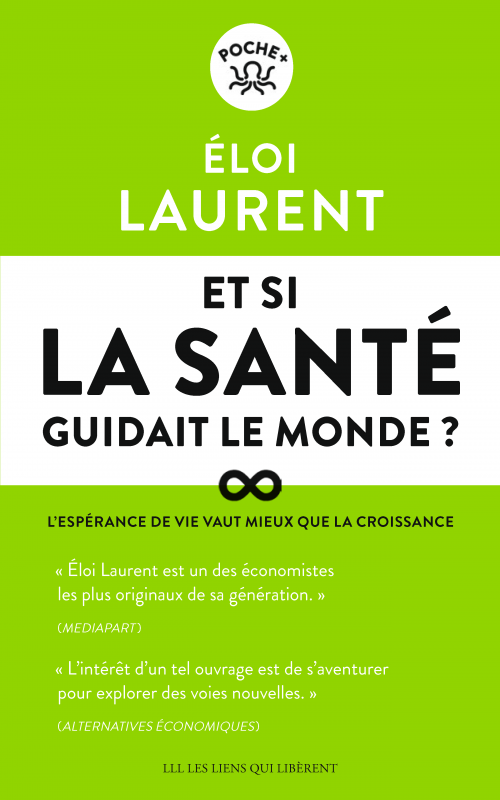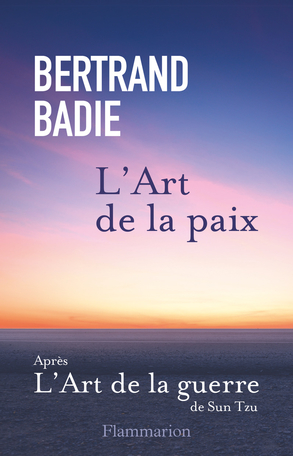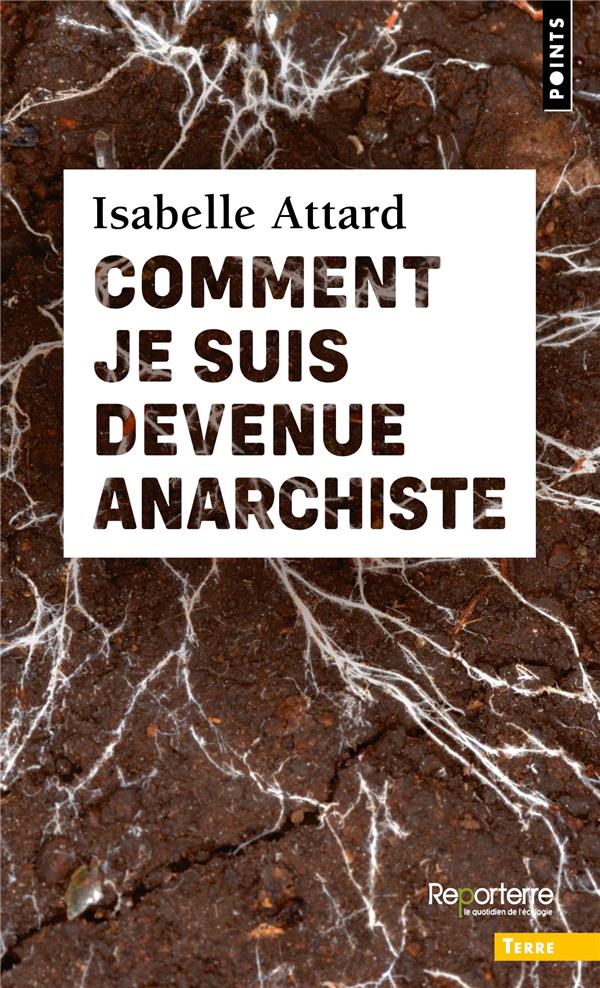Pour une alternative à la performance
Olivier Hamant, Olivier Charbonnier, Sandra Enlart, Editions Odile Jacob 2025
Olivier Hamant est un chercheur en biologie. Dans la « troisième voie du vivant », il a analysé la robustesse des modes de fonctionnement du vivant (hétérogénéité, redondance, aléas, gâchis, lenteur, incohérence) pour en tirer des enseignements pour le fonctionnement de nos sociétés humaines. Dans cet ouvrage, il s’associe avec deux experts de l’entreprise, un praticien, Olivier Charbonnier, et une experte des relations humaines, Sandra Enlart, pour approfondir la manière dont l’entreprise peut s’emparer de ce concept de robustesse pour en faire une boussole de son activité. « Il ne s’agit plus de faire différemment (chercher d’autres voies performantes), mais bien de faire différents (dérailler du culte de la performance) ».
Le premier chapitre fait le constat. Il faut prendre acte du dérèglement écologique et les entreprises ne sont clairement pas adaptées aux fluctuations en cours et à venir liées à ce dérèglement : « Le développement à l’Occidental est une course de noctambules vers le mirage d’une croissance infinie… L’escalade ainsi générée est la principale cause de turbulences socioécologiques. En retour jusqu’où le système ainsi mis sous pression peut-il résister face à un environnement hyper fluctuant ? ».
« Pour sortir l’entreprise du modèle productiviste et de ses limites, nous entendons souvent l’injonction de reconnexion au vivant« . Le deuxième chapitre s’attache à nous faire comprendre que la reconnexion au vivant est loin de la vision mécaniste et performante que nous en avons souvent : il ne s’agit pas de s’inspirer de la forme du bec du martin-pêcheur pour construire des TGV avec une aérodynamique plus performante. Il s’agit d’observer comment la sous-optimalité du vivant, sa capacité à garder des marges de manœuvre lui permet d’être robuste : « Être vivant, c’est être variable. Il n’est donc pas étonnant de constater à quel point il y a du jeu dans les rouages des systèmes biologiques à toutes les échelles et au service de la robustesse de l’ensemble ». De fait, le vivant n’est pas performant. On trouve hétérogénéités, redondances, aléas, gâchis, lenteurs, incohérences à tous les niveaux. Et c’est ce qui a permis au vivant de s’adapter à toutes les fluctuations dans un monde ou, contrairement à ce que l’on veut nous faire croire, les ressources sont rares. « La performance se justifie dans un monde stable aux ressources abondantes et en paix. Elle n’a aucun sens dans un monde instable en pénurie de ressources et en guerre ».
Les auteurs se penchent ensuite sur l’adaptabilité des entreprises et ses limites : la gestion des risques qui conduit à développer un arsenal de normes, d’institutions, de certifications… La RSE qui est souvent un ajout au modèle économique existant sans le remettre en cause et qui conduit à la mesurocratie. Bref une volonté de contrôle, de maîtrise, illusoire dans un monde de plus en plus imprévisible. « Renoncer à cette forme de normativité, c’est accepter l’imprévu et permettre corrélativement la transformation perpétuelle ».
Dans le quatrième chapitre, ils analysent comment « la robustesse du vivant construite contre la performance pourrait représenter une piste de réflexion nouvelle et stimulante pour interroger la manière dont le monde de l’entreprise et celui du travail doivent penser leur propre mutation ». Ils le font en prenant bien soin de mettre en évidence les limites de l’analogie. Car les humains ont des spécificités sociales que n’ont pas les autres vivants. « Ce qui fait tenir un groupe social, ce sont des mythes, une langue, une culture, des normes, des habitudes sociales souvent peu efficaces, voire absurdes, un imaginaire, des religions, bref toute une série de comportements et pratiques qui n’ont aucune justification du côté du vivant ». Ce qui les conduit à analyser l’acceptabilité sociale d’une démarche de transformation vers la robustesse dont les principes sont : « la circularité avant l’efficience, la coopération avant la compétition, l’adaptabilité ouverte avant l’agilité, l’exploration avant l’optimisation, la diversification avant la spécialisation, la viabilité à long terme avant l’efficacité à court terme ».
Ils consacrent ensuite un chapitre à « des exemples d’entreprises, d’associations, de communautés qui, aujourd’hui déjà, ont anticipé ces changements et ont choisi des modes d’organisation à visée robuste compatibles avec les bouleversements socio écologiques. »
Le dernier chapitre donne des pistes pour devenir une entreprise robuste, autour de 3 grands axes. D’abord changer de regard « ouvrir le cadre mental des décideurs au monde fluctuant », ensuite modifier notre rapport au temps et à l’espace, c’est-à-dire passer « du pouvoir de la moyenne – qui valorise les standards – à la puissance de l’écart-type – qui reconnaît les valeurs des disparités ». C’est-à-dire aussi arrêter d’empiler les couches (pour se rassurer !), simplifier et rechercher une plus forte hétérogénéisation des solutions. De ce point de vue, « le numérique comme l’IA nous enferre dans un monde homogène tiède et mortifère. »
Comment peut se faire la transformation de l’entreprise performante à l’entreprise robuste ? Ce sera par les marges nous répondent les auteurs dans la conclusion : « l’analyse des systèmes apporte une réponse simple à cette question. Un basculement opère presque toujours par les marges, le cœur du système est en général le dernier à basculer. »
Et comme la transformation sera très compliquée si le politique ne s’y implique pas, les auteurs proposent dans une annexe « quelques pistes ouvertes à destination des décideurs politiques avec l’ambition de créer les conditions réglementaires structurelles et éducatives pour que ces entreprises robustes puissent émerger ».
Un ouvrage très accessible et très inspirant qui doit parler à tous ceux qui se posent la question de savoir comment sortir de notre « course de noctambules vers le mirage d’une croissance infinie ».
Comme beaucoup d’ouvrages, il nous engage à changer de paradigme, car « penser que le vivant peut nous aider à inventer le monde de la coopération sans remettre en cause la société de l’abondance est une illusion ».