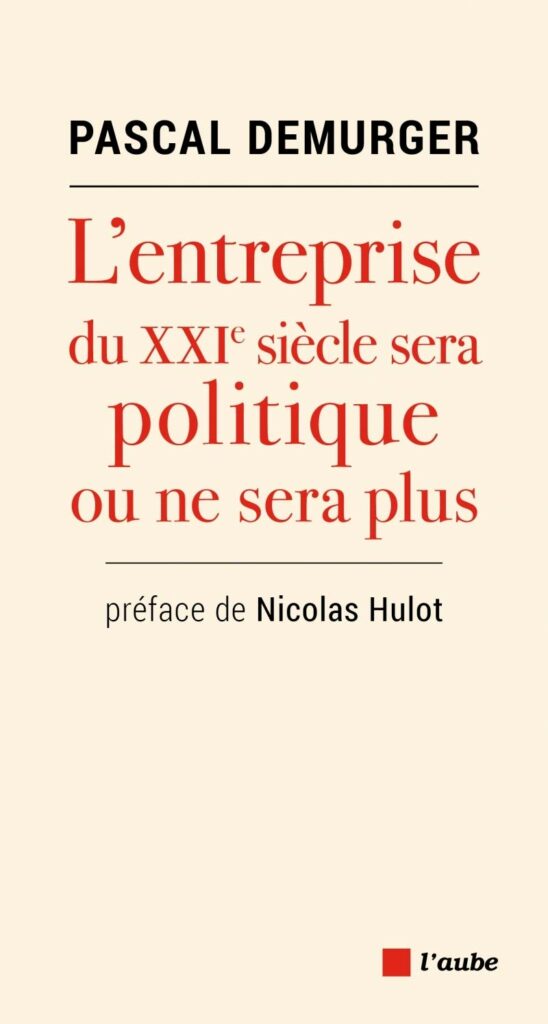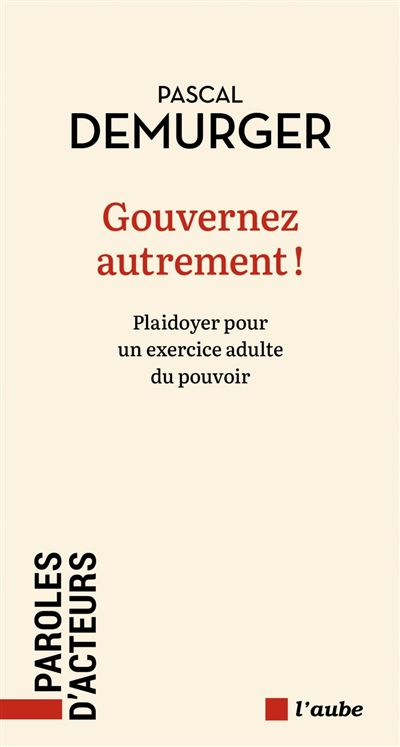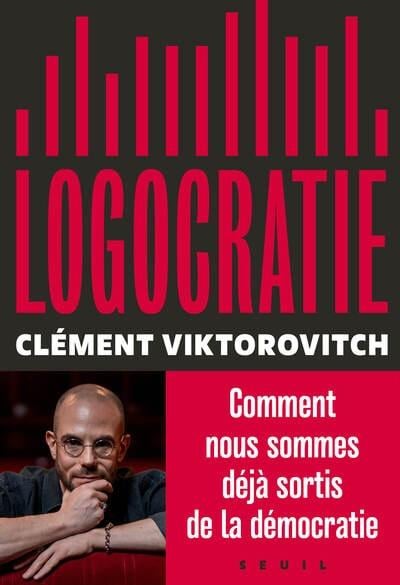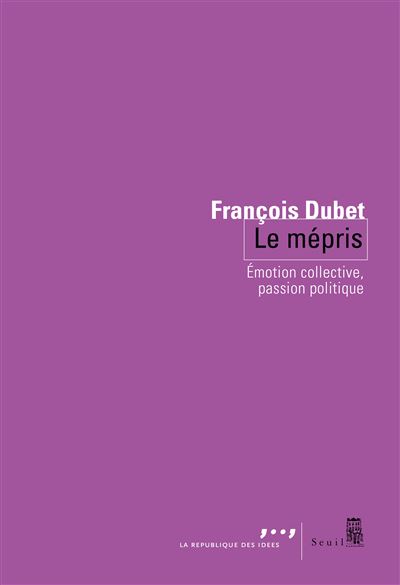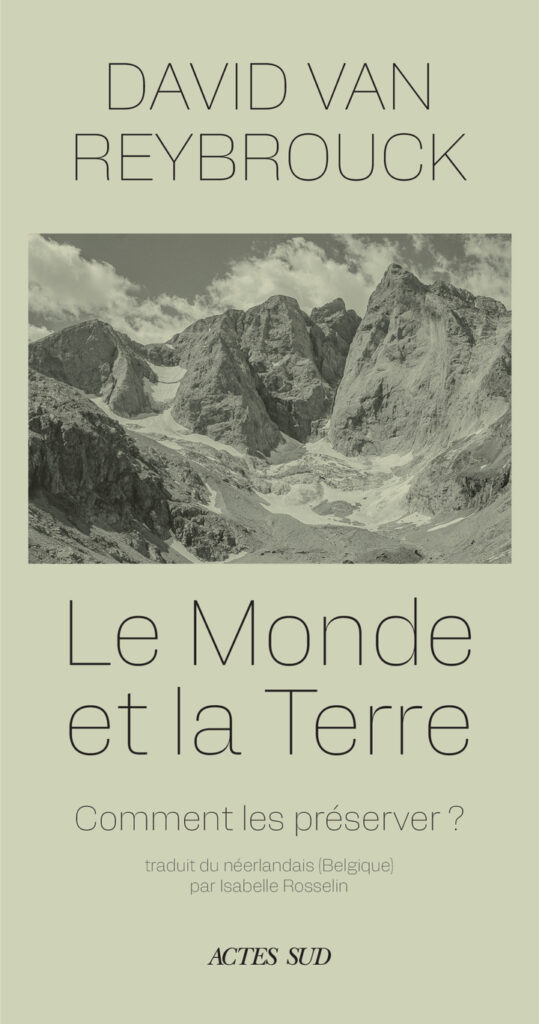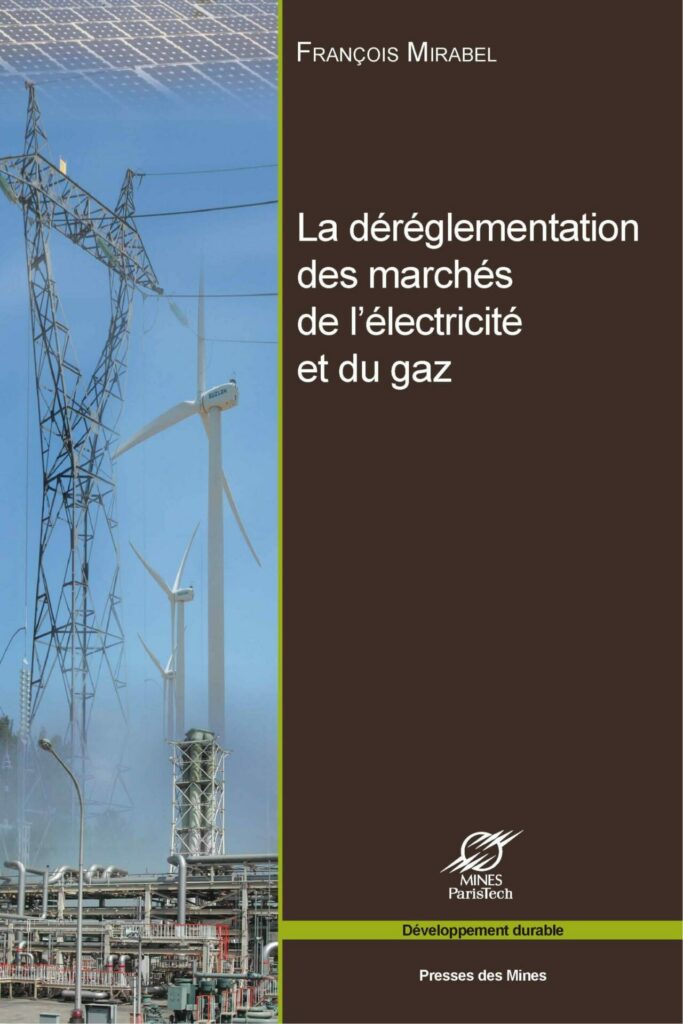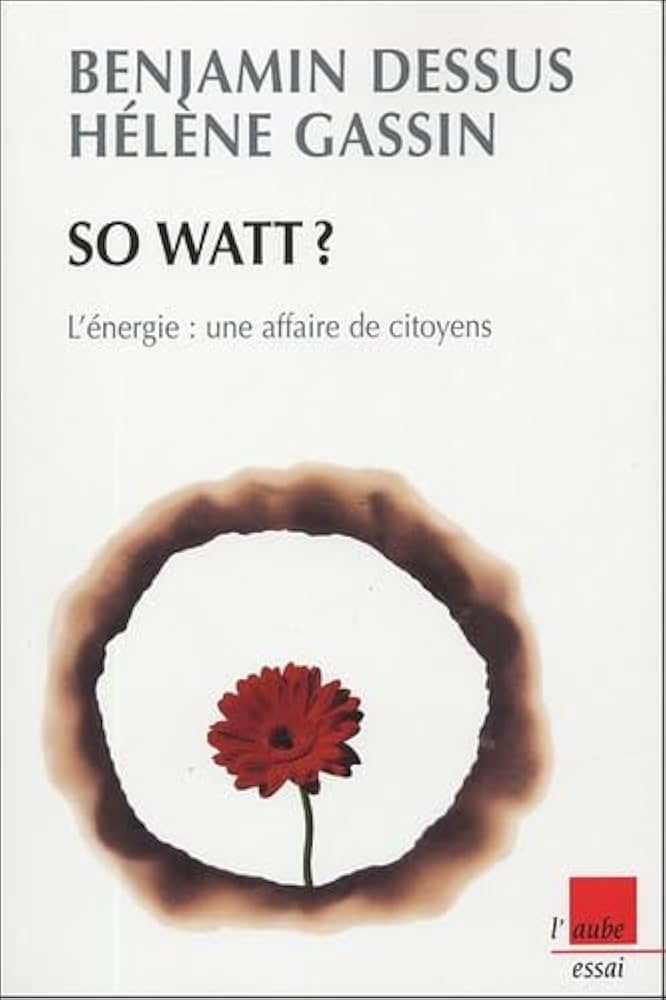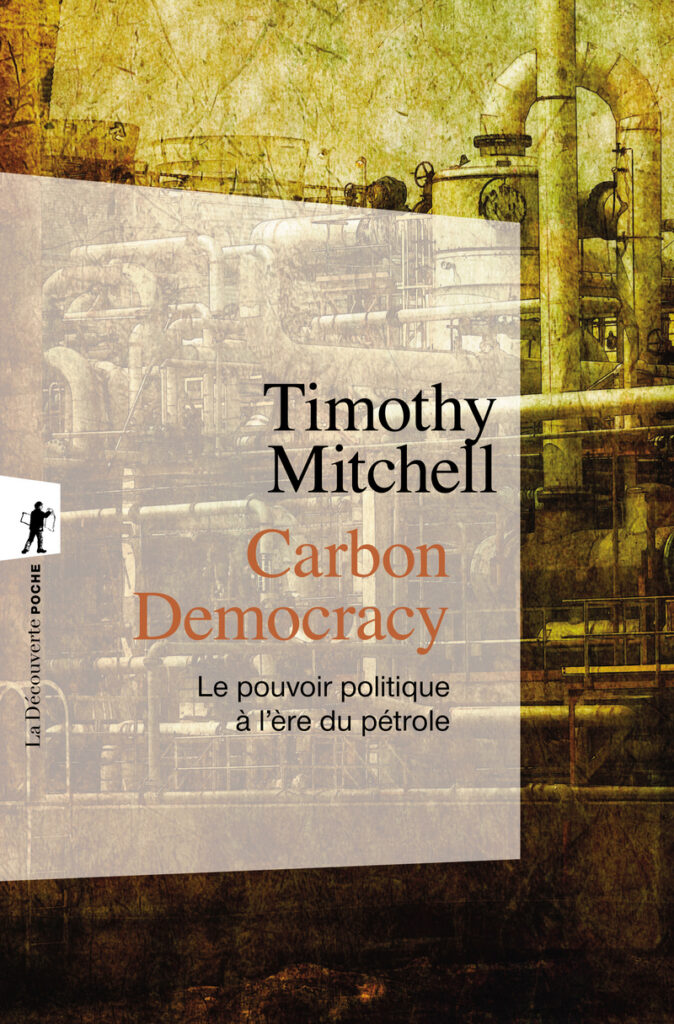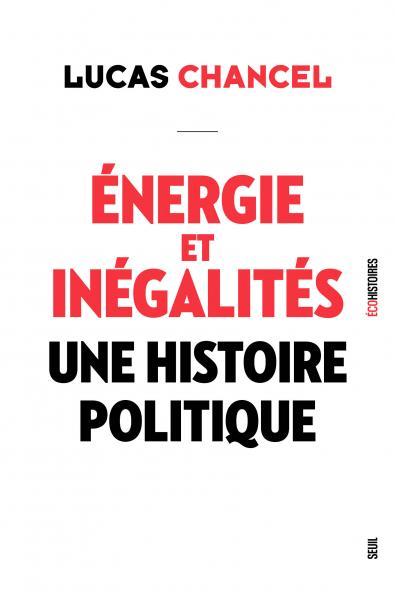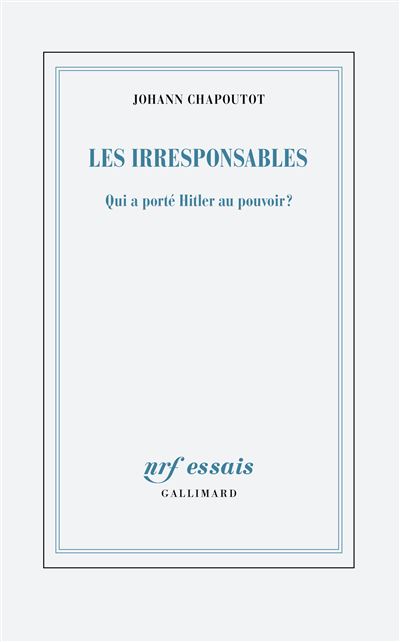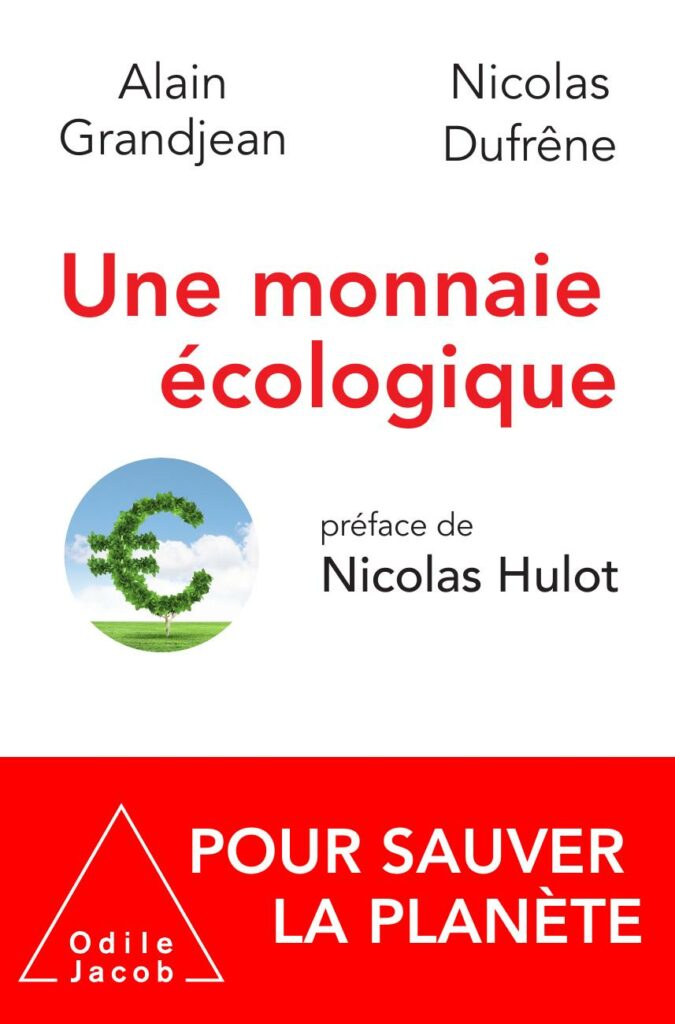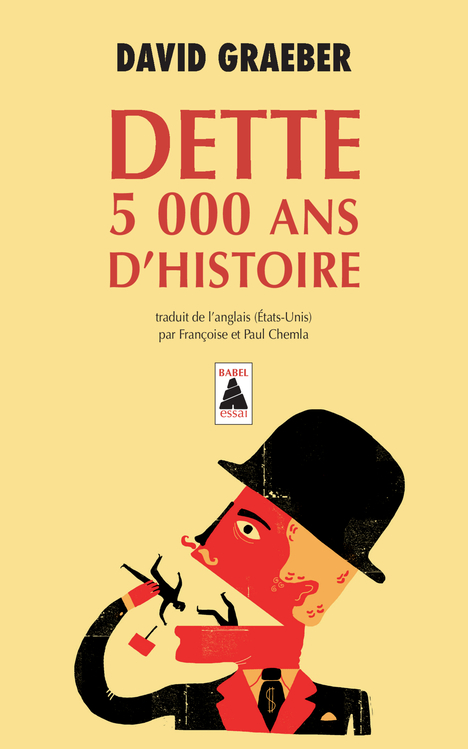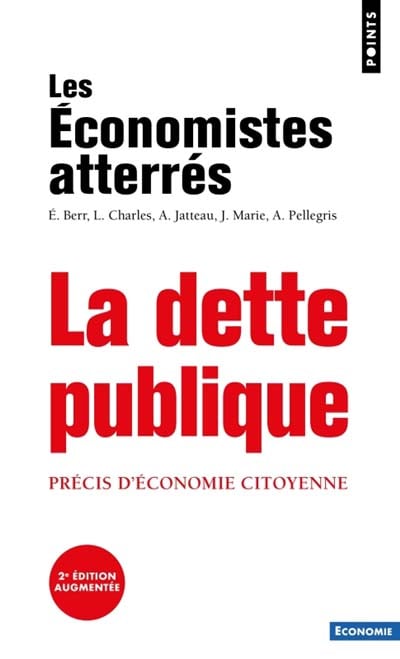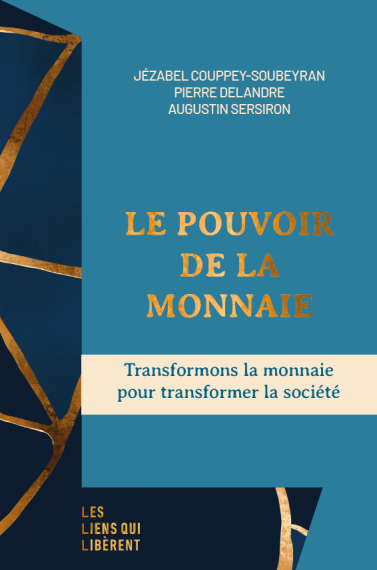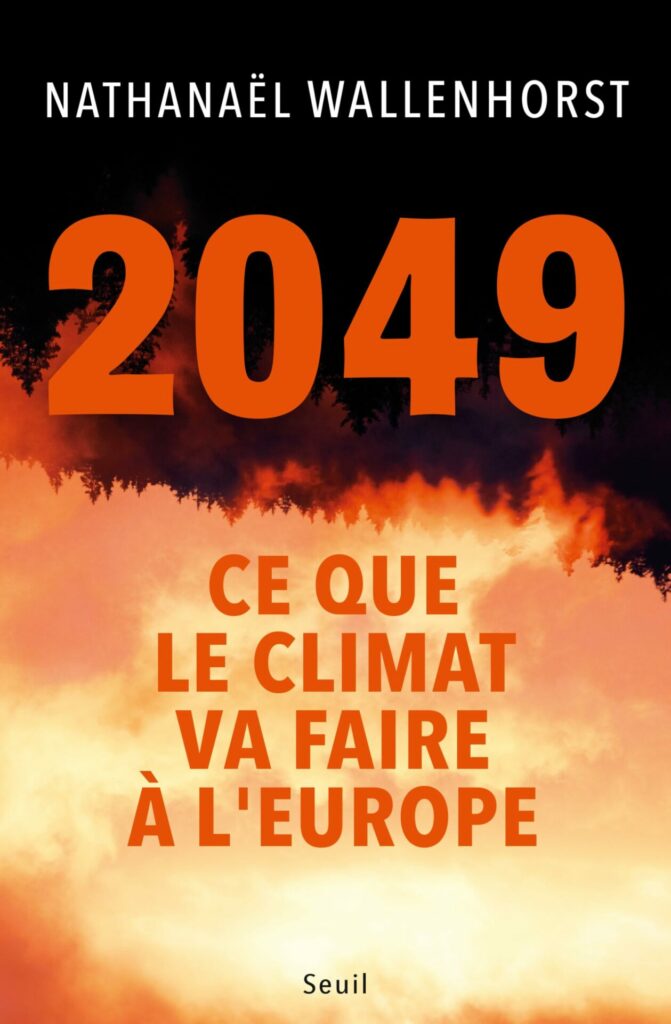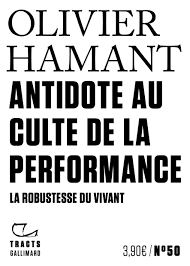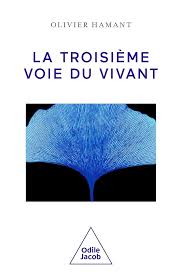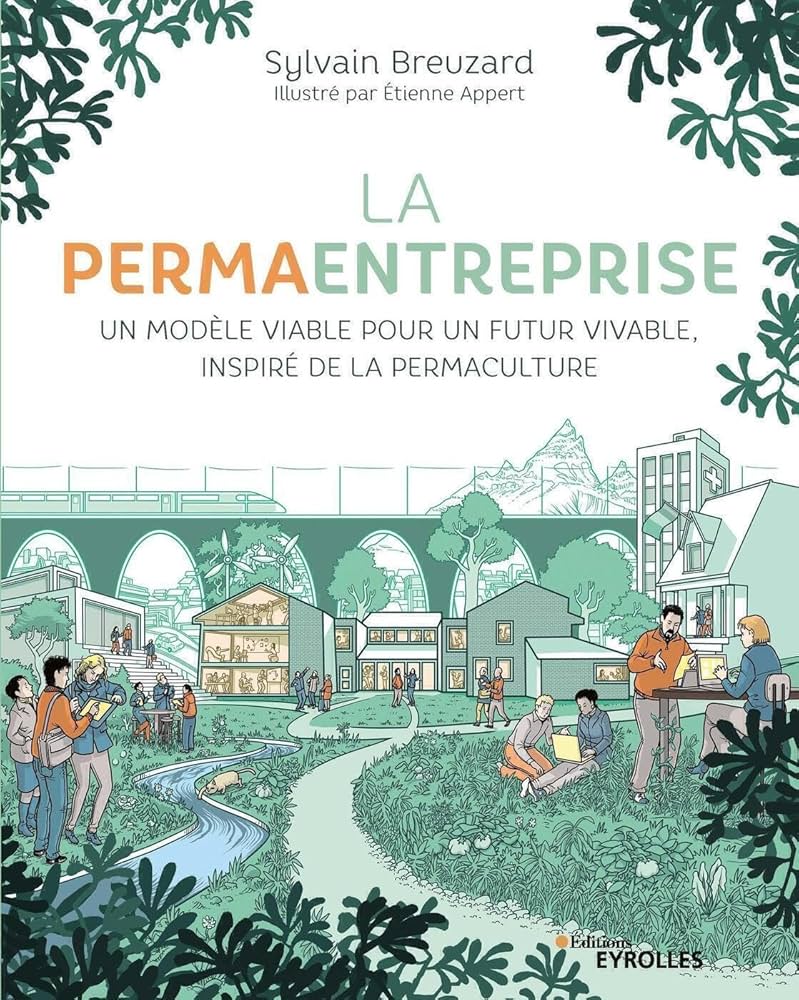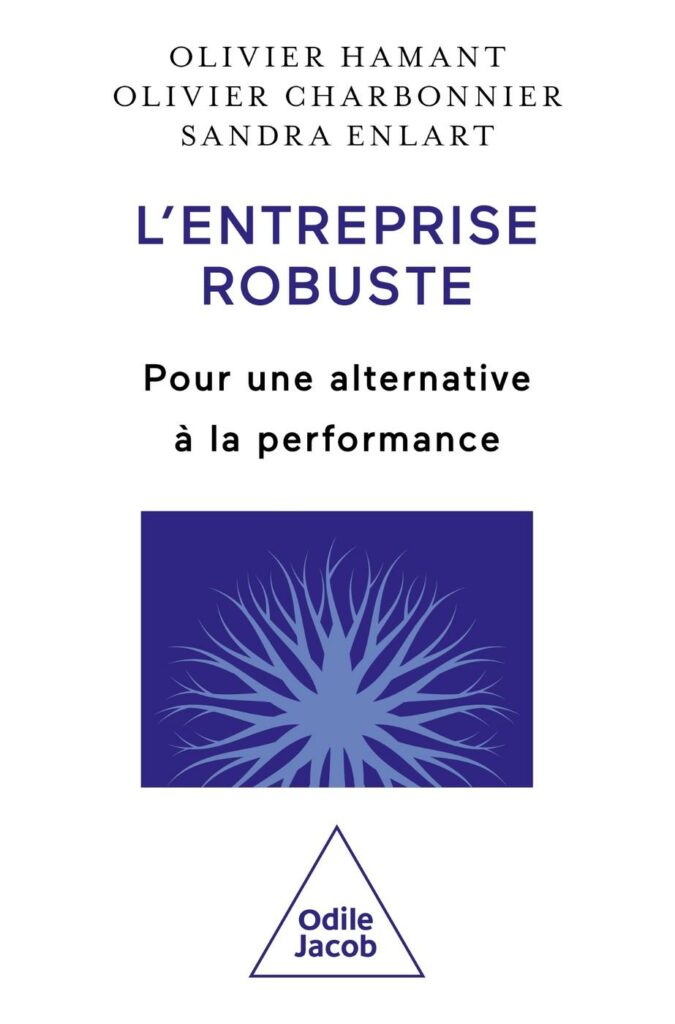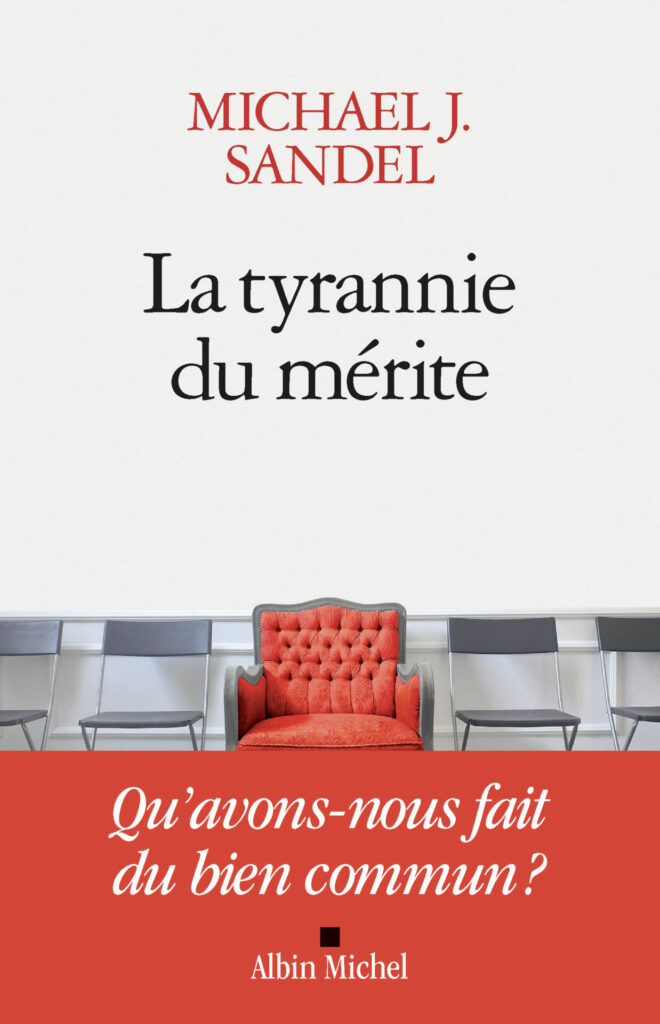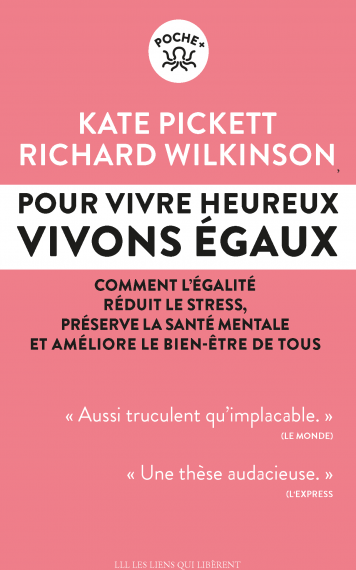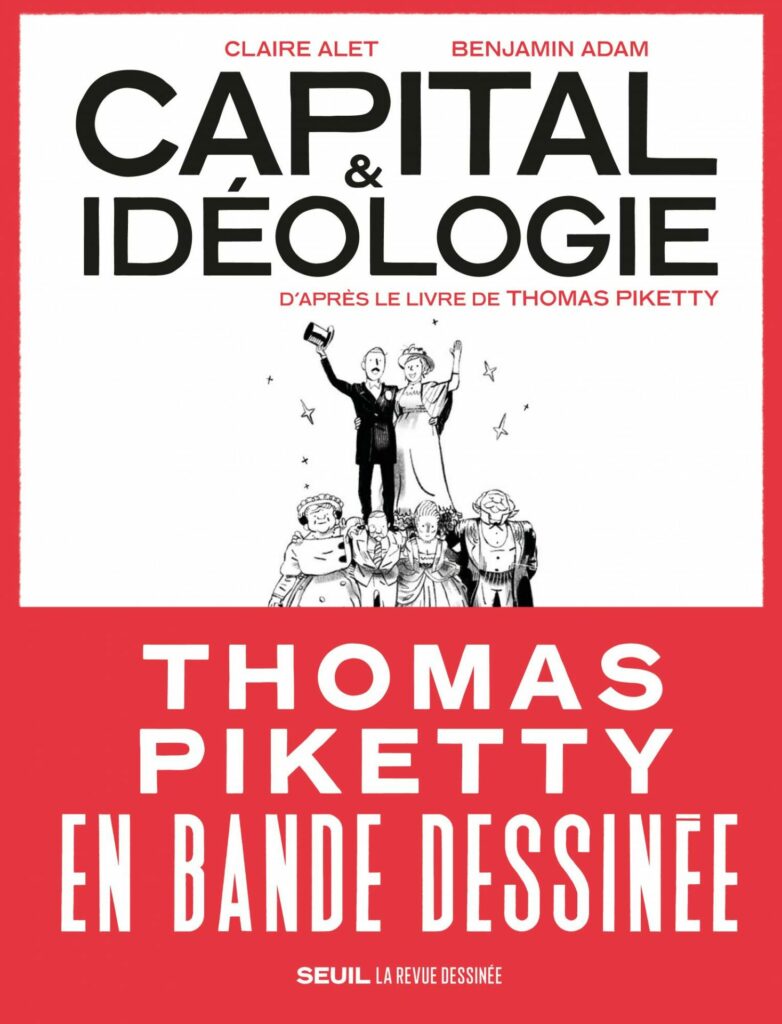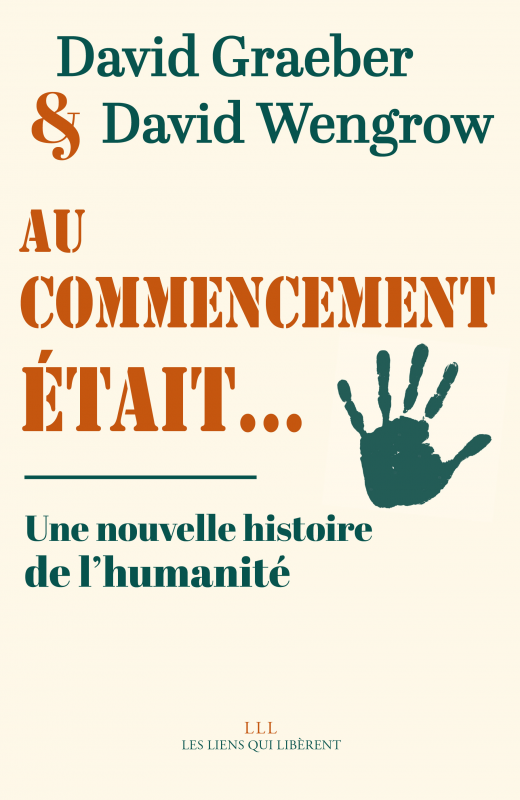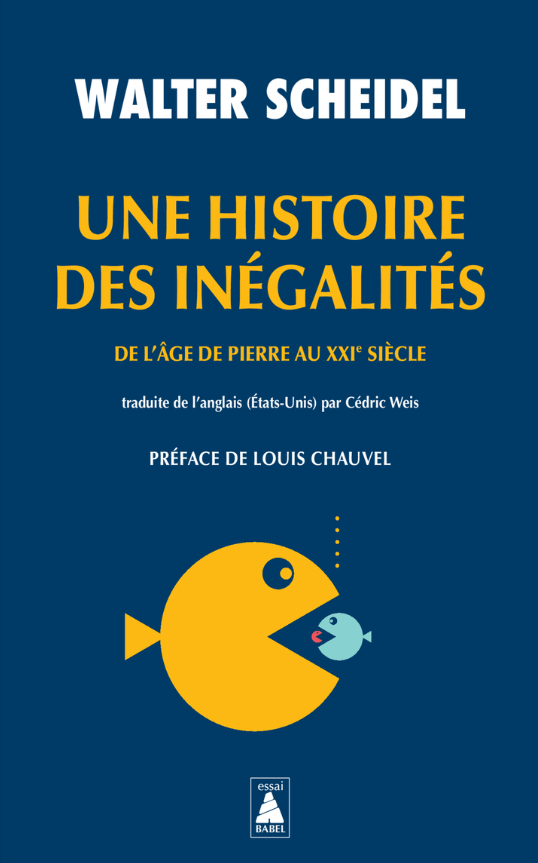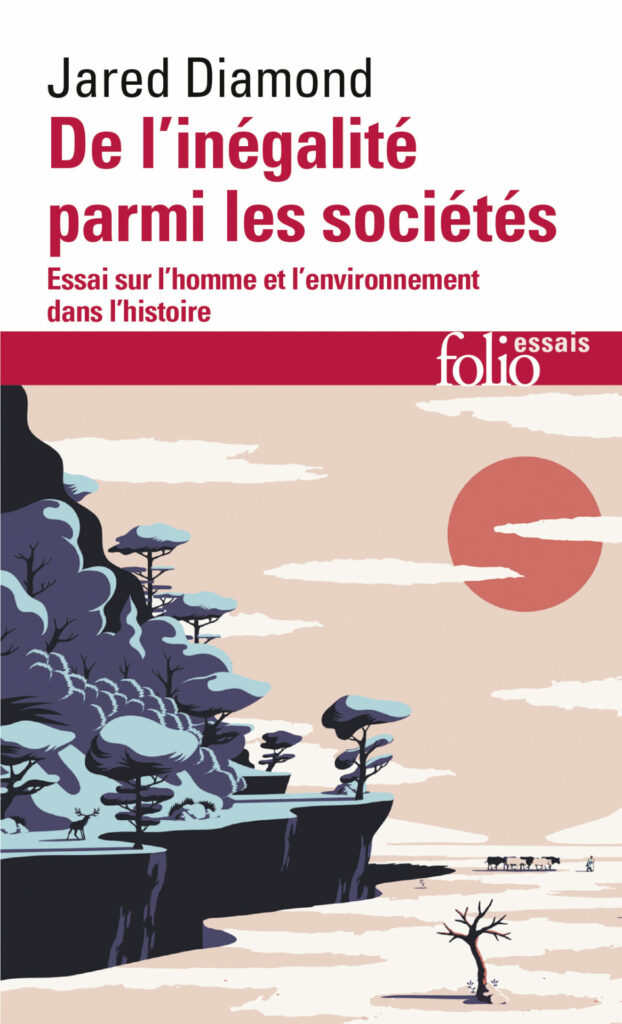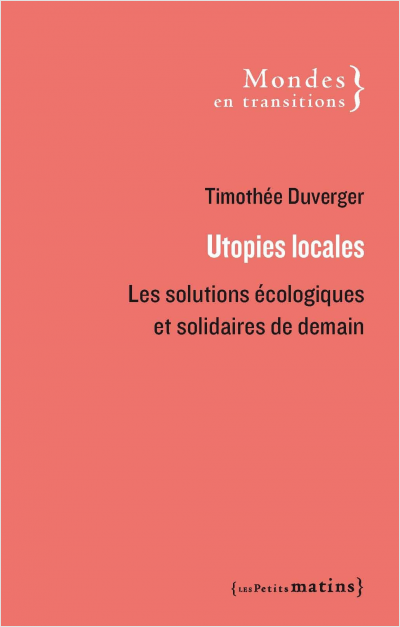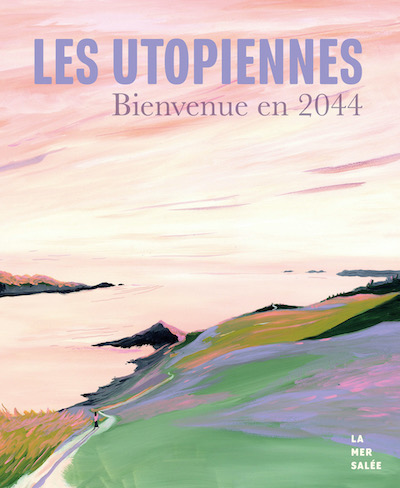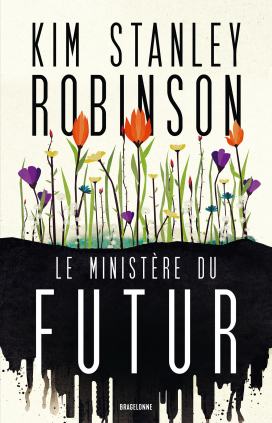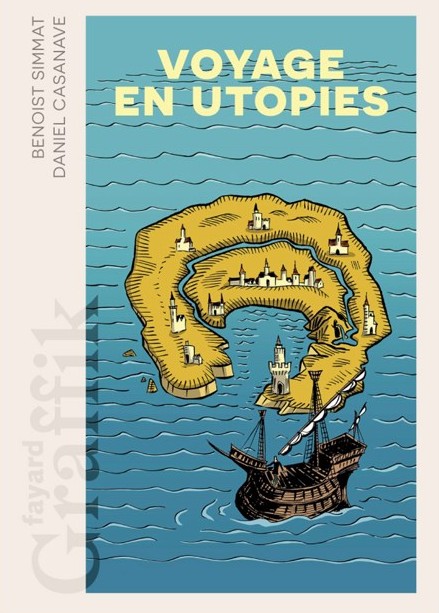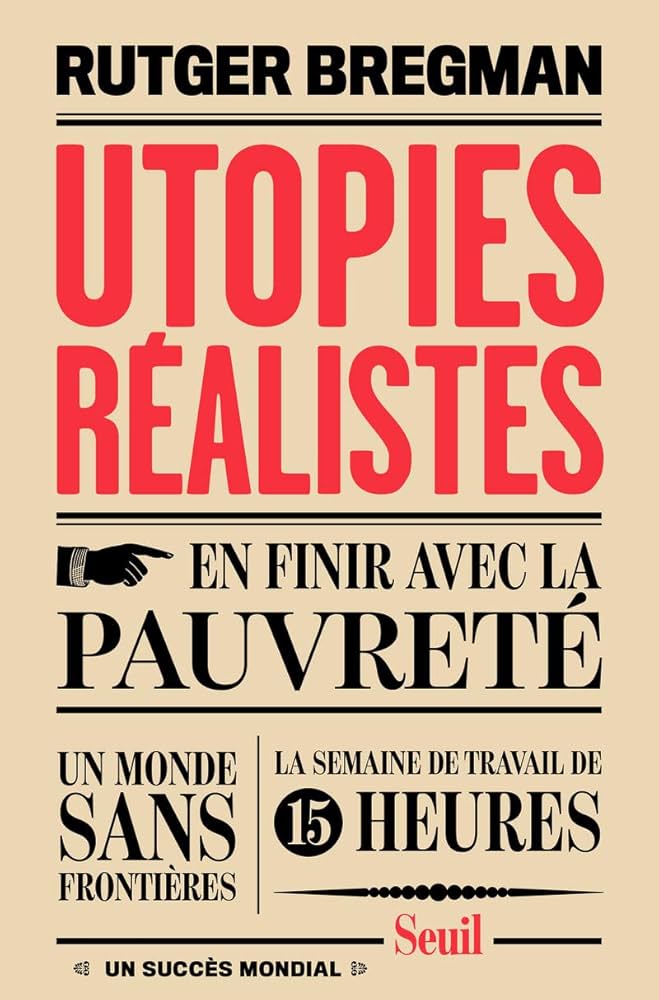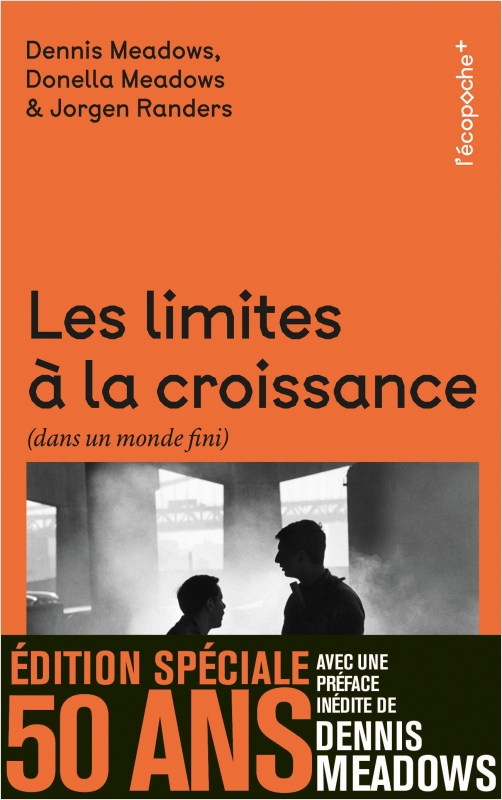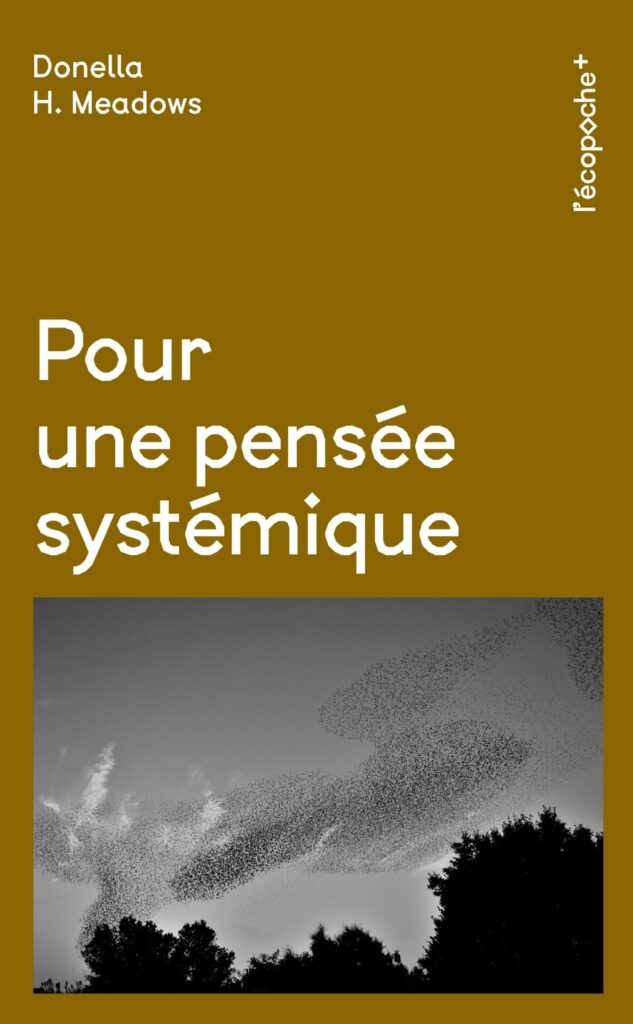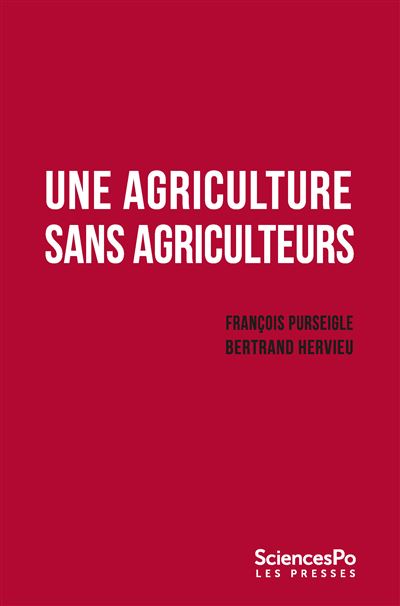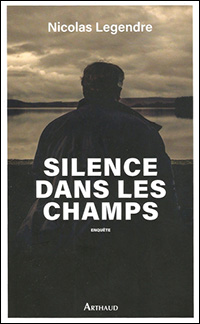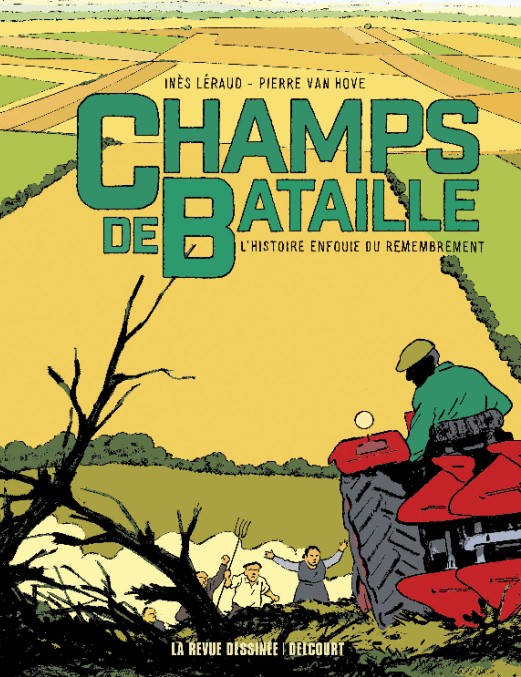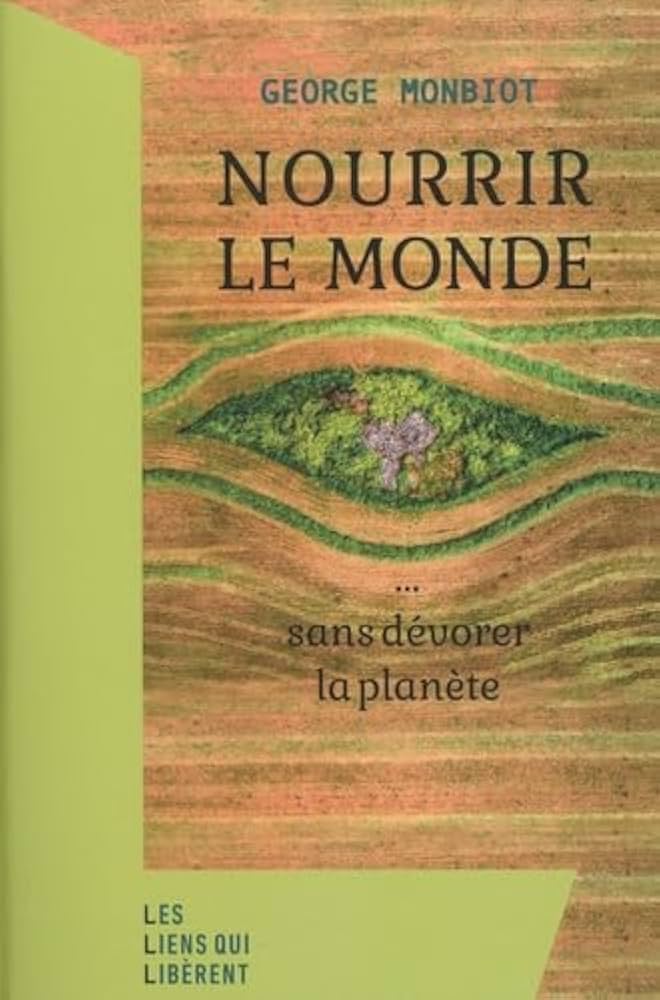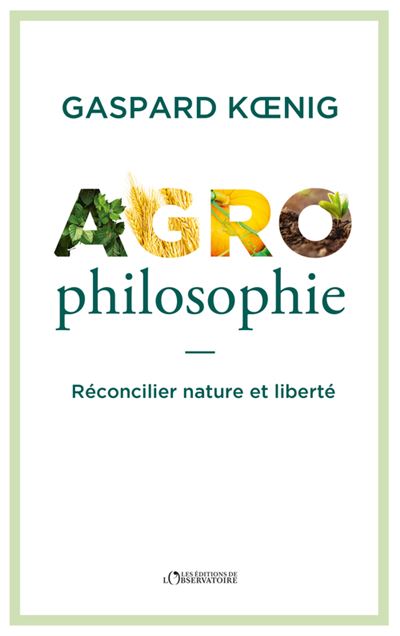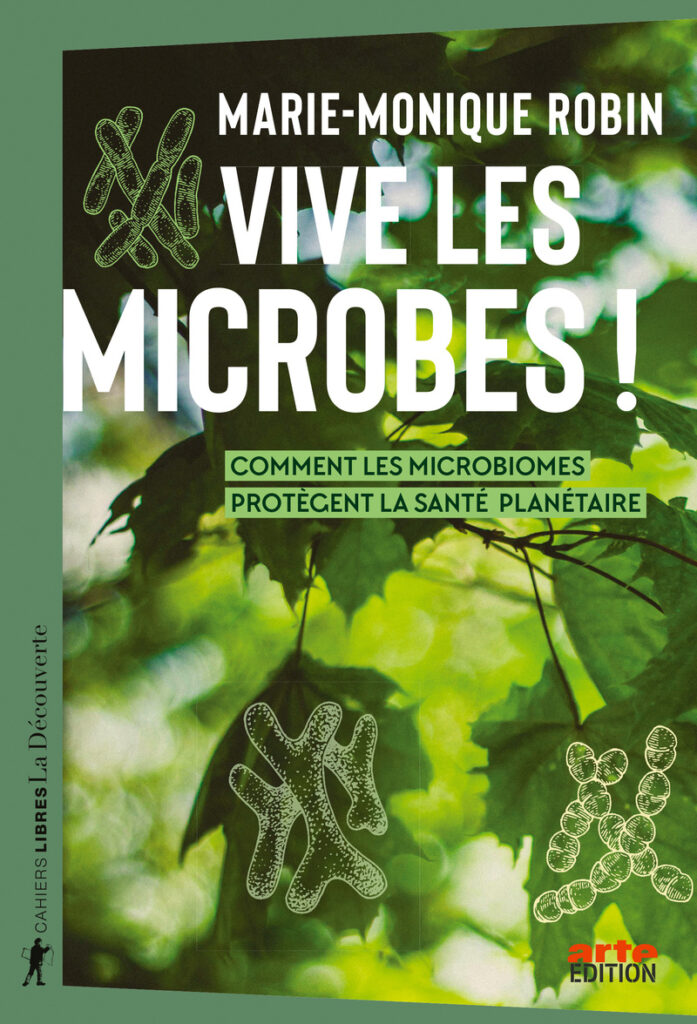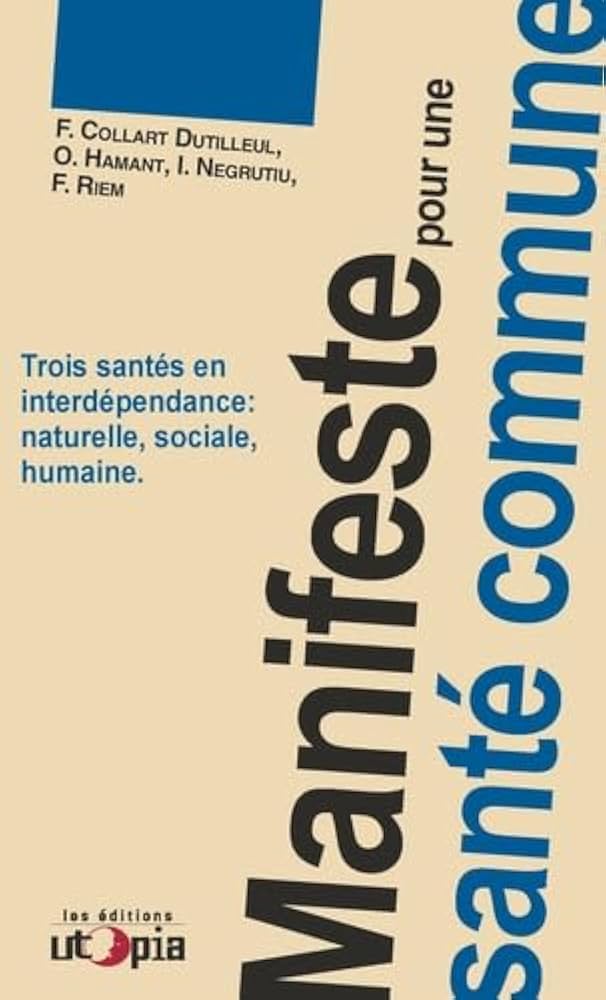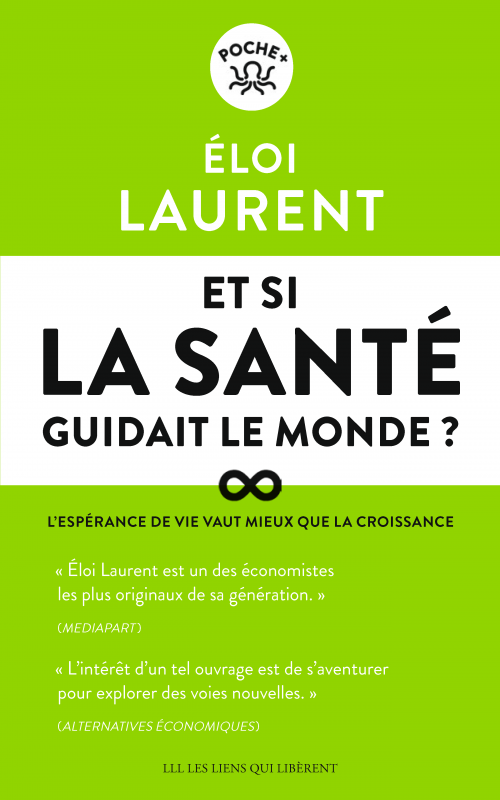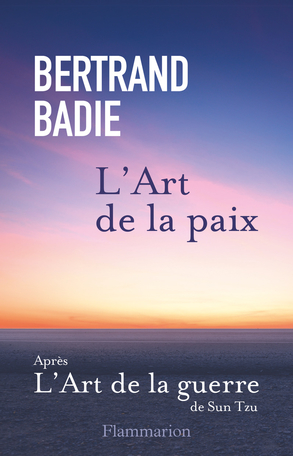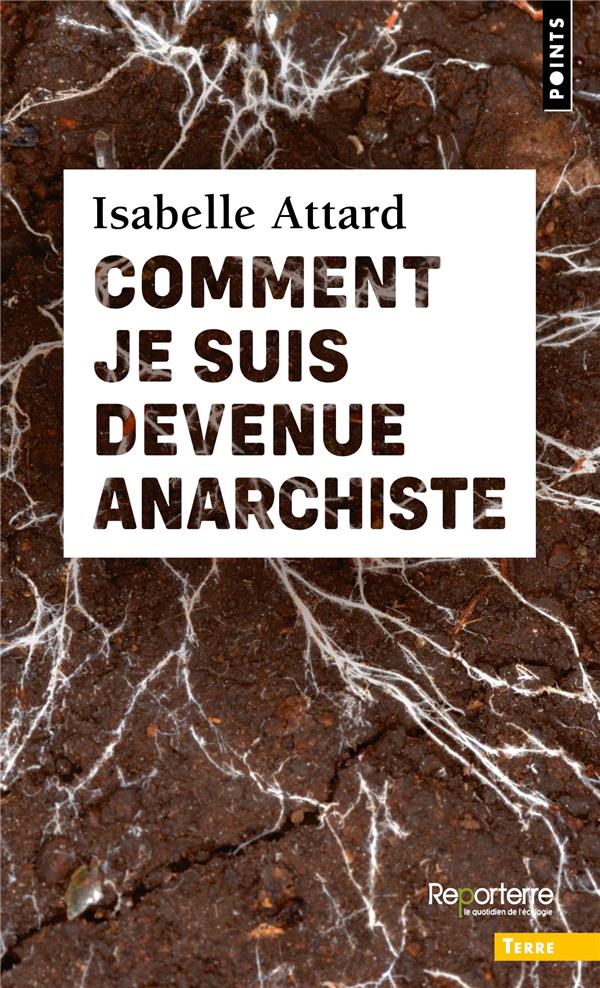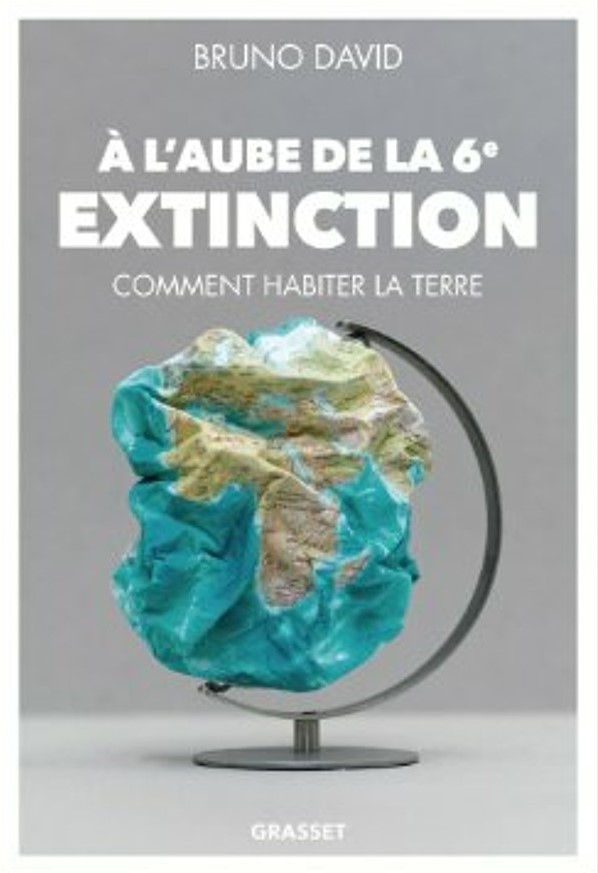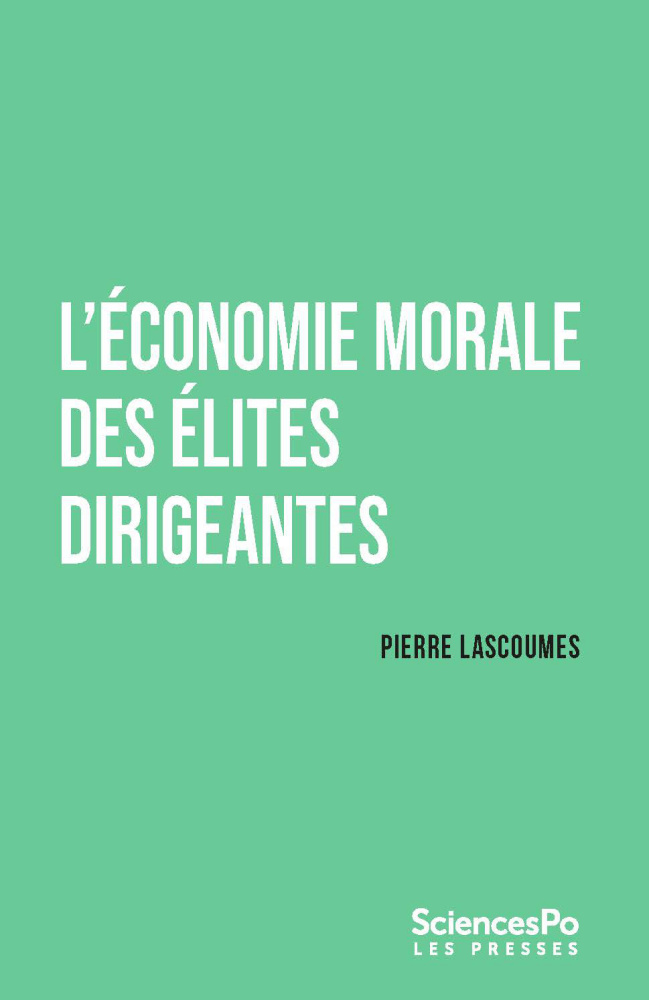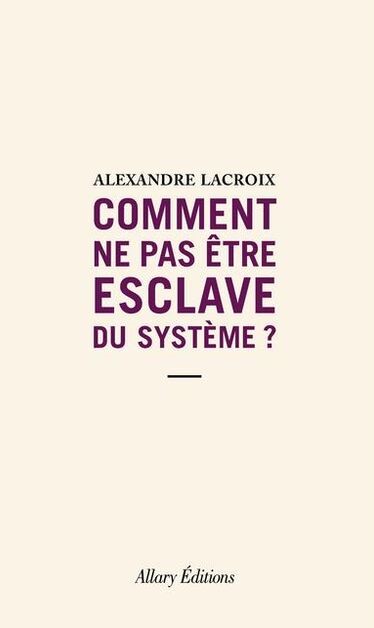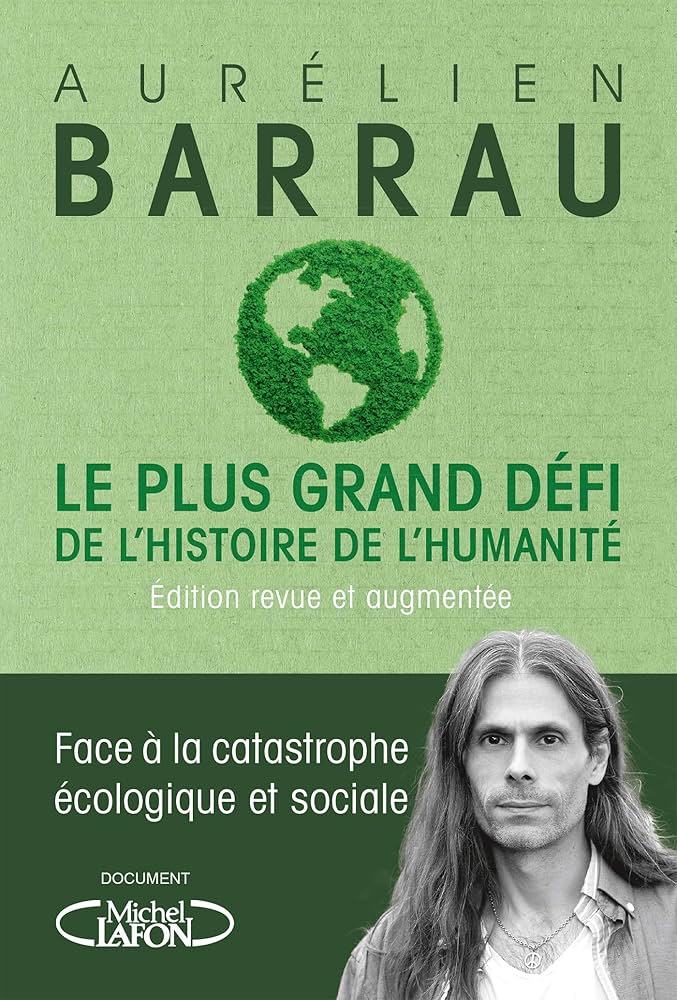David Graeber, Editions Les liens qui libèrent, 2013
« La dette est devenue le problème central de la politique internationale. Mais nul ne semble savoir exactement ce qu’elle est ni comment la penser ». Partant de ce constat, David Graeber, dont la spécialité première est l’anthropologie, mais qui maîtrise aussi l’histoire, l’économie… se lance dans l’écriture d’un ouvrage sur la dette « massif, foisonnant, érudit – le type d’ouvrage que personne n’écrit plus ». Avec l’objectif non pas de faire un livre très pointu scientifiquement, mais d' »utiliser les outils intellectuels dont disposait quelqu’un comme moi – historique ethnographique théorique – pour influencer le débat public sur des problèmes réellement importants ».
Difficile de résumer le foisonnement de ce livre qui part de cas très concrets pris à toutes les périodes de l’histoire et sur tous les continents, pour alimenter son analyse globale. Sans compter les ouvertures vers d’autres sujets que nous propose l’auteur dans le texte ou dans les notes (100 pages de notes).
L’auteur commence par démonter quelques mythes. Le mythe du troc, « le mythe fondateur de notre système de relations économiques ». Contrairement à ce que raconte l’histoire économique classique, le troc n’a pratiquement jamais été utilisé entre les habitants du même village. Quand il a été utilisé, c’est généralement entre des étrangers, voire des ennemis. Le fonctionnement de base, c’est la dette. Ce n’est que lorsque les groupes humains se sont élargis qu’est apparue la monnaie, principalement pour permettre aux souverains de payer leurs armées. « Les origines réelles de la monnaie sont à chercher dans le crime et le dédommagement, la guerre et l’esclavage, l’honneur, la dette et le rachat ».
Le mythe qui veut que l’Etat et le marché sont diamétralement opposés. « La réalité historique révèle néanmoins qu’ils sont nés ensemble et ont toujours été entremêlés ».
Il nous fait ensuite découvrir la théorie de la dette primordiale qui est « celle que doit l’être vivant à la continuité et à la durabilité de la société qui protège son existence individuelle » et convoque Nietzsche pour nous aider à comprendre le concept de rédemption, « l’acte de racheter quelque chose ou de récupérer ce qui a été donné en gage pour un prêt, d’acquérir quelque chose en remboursant une dette ».
« Faire l’histoire de la dette, c’est donc inévitablement reconstruire aussi la façon dont la langue du marché a envahi toutes les dimensions de la vie humaine – jusqu’à fournir leur terminologie aux voies morales et religieuses apparemment dressées contre lui ». Ce qui conduit l’auteur à faire un bref traité sur les fondements moraux des relations économiques.
« Historiquement les économies commerciales – les économies de marché comme nous aimons à les appeler aujourd’hui – sont relativement récentes. Pendant l’essentiel de l’histoire de l’humanité les économies humaines ont prédominé« . S’appuyant sur le cas de la traite des esclaves africains, l’auteur examine d’abord le rôle de la monnaie dans les économies humaines, puis montre « ce qui peut arriver quand ces économies sont soudain aspirées dans l’orbite de grandes économies commerciales ».
Un chapitre est consacré à l’invention des pièces de monnaie dans 3 lieux différents presque simultanément : en Chine du Nord, dans la vallée du Gange et autour de la mer Égée entre 600 et 500 avant Jésus-Christ. « Le lingot prédomine surtout dans les périodes de violences généralisées. Et cela pour une raison très simple les pièces d’or et d’argent se distinguent des accords de crédit par une caractéristique spectaculaire. On peut les voler. ».
David Graeber nous propose ensuite une analyse de l’évolution de la dette et de la monnaie sur 3 grandes périodes : l’âge axial qui va de 800 avant Jésus-Christ à 600 après Jésus-Christ, le Moyen Âge qui va de l’année 600 à l’année 1450, et l’âge des grands empires capitalistes de 1450 à 1971. À partir de 1971, date de l’abandon de la convertibilité du dollar en or décidée par Richard Nixon, l’auteur nous raconte le « début d’une ère encore indéterminée », ce qui fait l’objet du dernier chapitre. David Graeber ne conclut pas vraiment, mais il nous rappelle l’idée forte qui irrigue tout son livre. « L’argent n’est pas sacré. Payer ses dettes n’est pas l’essence de la morale. Ces choses-là sont des arrangements humains et, si la démocratie a un sens, c’est de nous permettre de nous mettre d’accord pour réagencer les choses autrement ».
Un ouvrage fascinant, extrêmement érudit, qui révèle « combien les dispositifs inventés par les humains pour organiser leur vie économique et politique avaient été multiples et diversifiées dans le passé »… et qui libère notre regard pour imaginer pour demain d’autres solutions que le fonctionnement actuel. « Ce livre est donc une histoire de la dette, mais il se sert aussi de cette histoire pour poser des questions fondamentales sur ce que sont ou pourrait être les humains et la société humaine ».