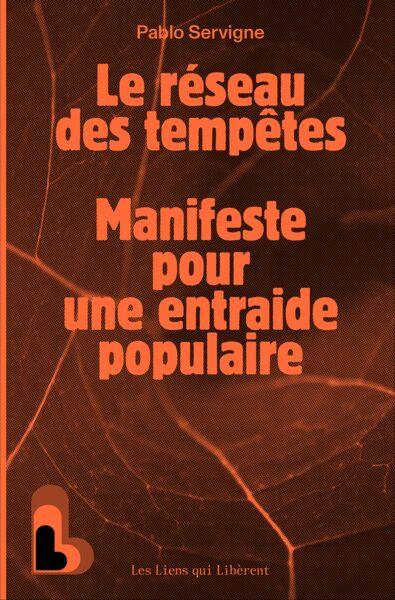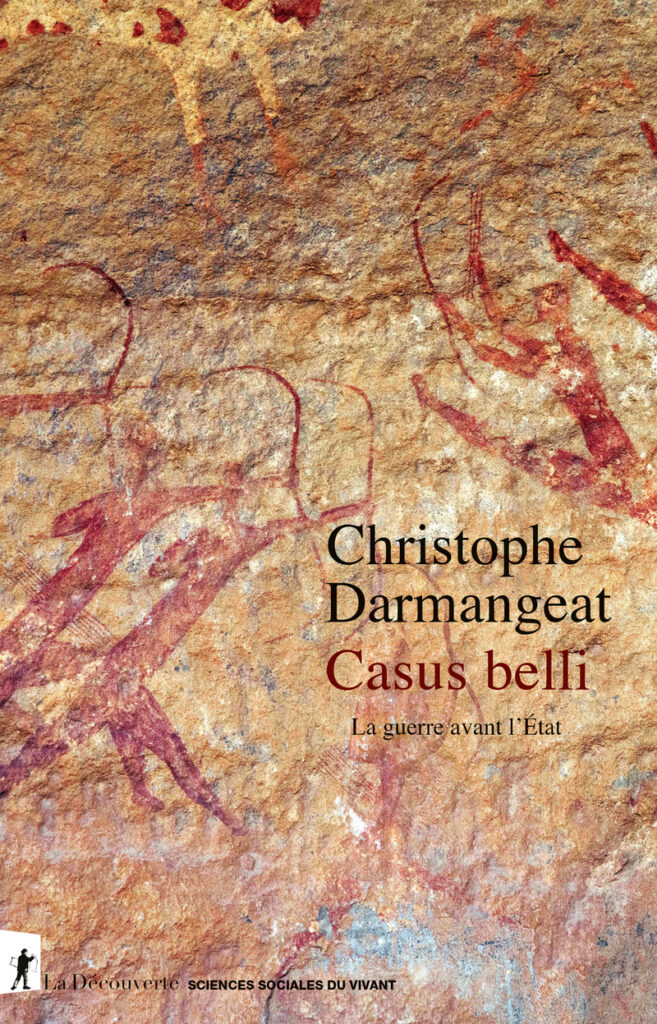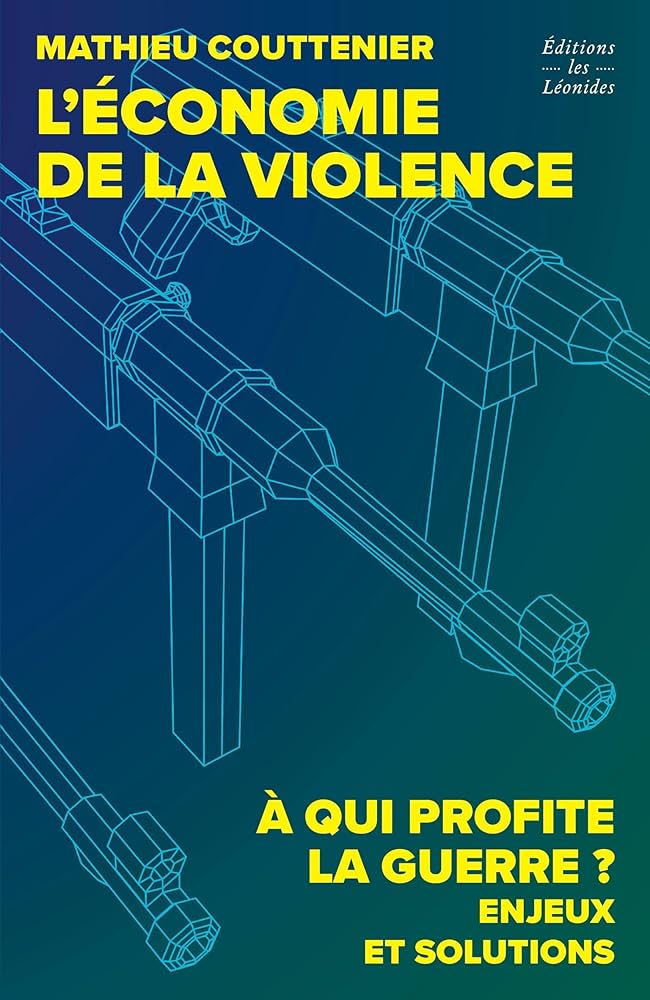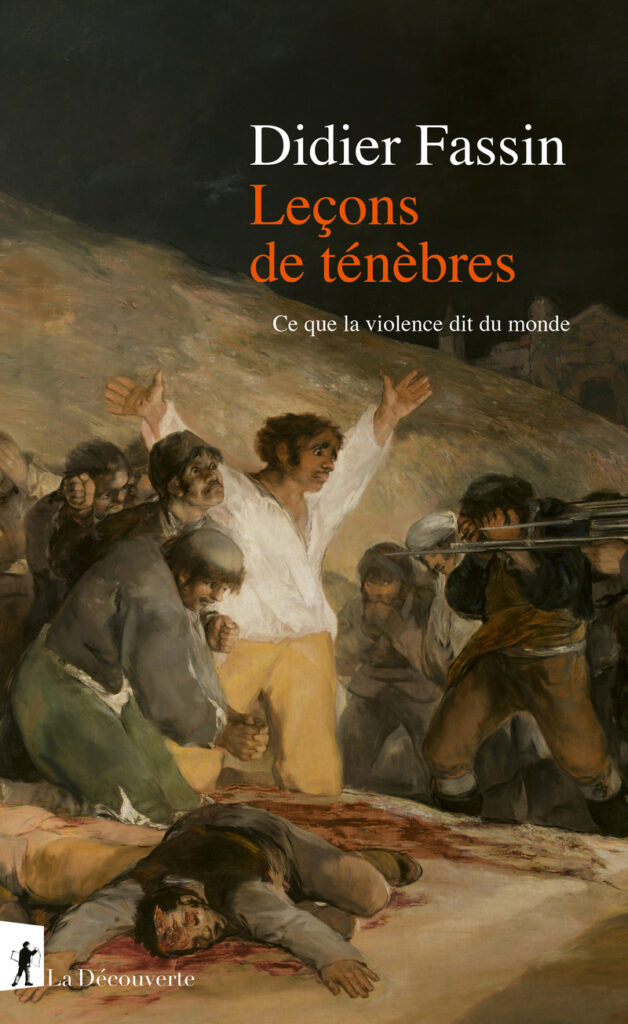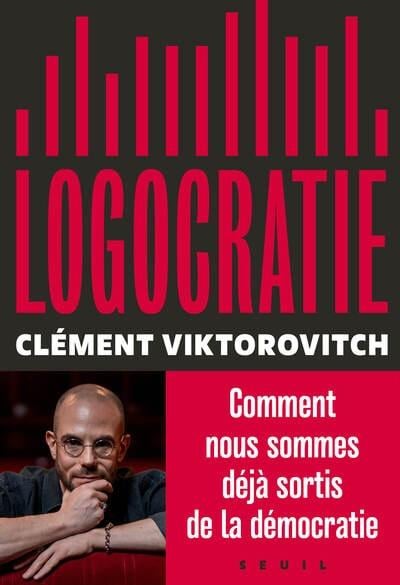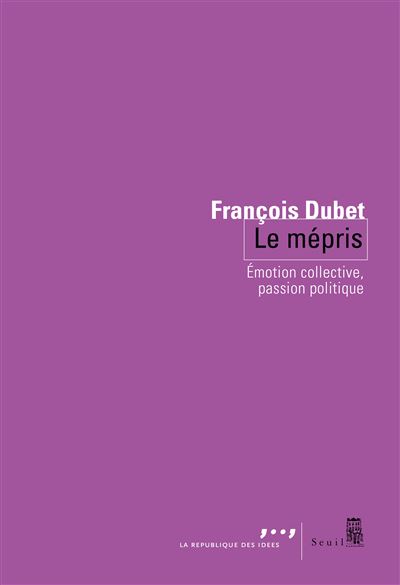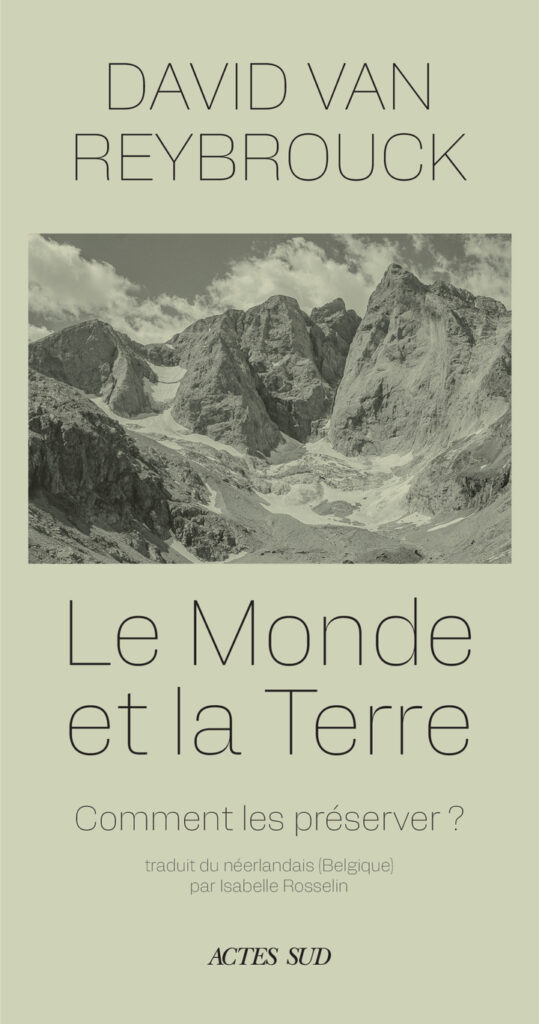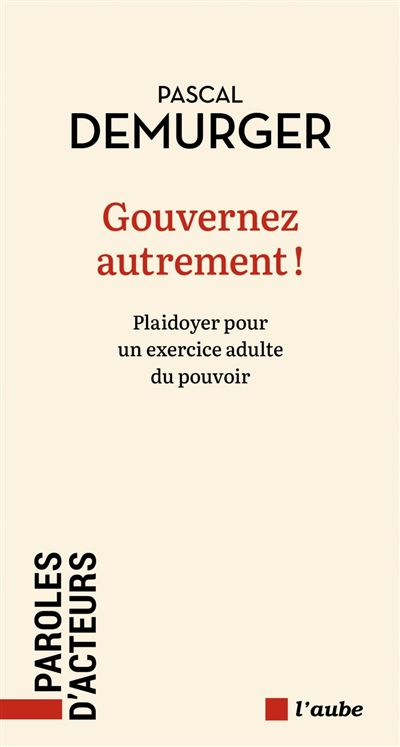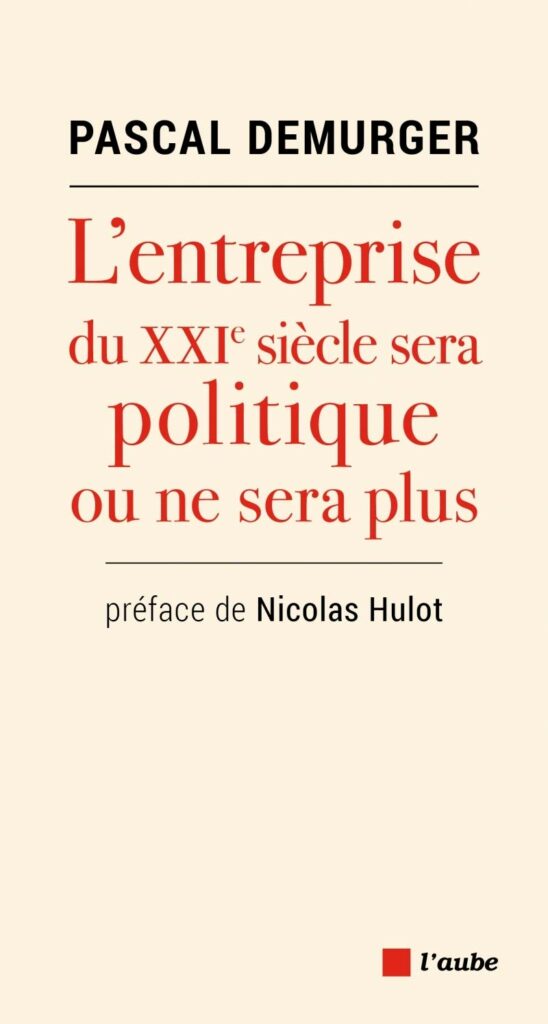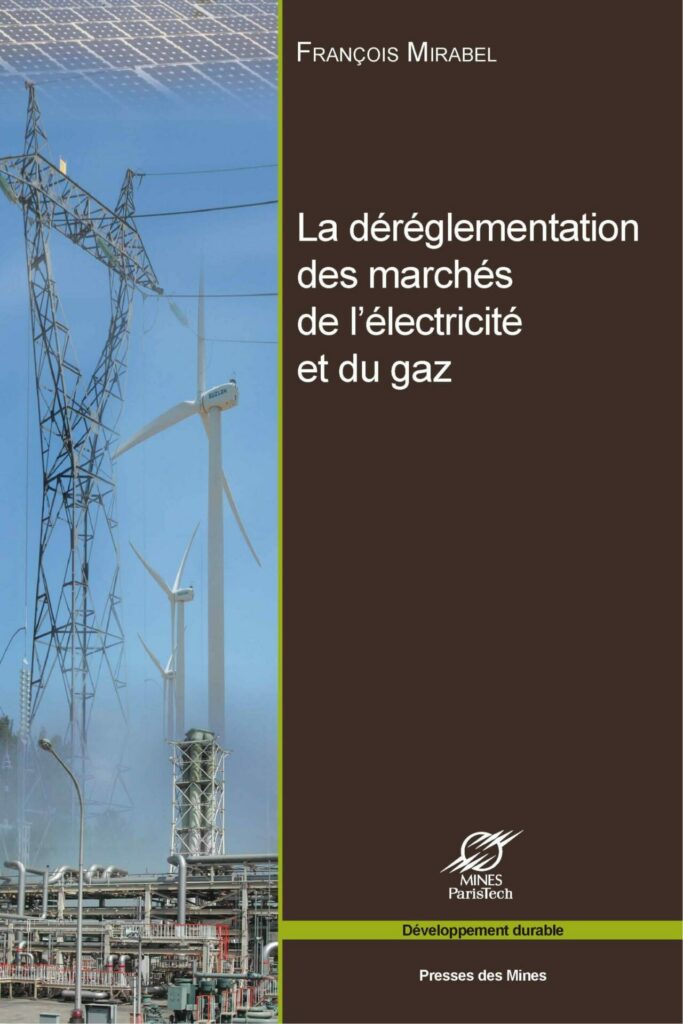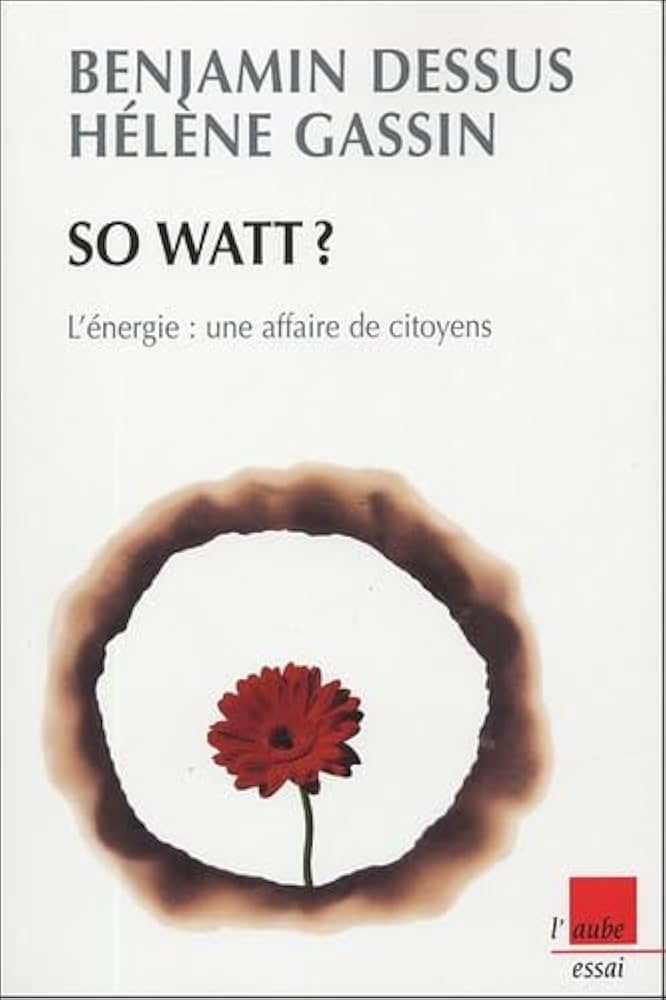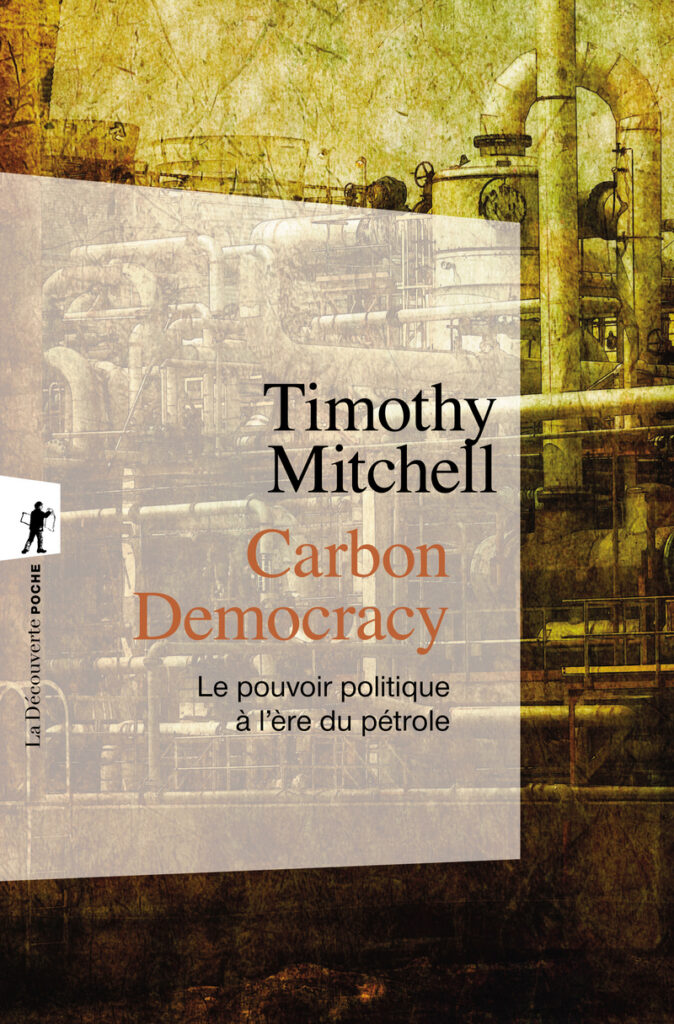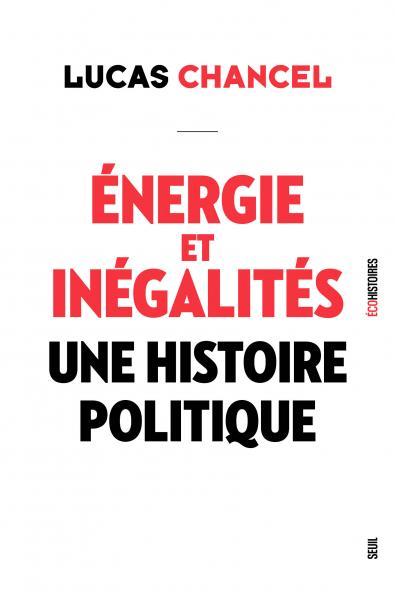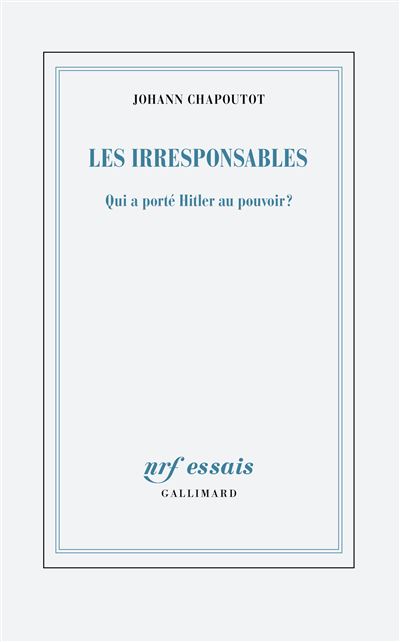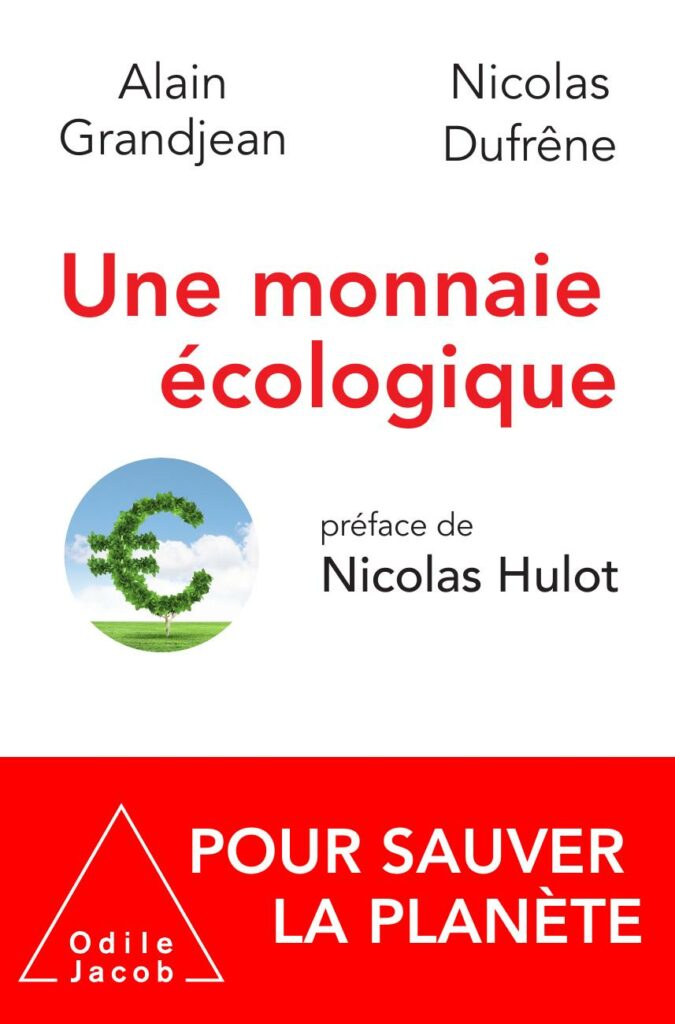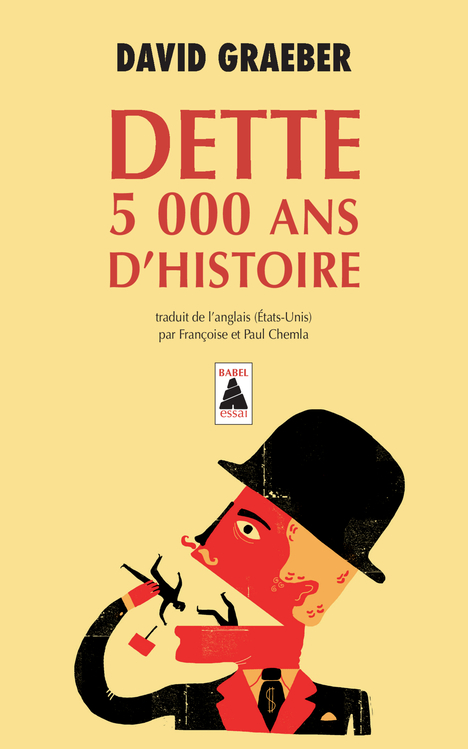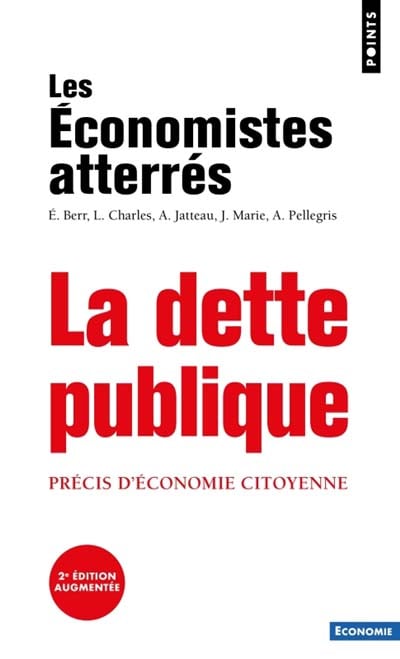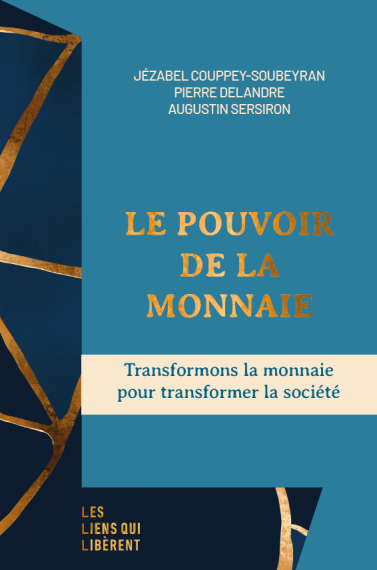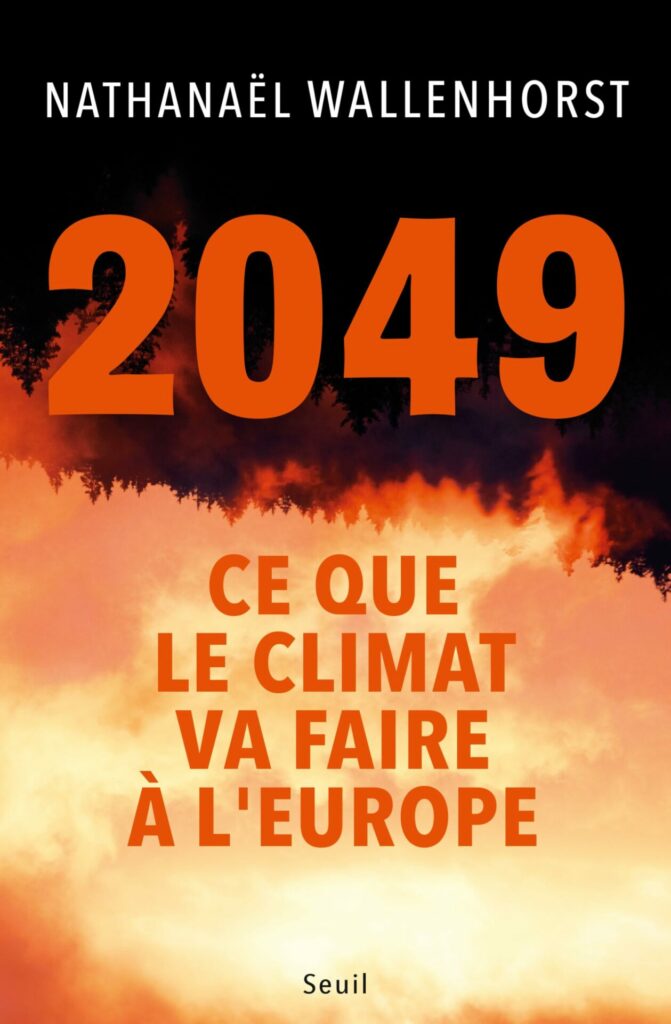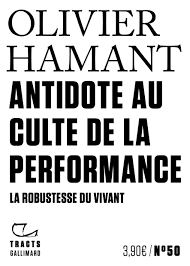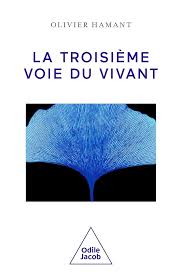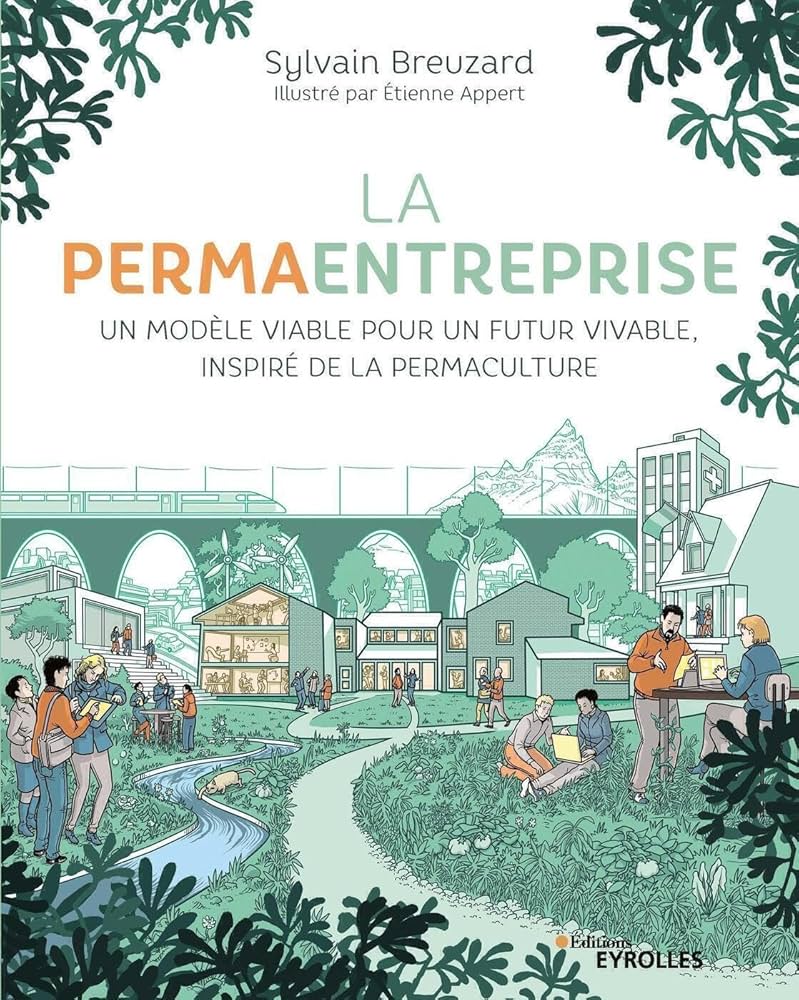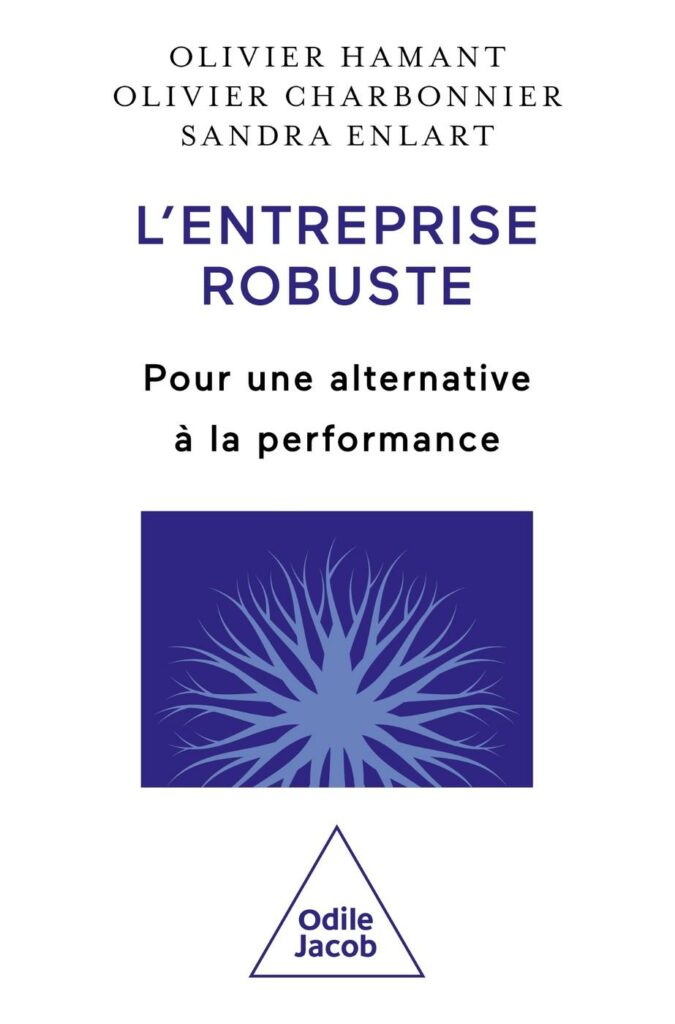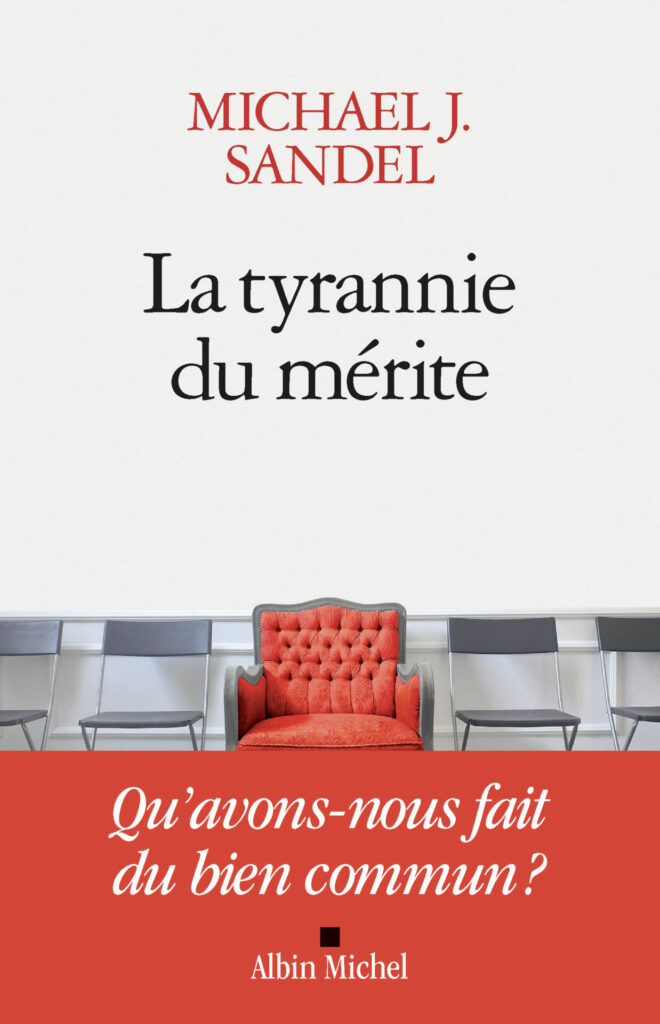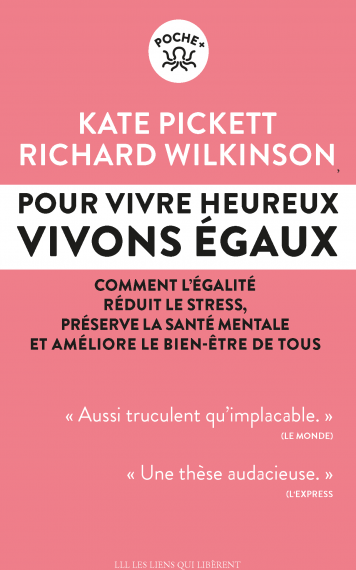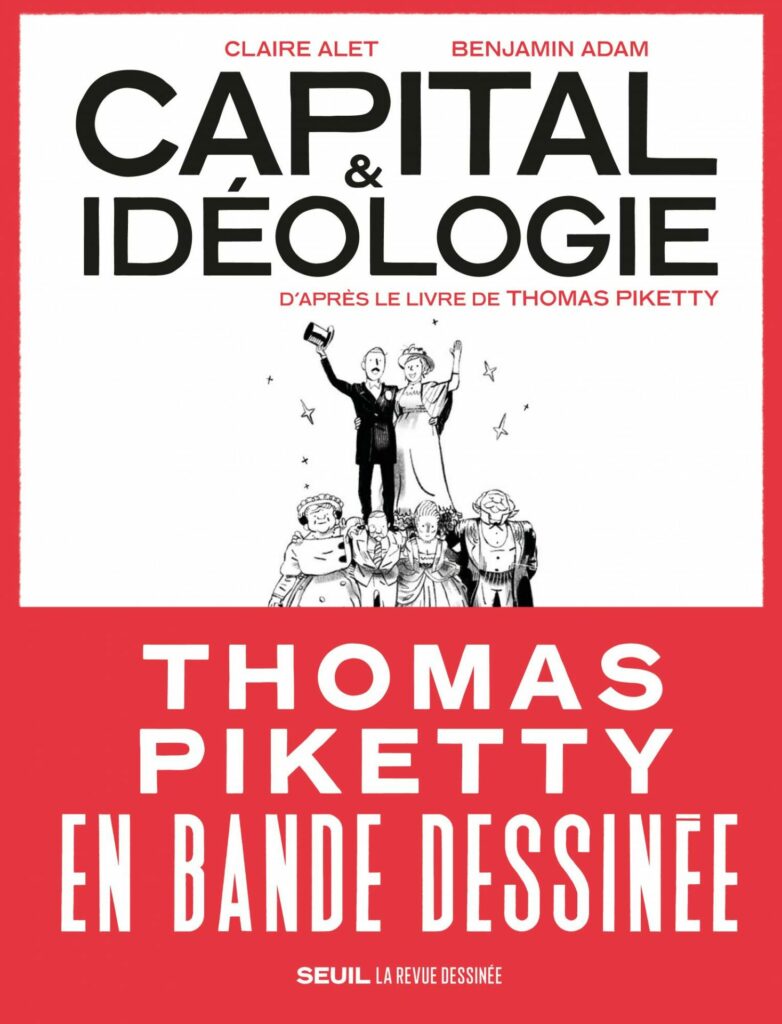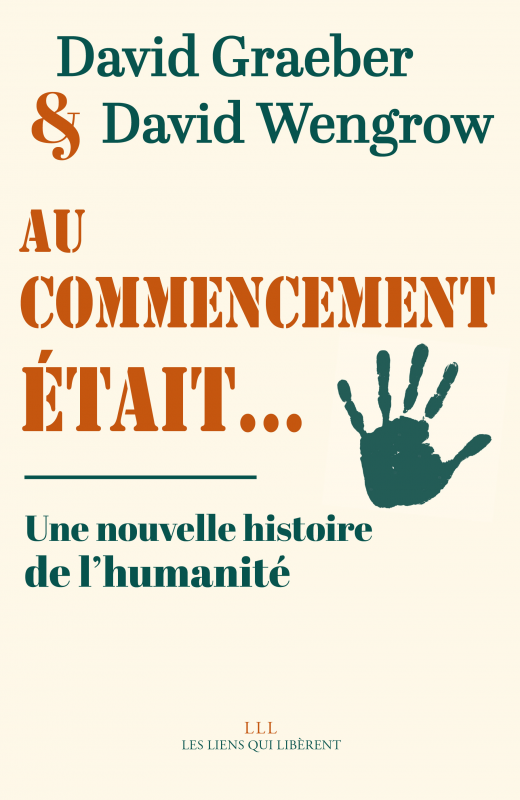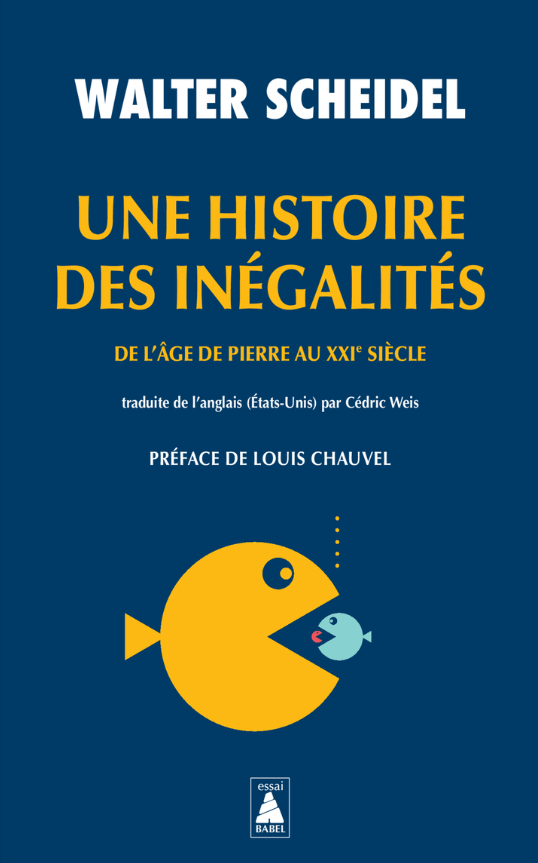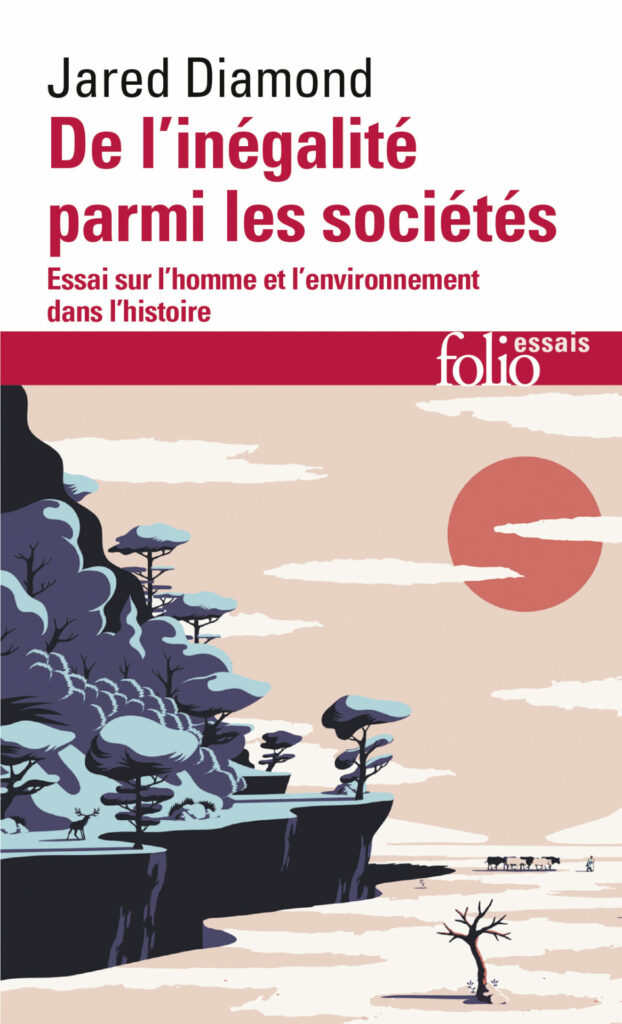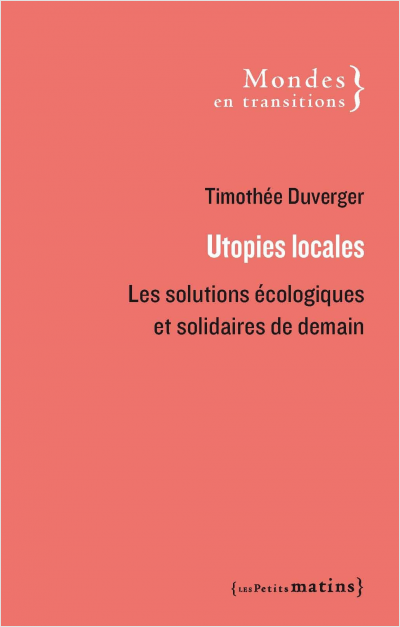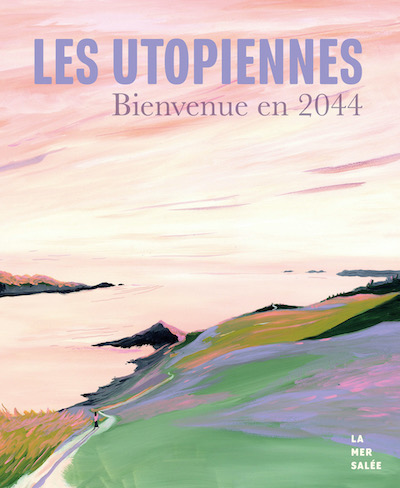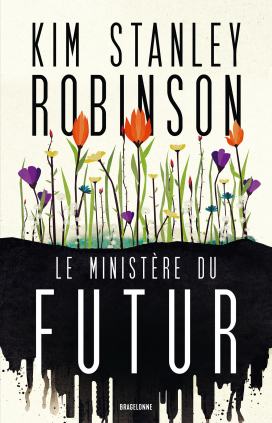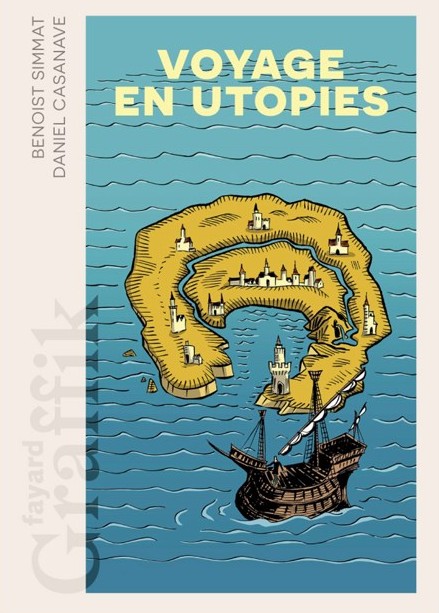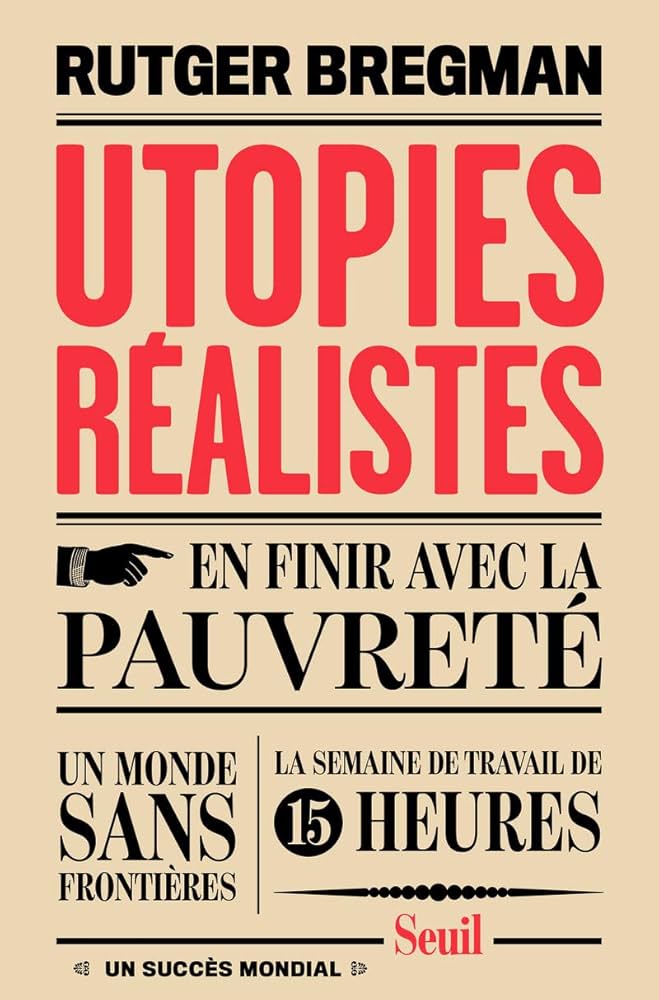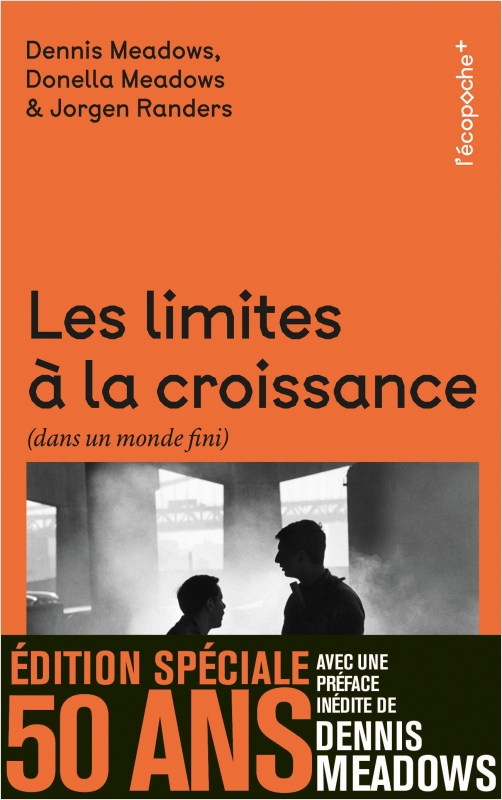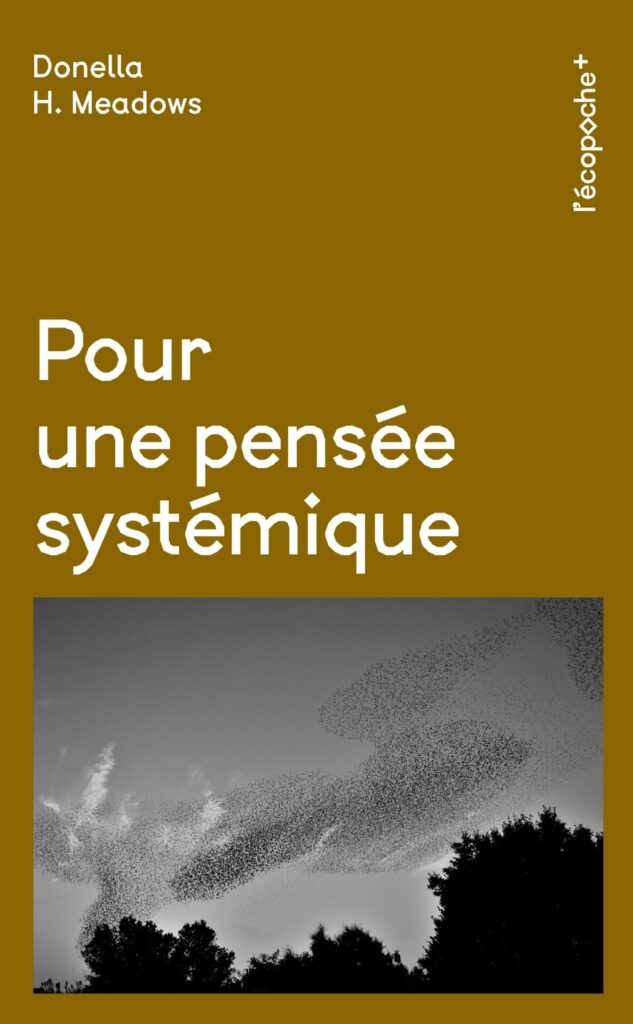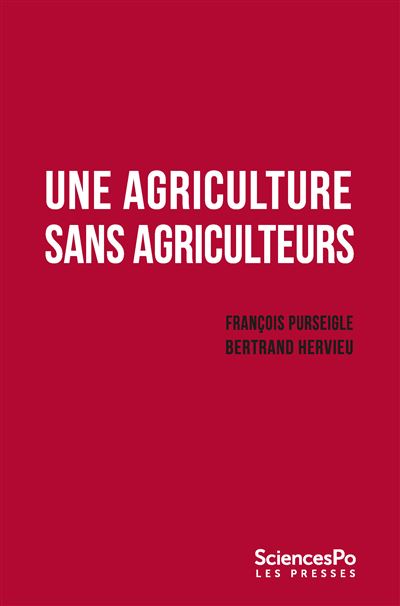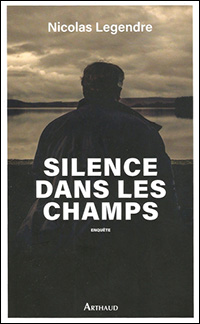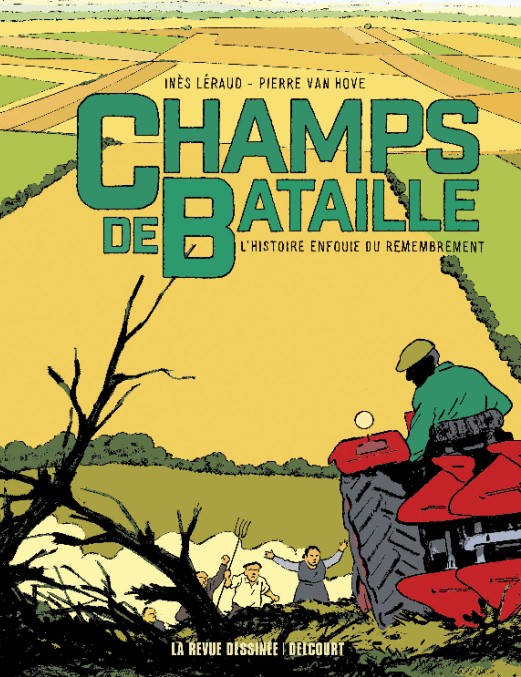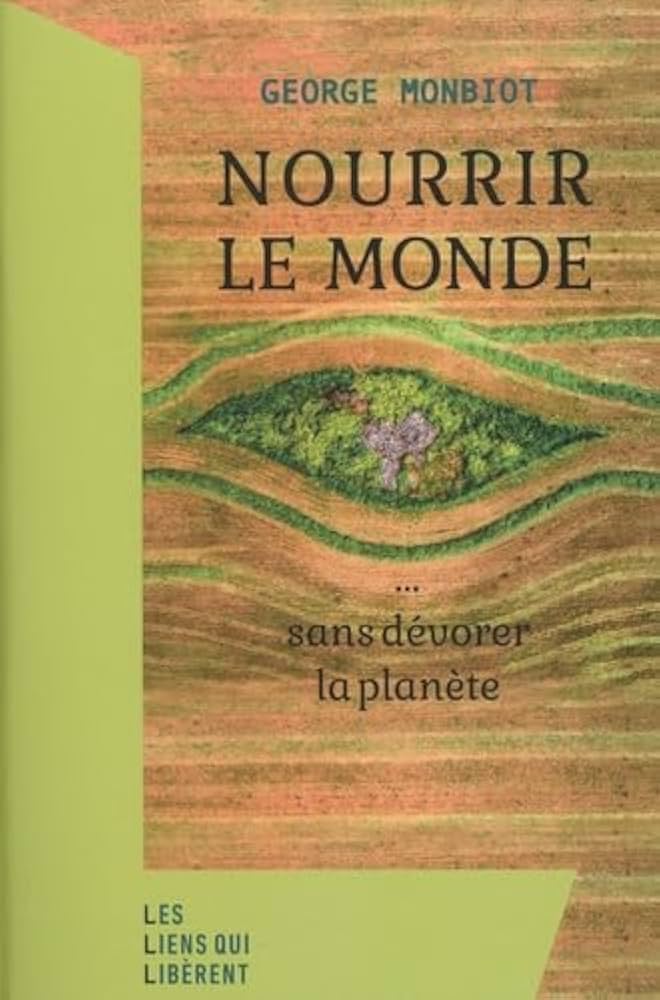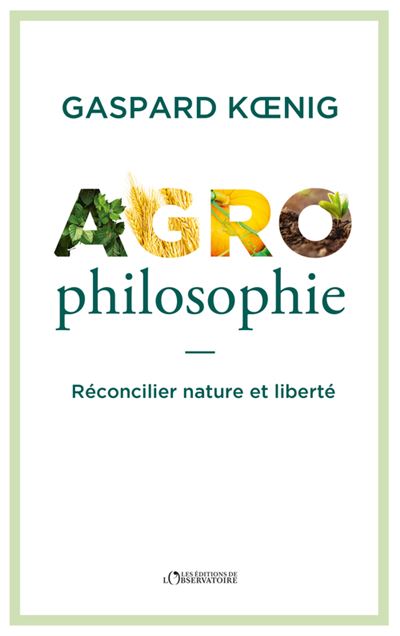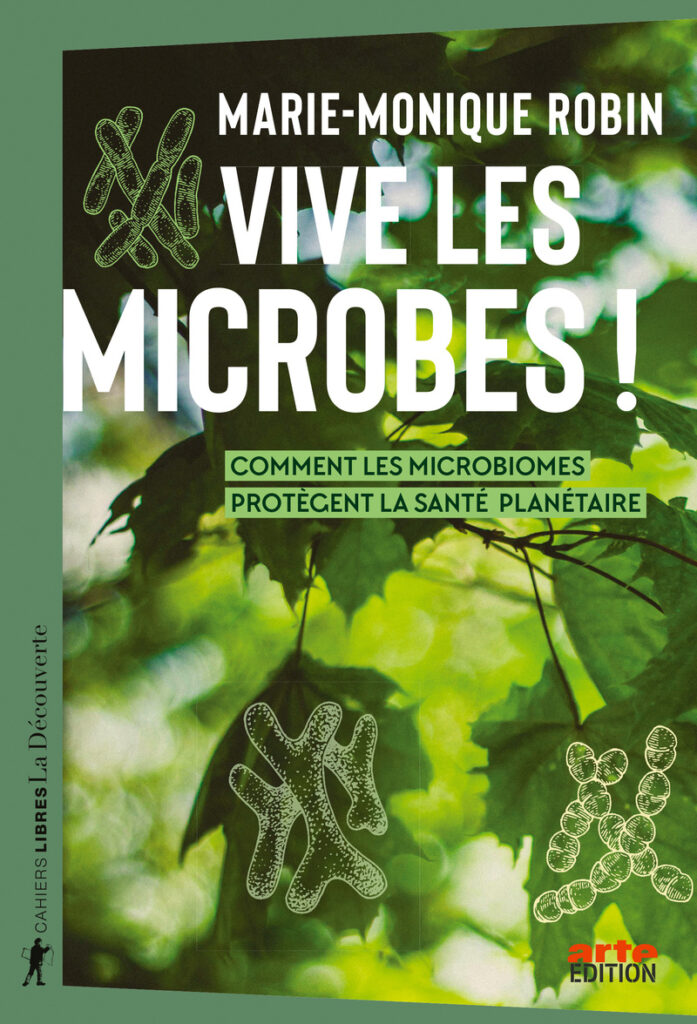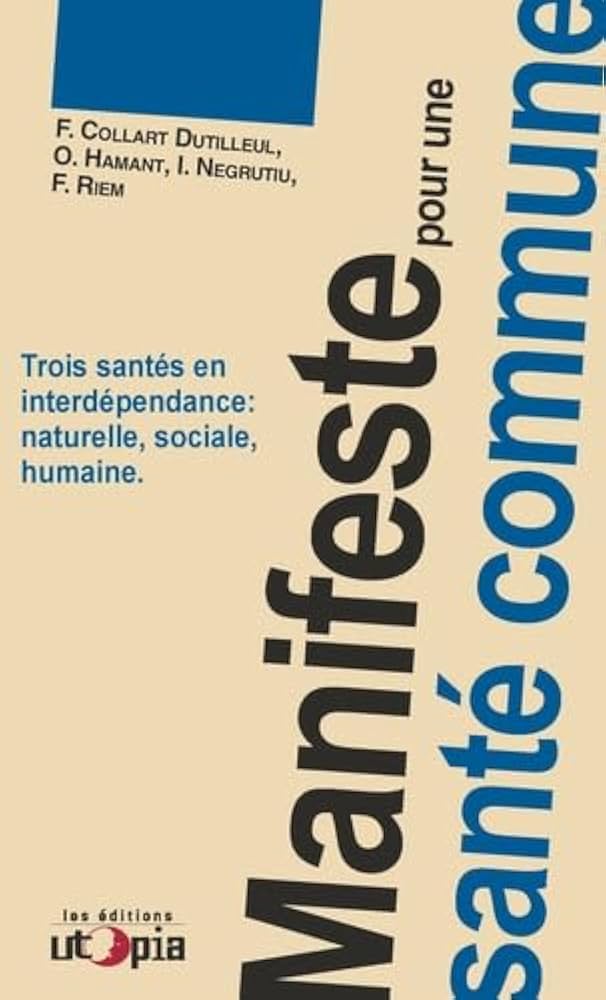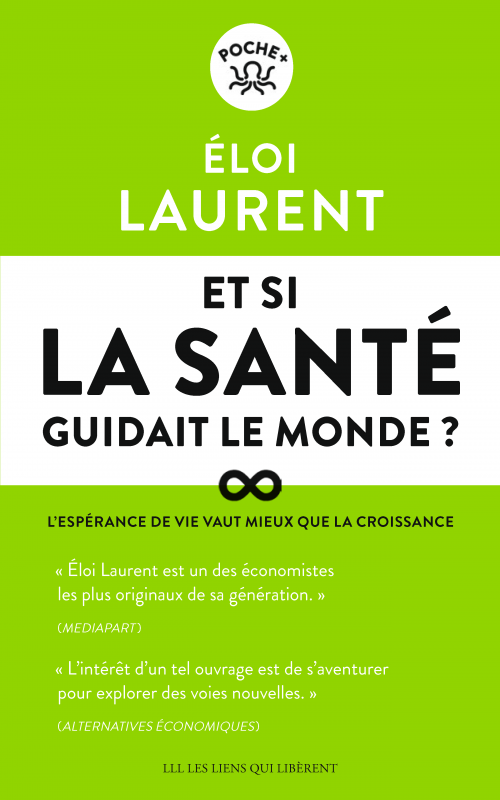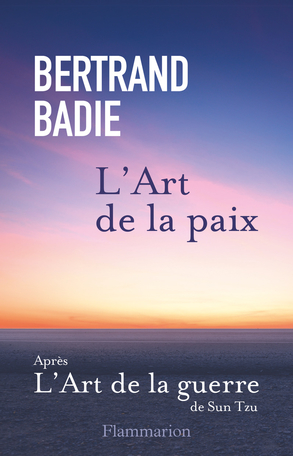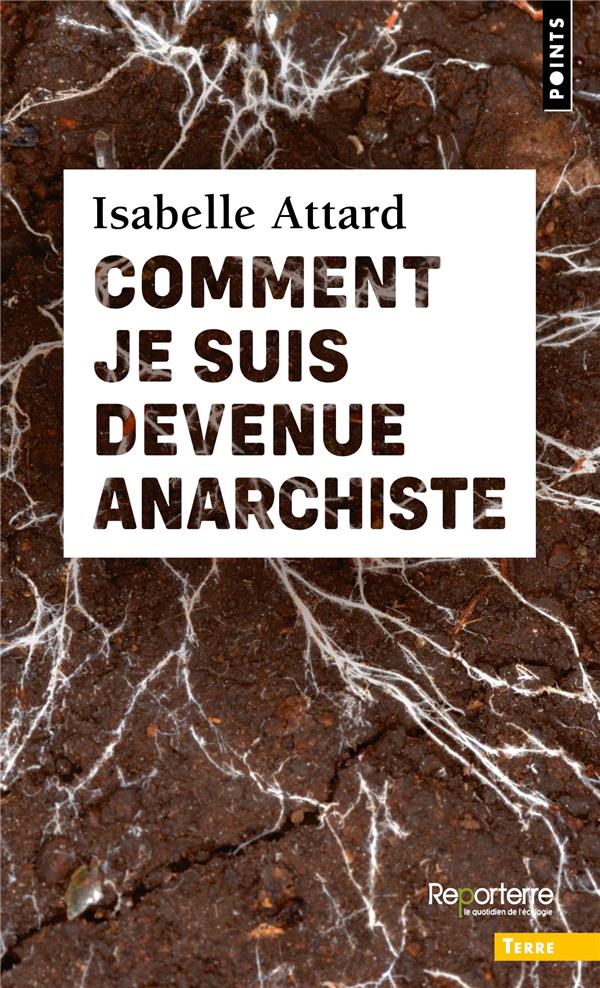Lucal Chancel, Editions du Seuil, 2025
« L’énergie n’est pas seulement une quantité physique, c’est un fait social, elle permet de répondre à des besoins humains et de démultiplier leur capacité à résoudre les problèmes auxquels ils font face, mais la contrôler n’est jamais neutre d’un point de vue politique ou économique ». C’est donc à un voyage dans les aspects techniques, mais aussi politiques et économiques de l’énergie au cours de l’histoire humaine que nous invite Lucas Chancel s’appuyant sur ses multiples compétences (formé à Sciences Po – où il enseigne, il est aussi ingénieur en Énergies Renouvelables et docteur en Sciences Économiques, membre de l’Ecole d’Economie de Paris). Avec un objectif, tenter de répondre à la question « Quelle latitude les sociétés humaines ont elles pour organiser leurs usages de l’énergie et quels enseignements pouvons-nous en tirer dans le cadre des débats contemporains sur la transition énergétique ?«
Après un premier chapitre qui établit quelques concepts clés sur l’énergie, le deuxième chapitre s’intéresse au concept de régime énergétique : « Un régime énergétique, c’est l’ensemble des dispositifs techniques, d’arrangements politiques, sociaux et économiques qui organisent la production, le transport, la conversion et l’utilisation de l’énergie pour fournir des services répondant aux besoins humains sur un territoire donné ».
L’auteur distingue ainsi les régimes énergétiques organiques, ceux qui ont existé pendant très longtemps utilisant principalement les ressources renouvelables issues du monde vivant (forêts, agriculture et élevage), des régimes énergétiques fossiles dans lesquels nous sommes depuis la découverte du charbon, du gaz et du pétrole. Et pour le futur, il s’agit de développer des régimes énergétiques écologiques qui reposent sur les ressources renouvelables issues du monde vivant, mais avec de nouvelles formes de transformation de l’énergie (solaire photovoltaïque par exemple), « ainsi que de nouveaux modes d’organisation permettant la sobriété dans l’usage des ressources ».
La réflexion sur les régimes énergétiques permet de faire le lien avec les inégalités : « Nous avons vu que la propriété de l’énergie n’est pas neutre vis à vis des usages et des technologies mobilisées : elle n’est donc pas neutre non plus du point de vue des inégalités sociales et environnementales associées à ses usages ».
L’auteur s’engage ensuite dans une analyse des régimes énergétiques au cours de l’histoire et de leur impact sur les inégalités, à commencer par « l’Eden égalitaire » entre la découverte du feu et la révolution néolithique. Le développement de l’agriculture et de l’élevage correspond au début des inégalités à travers la possession de la terre. « Le péché originel n’est pas la pomme croquée par Adam dans le jardin d’Éden, mais le carré délimité autour du premier hectare de blé planté et le fer forgé pour le défendre« . Au fur et à mesure que les surplus alimentaires fournis par l’agriculture et l’élevage, la possibilité pour les élites d’extraire de la richesse augmente et les inégalités potentielles. Toutefois, « Il existe et il a existé à travers l’histoire des sociétés de chasseurs–cueilleurs avec un degré relativement élevé de stratification sociale et des sociétés agraires avec des niveaux faibles d’inégalités ».
Jusqu’à la fin du 18ième siècle, l’énergie vient essentiellement de l’agriculture et de la coupe des bois. Malgré des innovations qui améliorent un peu les rendements par agriculteur, l’énergie disponible par habitant n’augmente que très lentement : 0,1 à 0,2 % par an, voire moins sur toute la période. Le contrôle de l’énergie se fait par la possession de la terre, ou par la maîtrise d’innovations comme les moulins banaux.
« En 1776, alors que Boulton et Watt produisent leurs premiers engins, la Grande-Bretagne a atteint les limites écologiques imposées par son régime énergétique organique : il n’y a plus assez de forêts pour se chauffer ». La machine à vapeur et le charbon vont donner une accélération forte à l’énergie disponible par habitant dans les pays riches d’Europe. Mais cette accélération n’aurait pas été possible sans les colonies qui fournissent matières premières, esclaves et débouchés. On assiste alors à un essor des inégalités à la fois entre pays riches (les colonisateurs) et les pays pauvres (les colonisés), mais aussi au sein des pays riches.
L’utilisation de combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz) va se généraliser dans le monde, mais avec une réelle diversité de trajectoires nationales « Si des contraintes physiques et économiques ont pesé sur les dynamiques observées les choix politiques ont été tout aussi déterminants pour bâtir les mix énergétiques et dessiner leurs trajectoires ». L’auteur détaille ainsi la voracité énergétique du capitalisme étasunien, le régime fossile et nucléaire en France, les trajectoires énergétiques en Chine et en Inde…
Les choix politiques, c’est aussi de définir qui possède la puissance, le public ou le privé. Chaque pays a son histoire, mais on constate globalement une première période privée, suivi d’une socialisation dans la première moitié du 20e siècle (nationalisations en France et en Angleterre après la Seconde Guerre mondiale), avec un retour progressif au privé depuis les années 80. « Si la propriété publique ne garantit pas en tant que tel un usage responsable des ressources énergétiques tout laisse à penser que la propriété privée ne fait qu’aggraver les tendances lourdes à l’inconséquence collective, tout en permettant une plus forte concentration des richesses.
Les ressources fossiles sont bien évidemment liées au changement climatique. « Nous gagnons tous d’une manière ou d’une autre à l’usage des fossiles, mais force est de constater que ces gains sont très inégalement répartis comme les pertes qui sont associées à leur pollution ». De fait, le changement climatique généré par la combustion des fossiles génèrent des inégalités socio économiques très importante que l’auteur détaille. Et « l’approche qui a longtemps été dominante consistant à faire porter le gros des responsabilités des émissions sur les consommateurs individuels est une impasse ».
« Une décroissance radicale des consommations d’énergies fossiles et d’autres flux de matière est nécessaire pour empêcher le chaos climatique« . Ce constat génère immédiatement une réflexion sur PIB et sa croissance ou sa décroissance. « Débat d’intérêt pratique relativement limité » nous dit Lucas Chancel. Il faut « penser la transition au–delà du PIB », c’est-à-dire « Mettre en avant le bien–être et la prospérité collective et décrire des conditions de la décroissance matérielle (fossiles, usage des sols etc…) et les croissances sectorielles (notamment celles des liens sociaux ou des services publics comme la santé, l’éducation ou l’accès à l’énergie) qui rendent possible la prospérité dans un monde fini ».
Quel peut être le rôle de la planification dans cette transition ? L’auteur analyse en détail la démarche de planification industrielle à grande échelle de la Chine qui lui permet de dominer la production mondiale de technologies renouvelables, en nous rappelant que « l’essentiel des outils de politique industrielle mis en œuvre en Chine a été développé en Europe et aux États–Unis au cours du 20e siècle notamment dans le secteur de l’énergie. Il n’y a donc pas d’incompatibilité entre planification de l’énergie et démocratie, ni de fatalité à ce que la Chine domine seule l’industrie décarbonée au 21e siècle ».
L’ouvrage se termine par une réflexion prospective sur énergie et démocratie au 21e siècle : « Qui va financer et contrôler le capital énergétique dans les années à venir ? Qui capturera les rentes générées par les nouveaux usages de l’énergie ?« . Après avoir analysé différents modèles de propriétés des technologies de la transition énergétique et des solutions pour financer cette transition énergétique, l’auteur conclut que « Face à une vision autoritaire ou ultra capitaliste de la transition, ou les intérêts privés écraseraient les autres, une diversité de modèles est envisageable et ne tient pas de l’utopie : il est possible de puiser dans la richesse des formes historiques de contrôle des systèmes énergétiques », richesse que l’on a pu découvrir tout au long de l’ouvrage.
Un ouvrage passionnant, s’appuyant sur de nombreuses données présentées de manière très graphique, qui permet de bien comprendre le double sens du mot « power » : la puissance énergétique, mais aussi le pouvoir. « Le futur de l’énergie ne relève pas que de choix entre source d’énergie, usages ou technologies. C’est aussi un choix sur le mode de propriété sur la gouvernance des actifs énergétiques et donc sur notre capacité à en faire un bien commun ». Et l’on voit bien l’intérêt de revenir à une plus forte implication du public dans la gestion de l’énergie. « Socialiser l’énergie au 21e siècle est donc un moyen de renforcer la démocratie à l’heure où elle est dangereusement remise en question ».
Un ouvrage de référence.