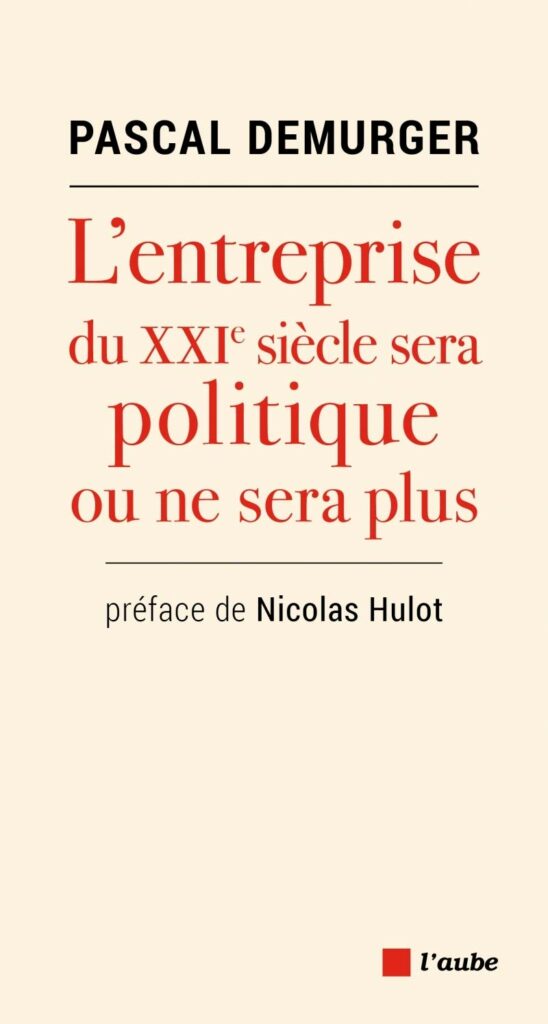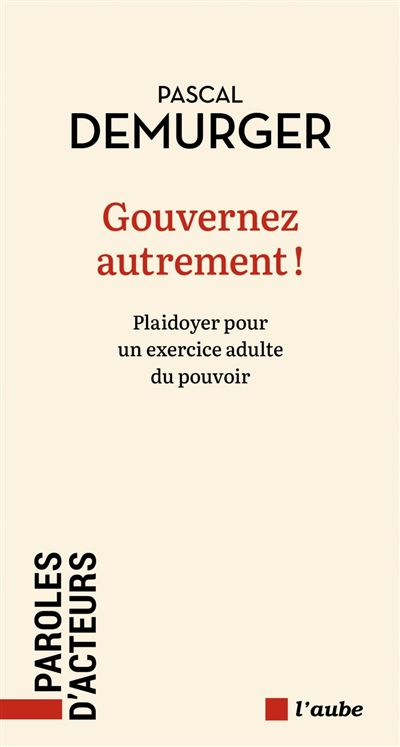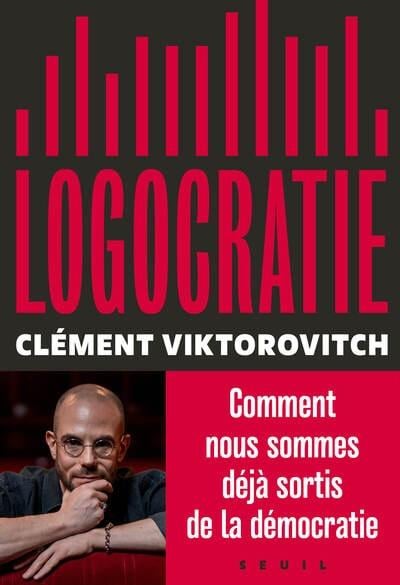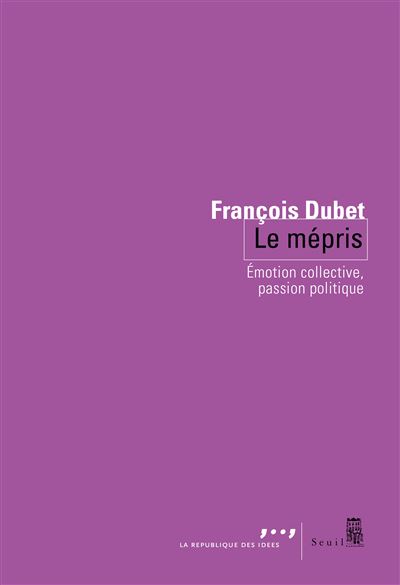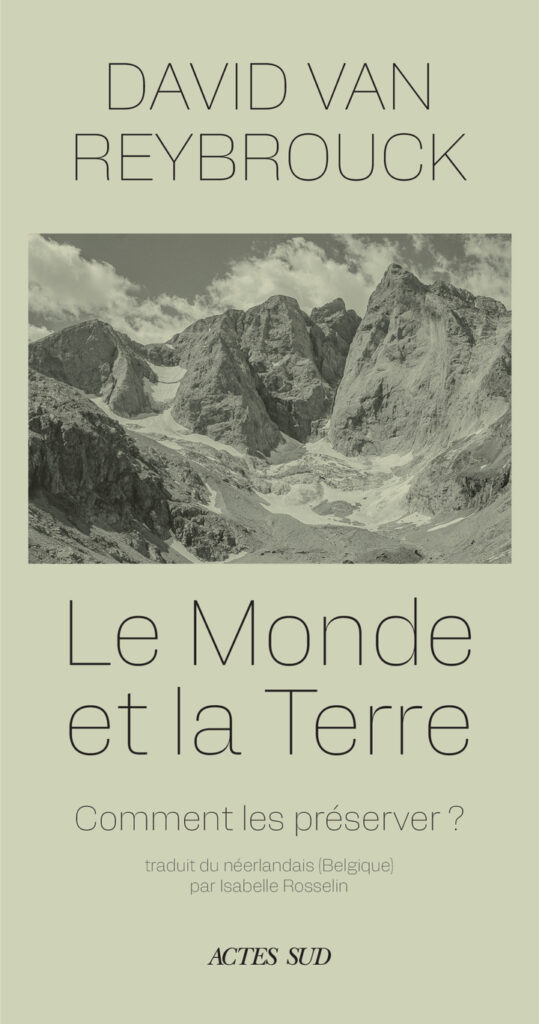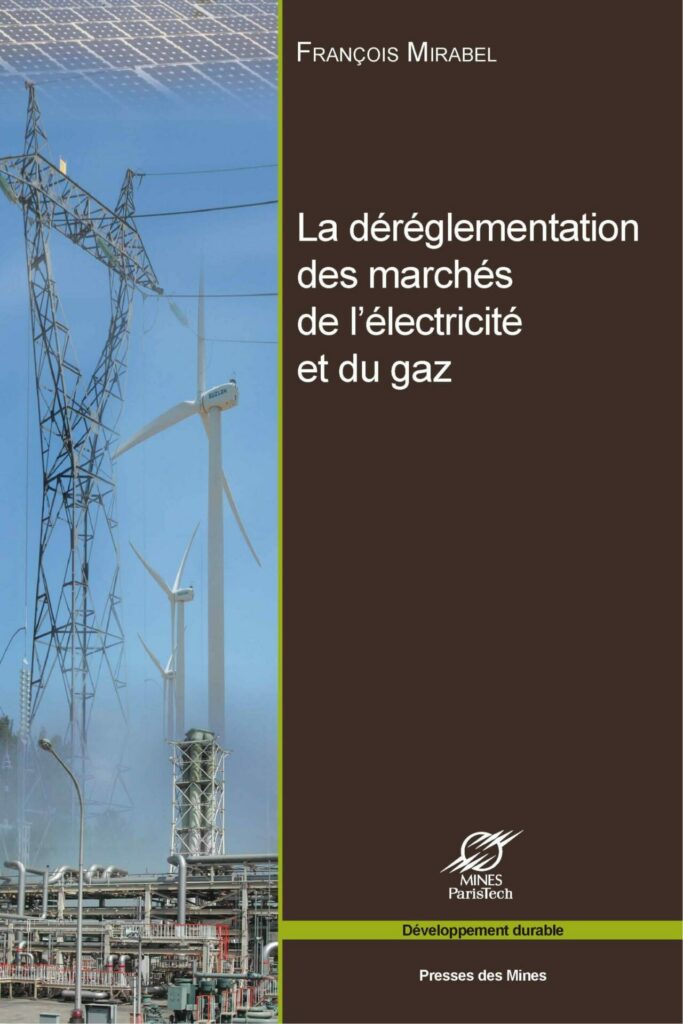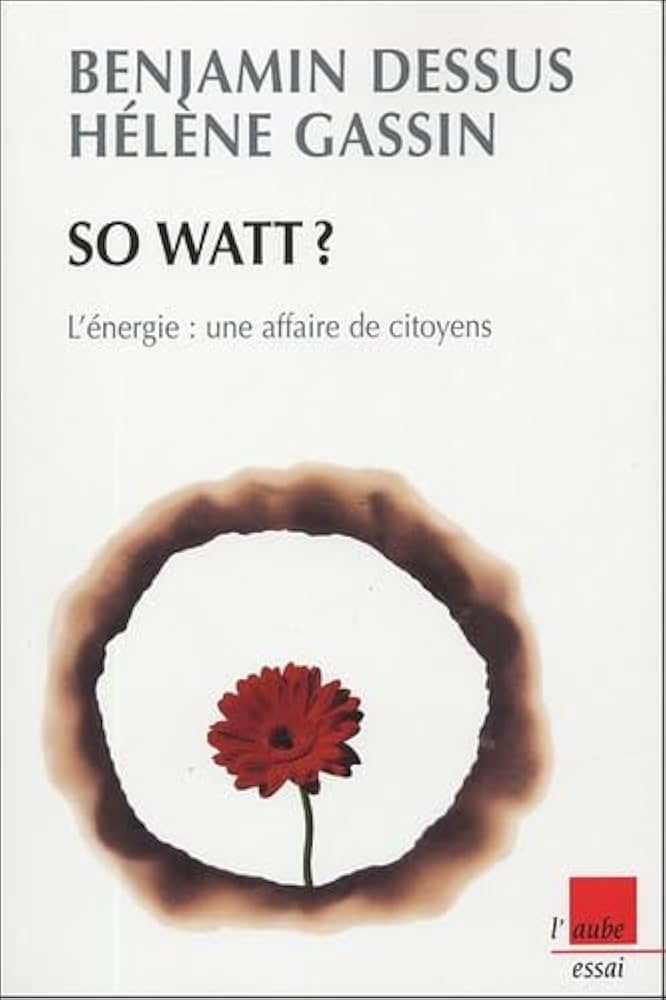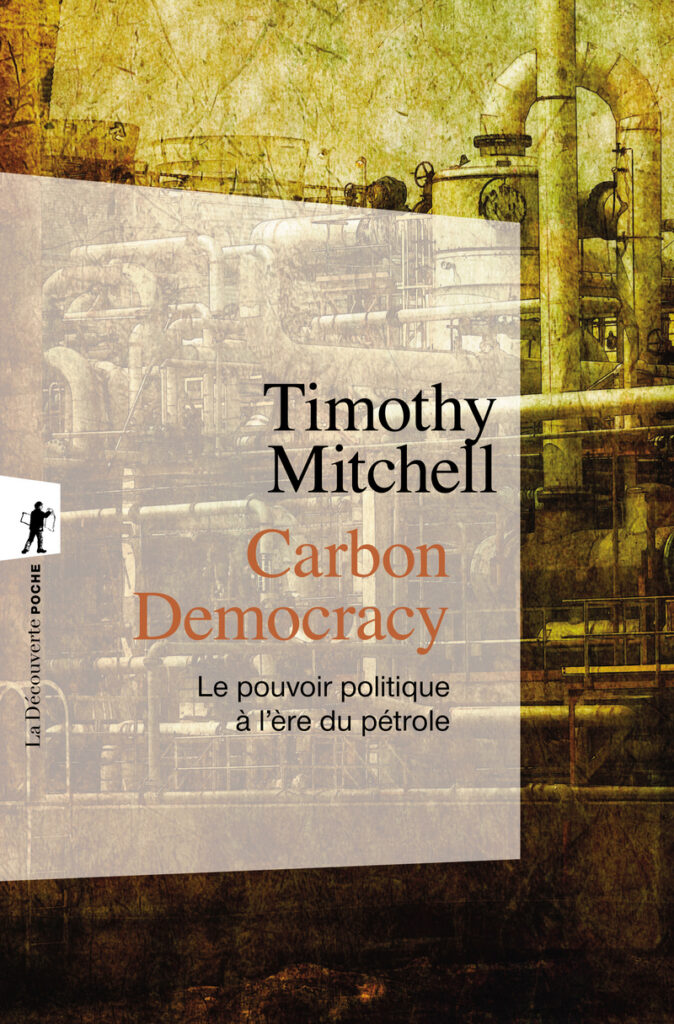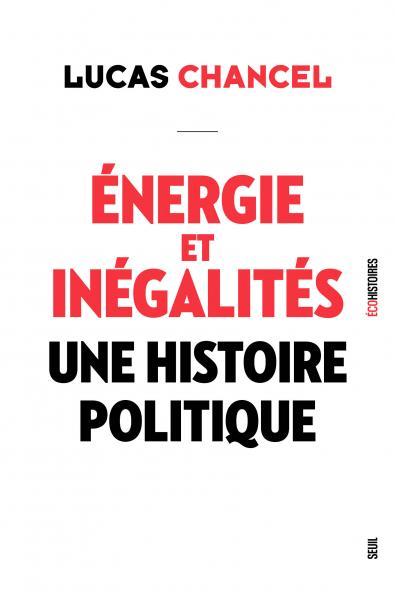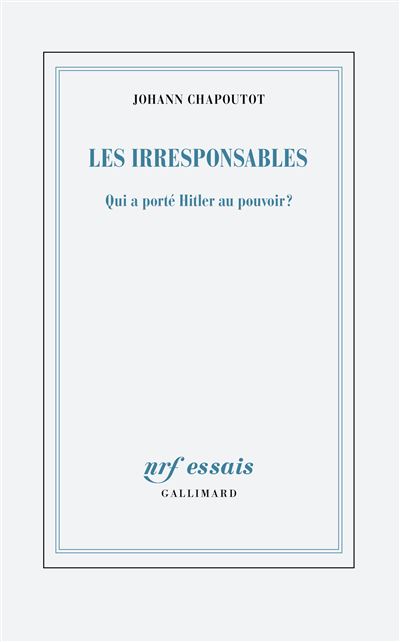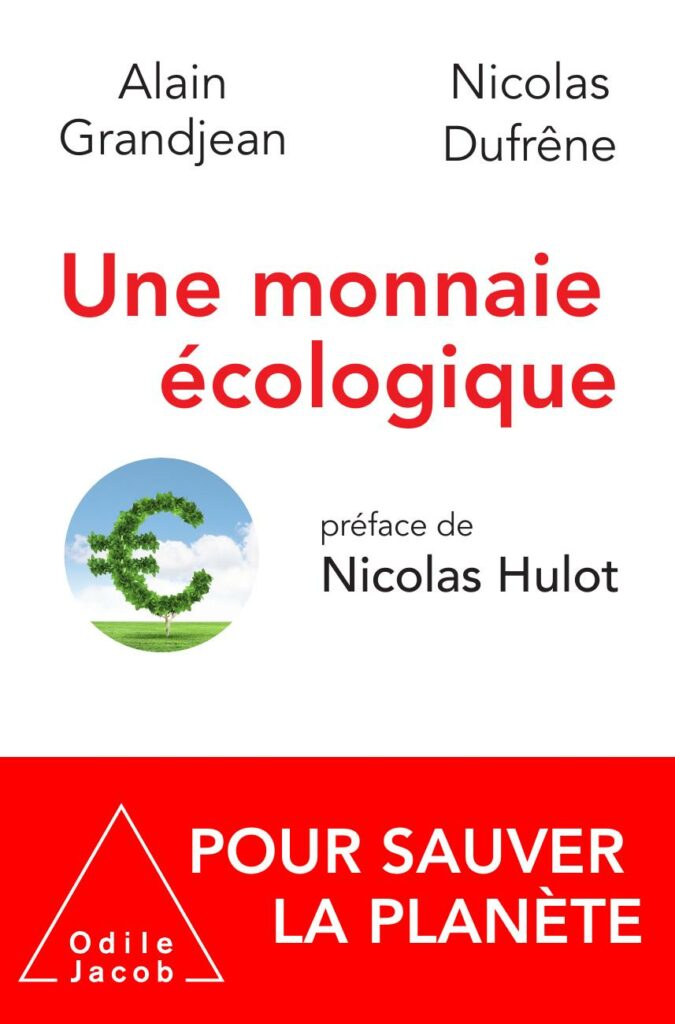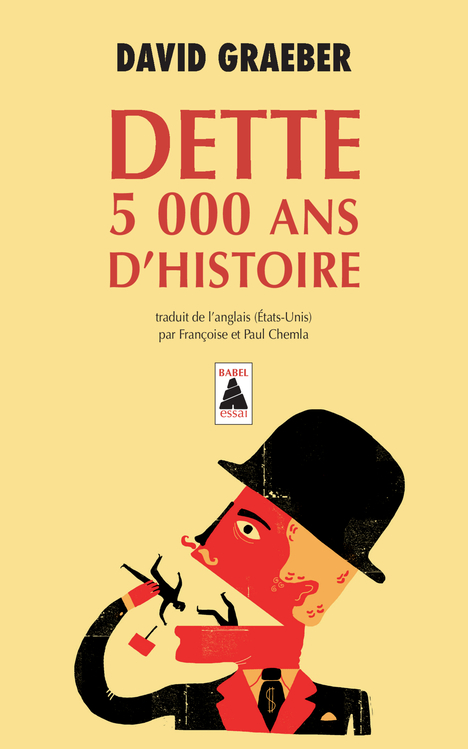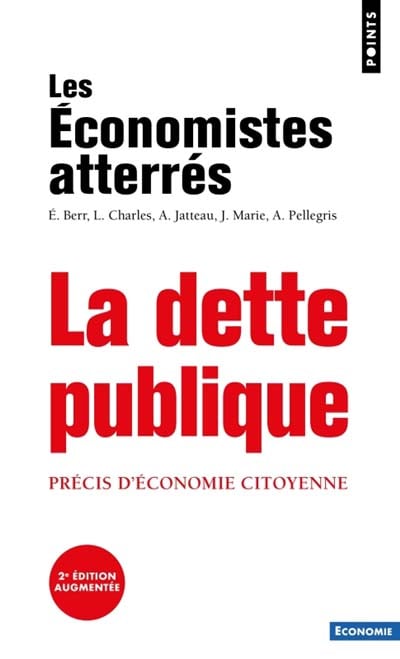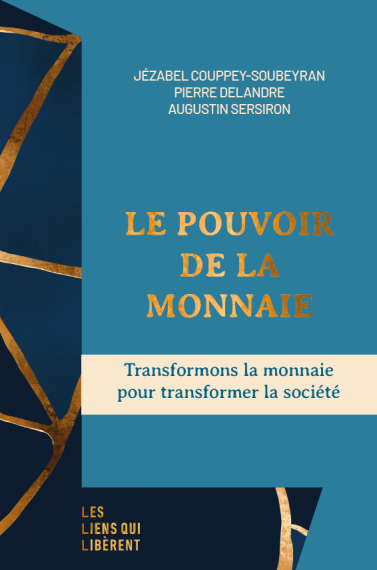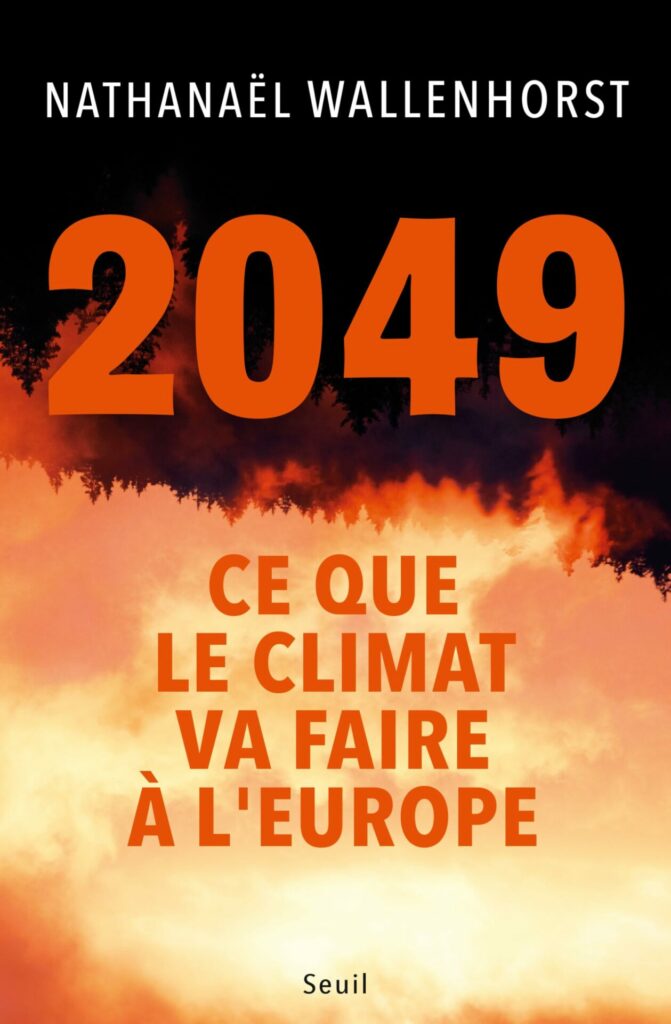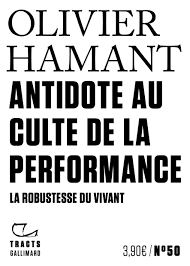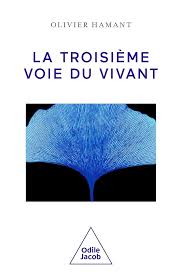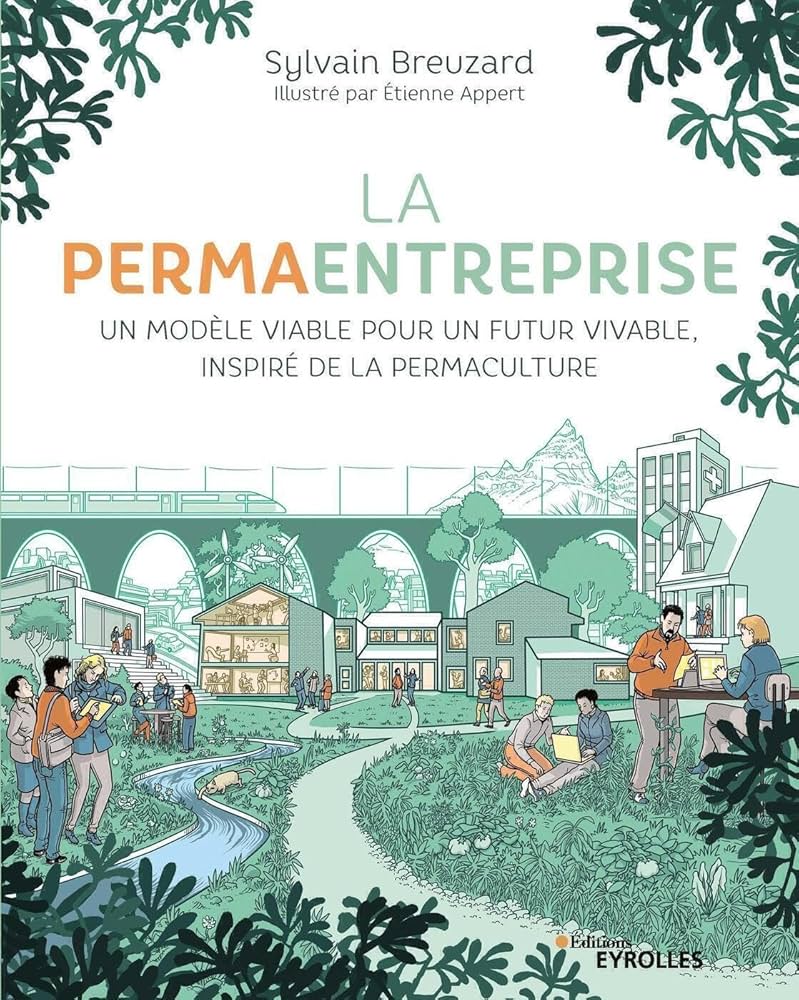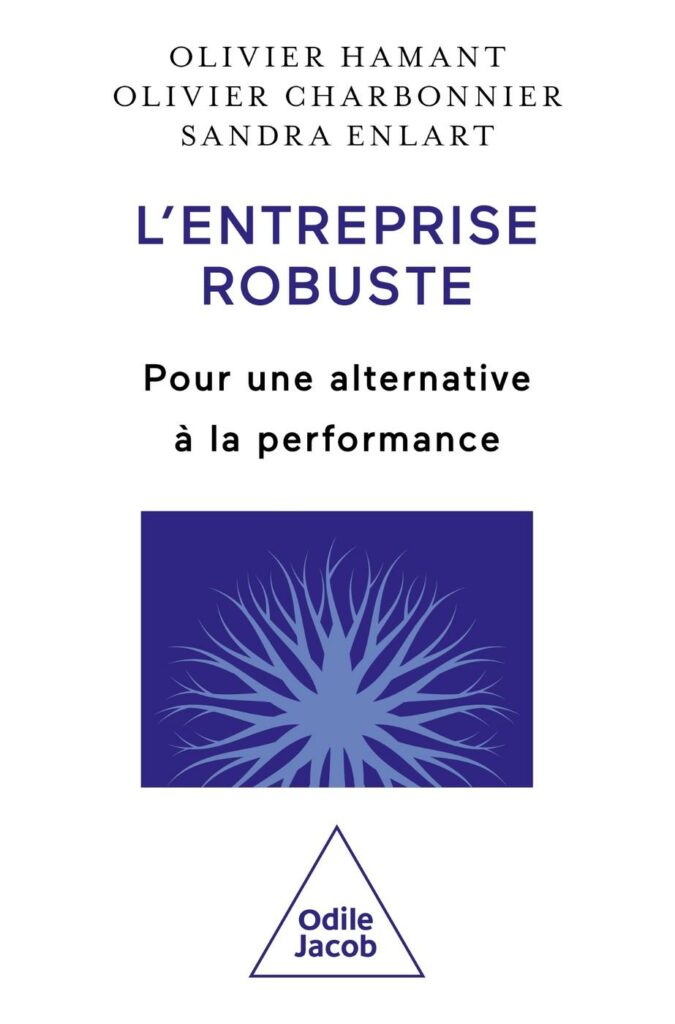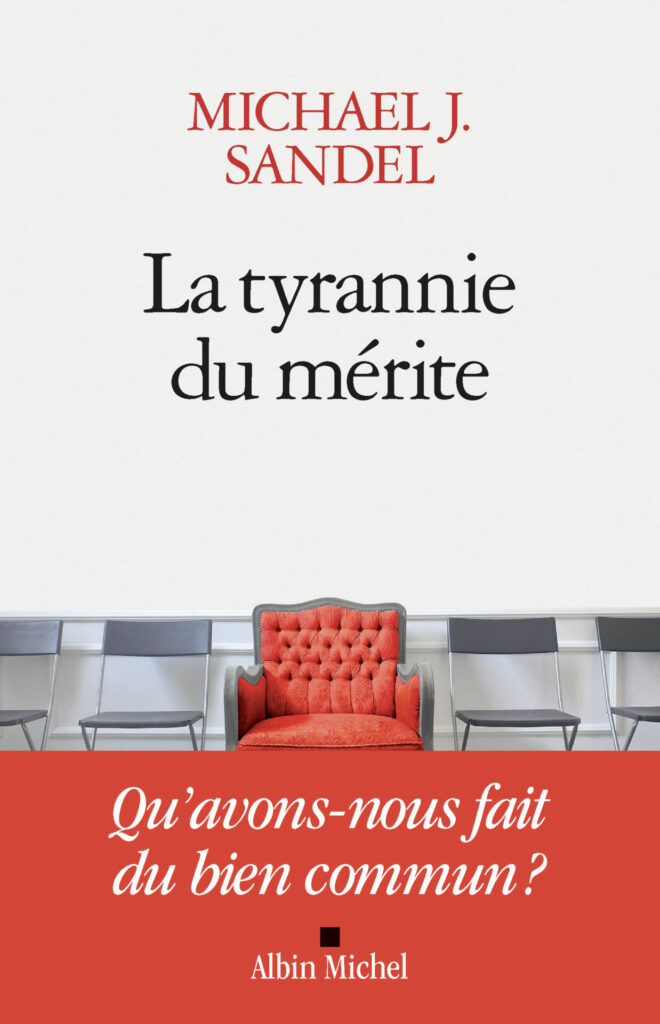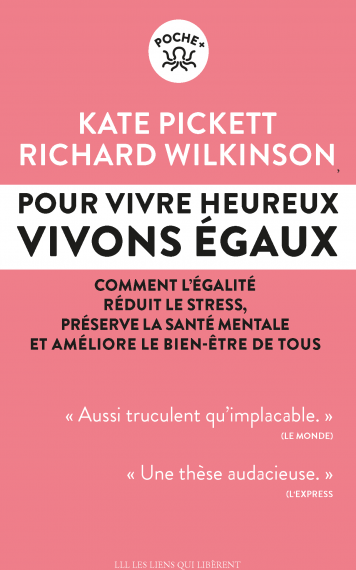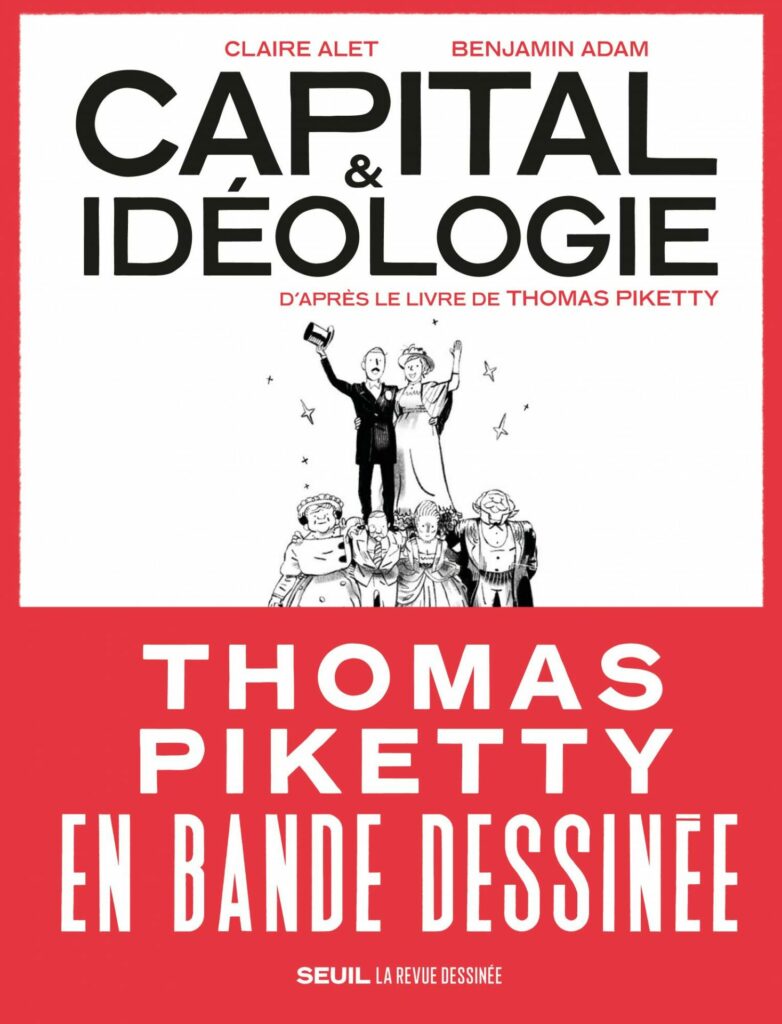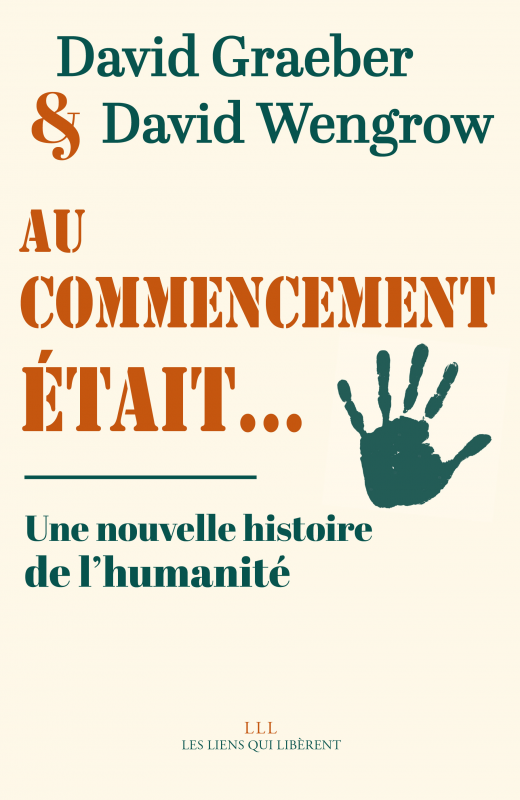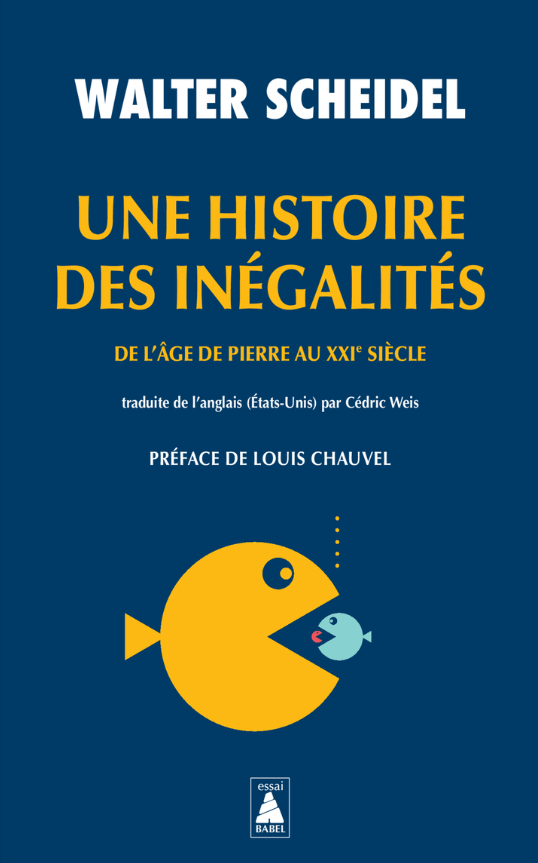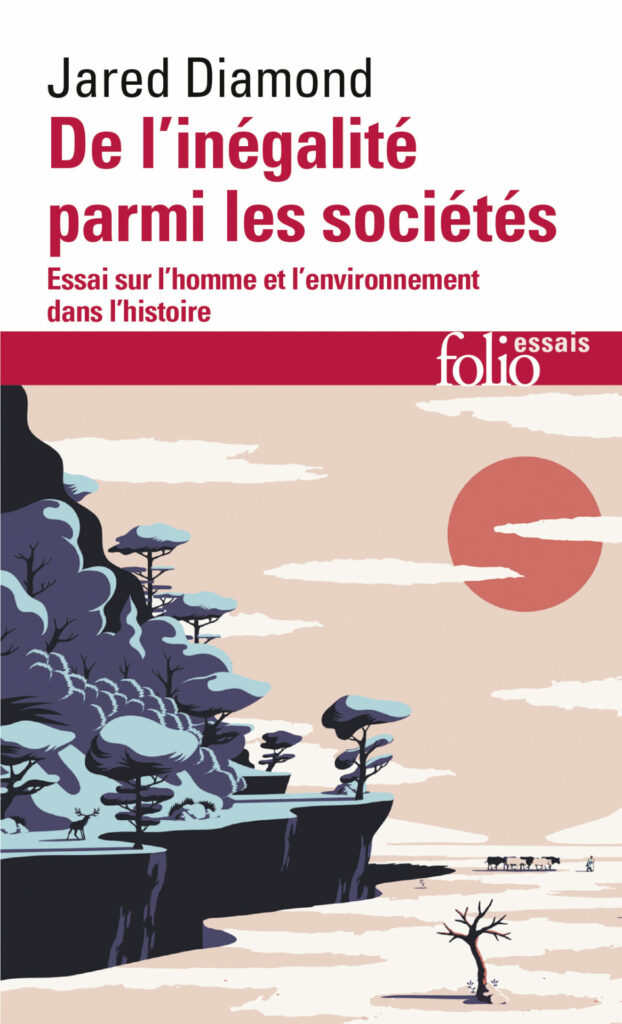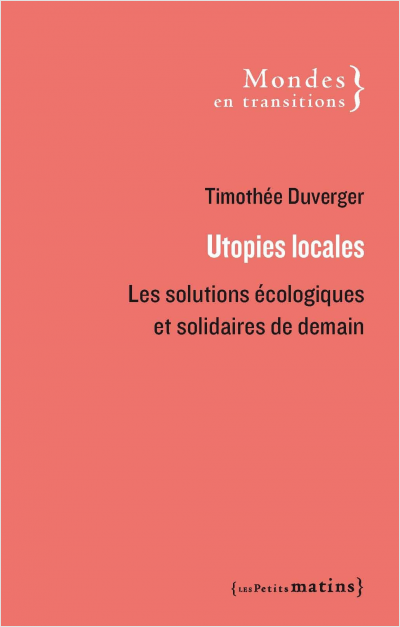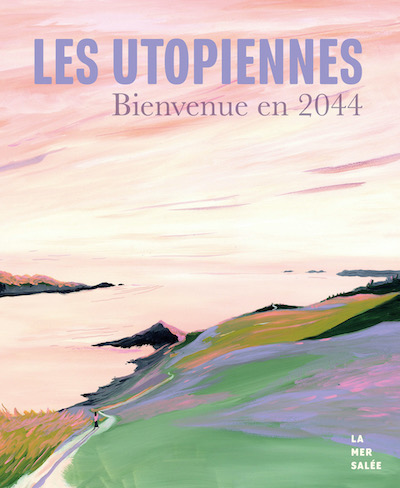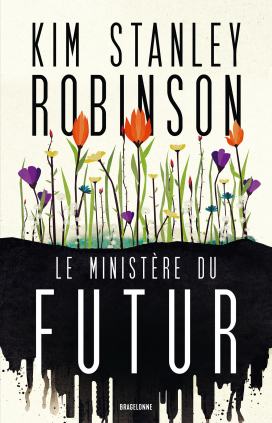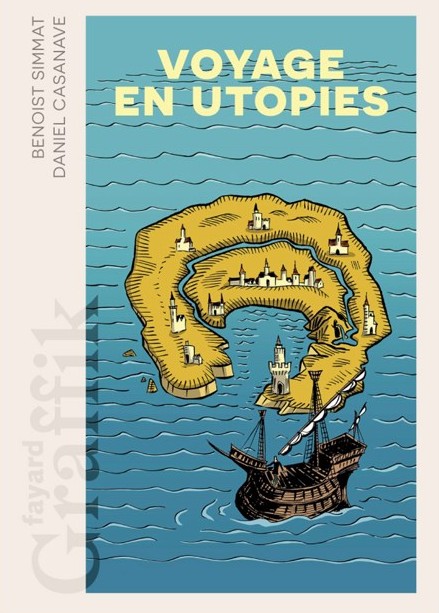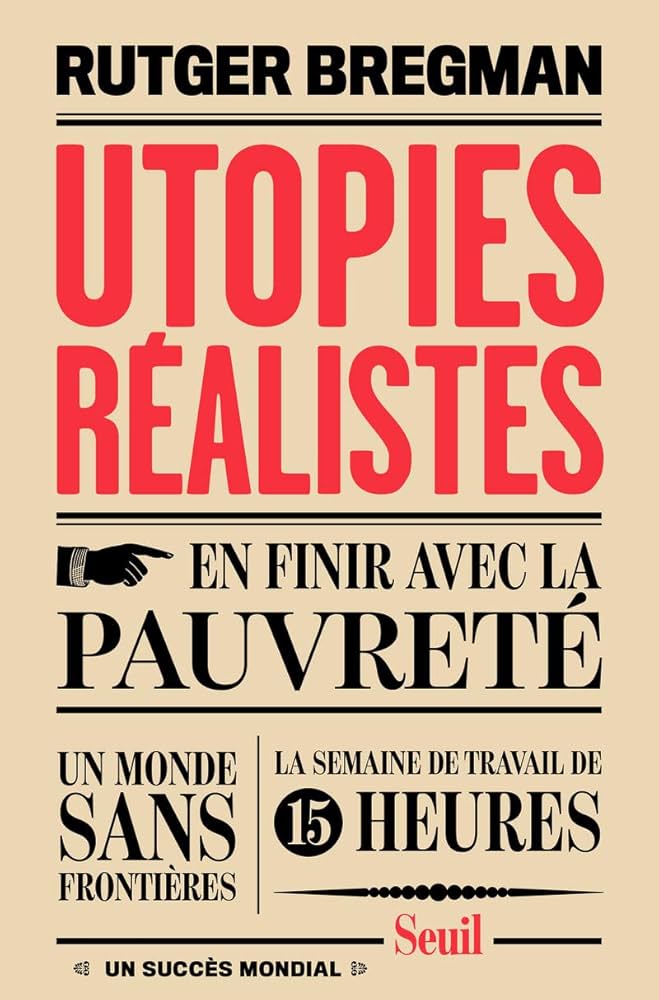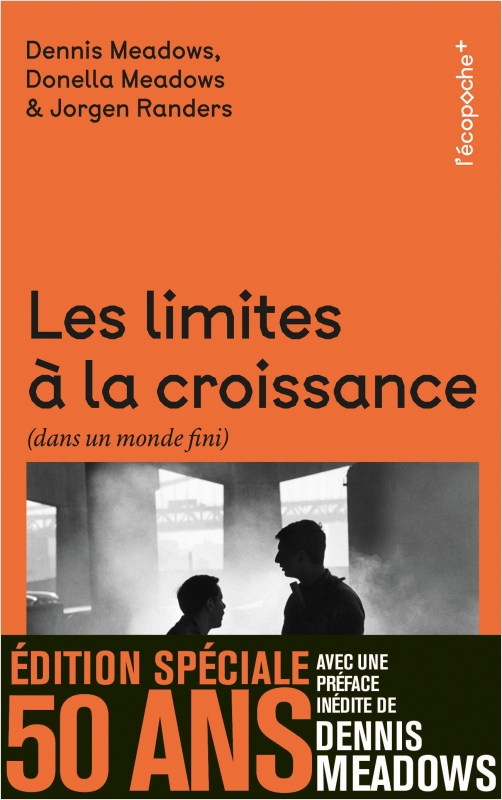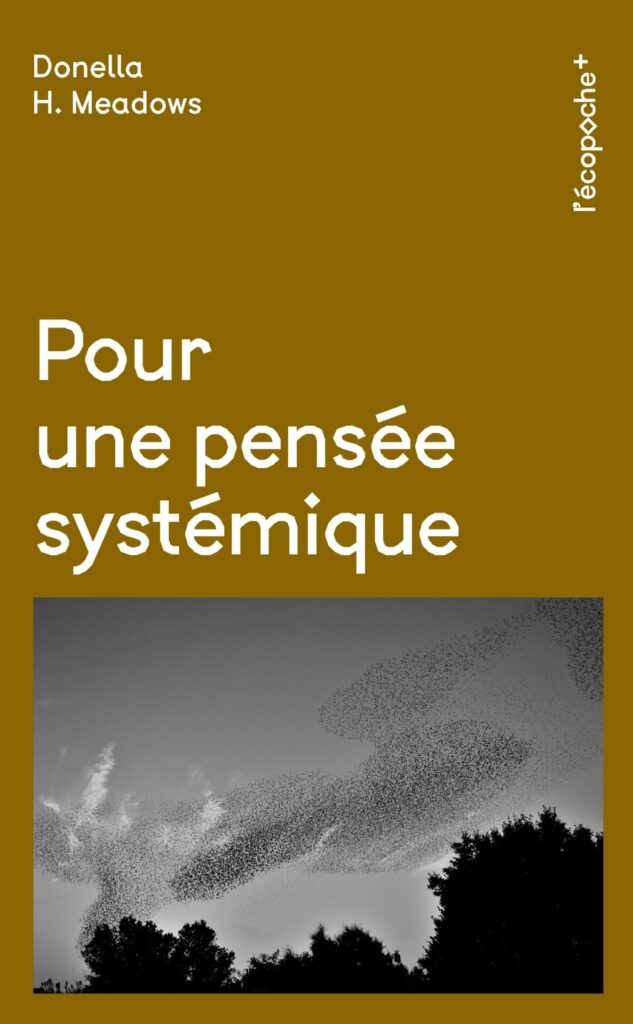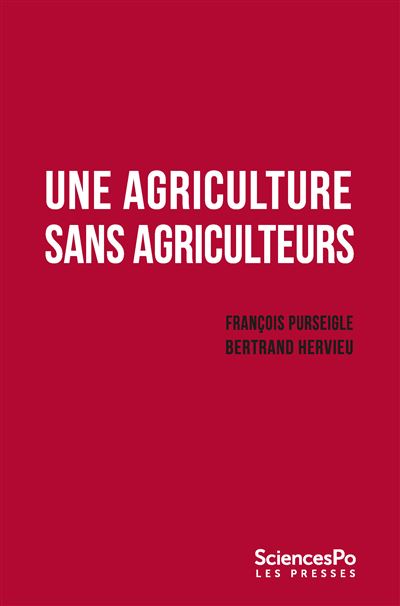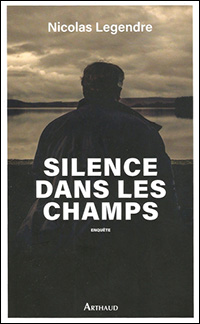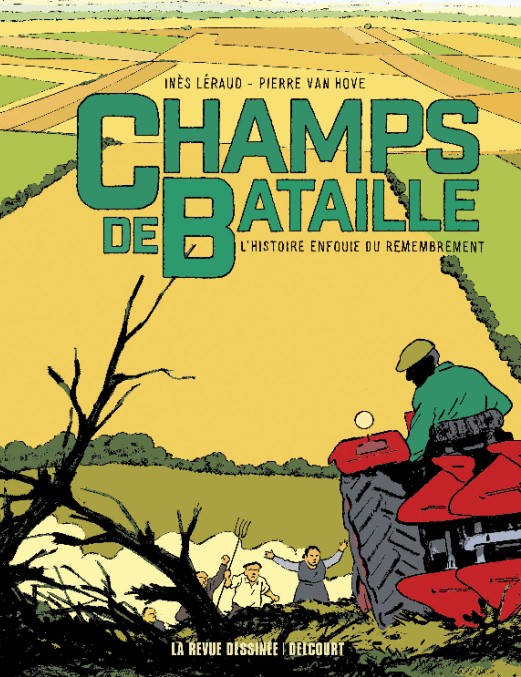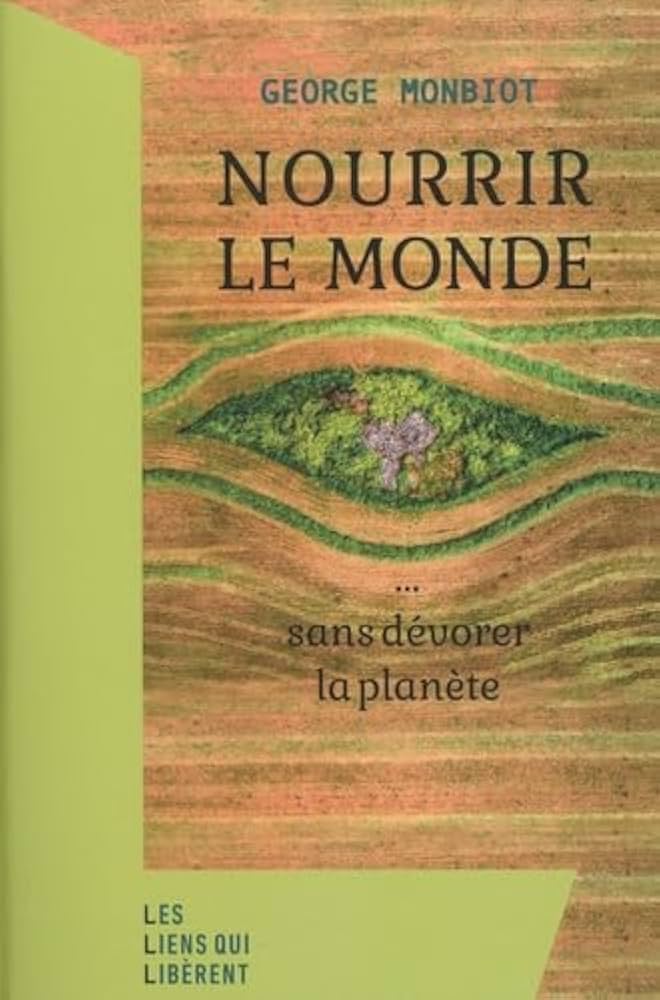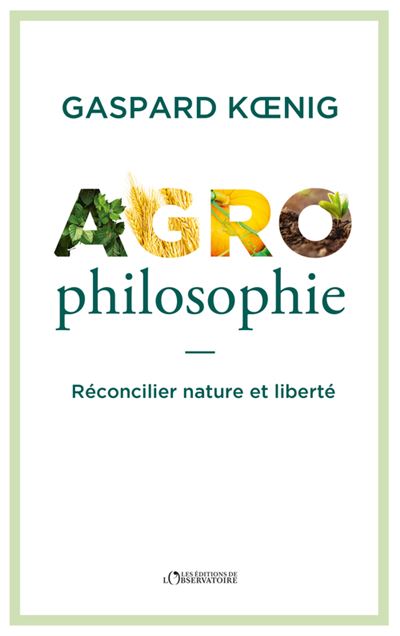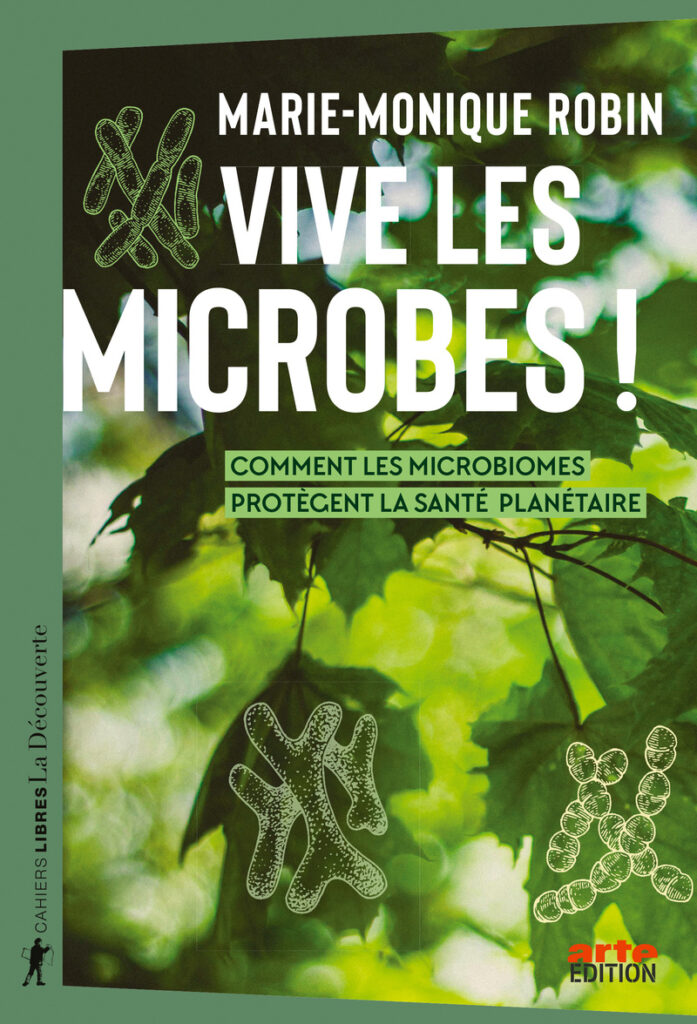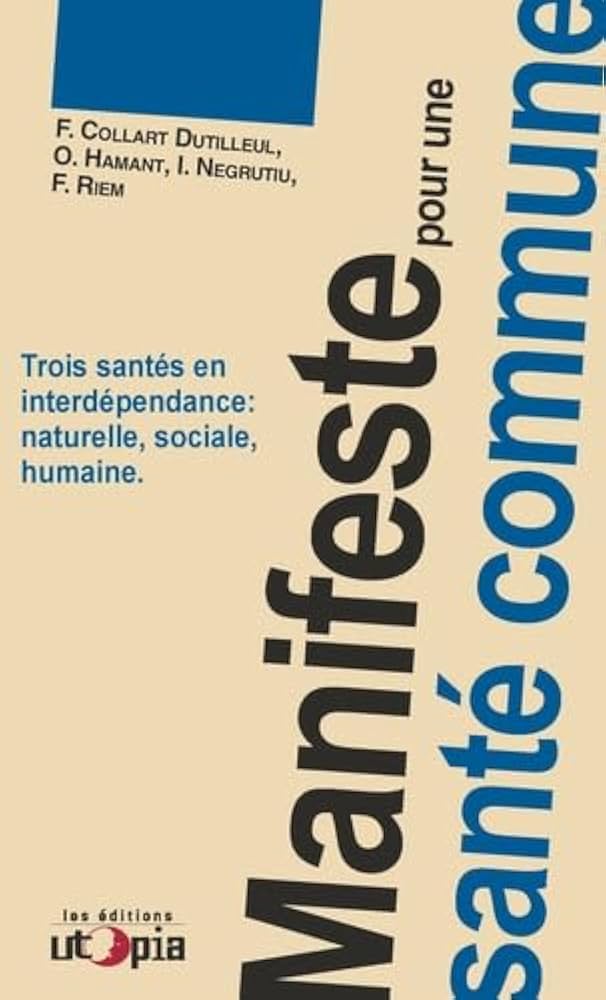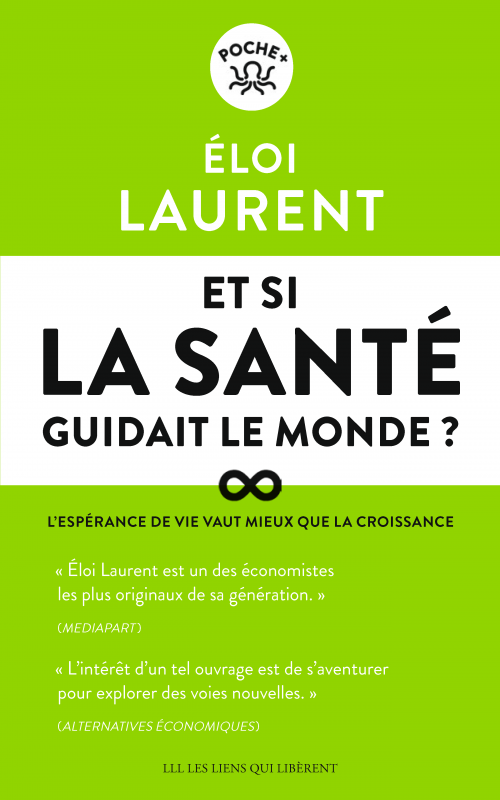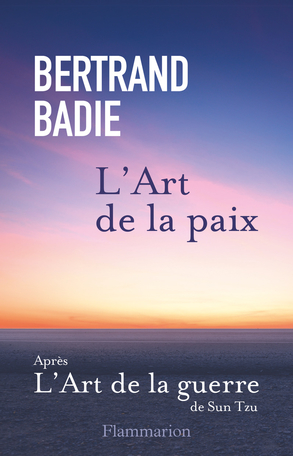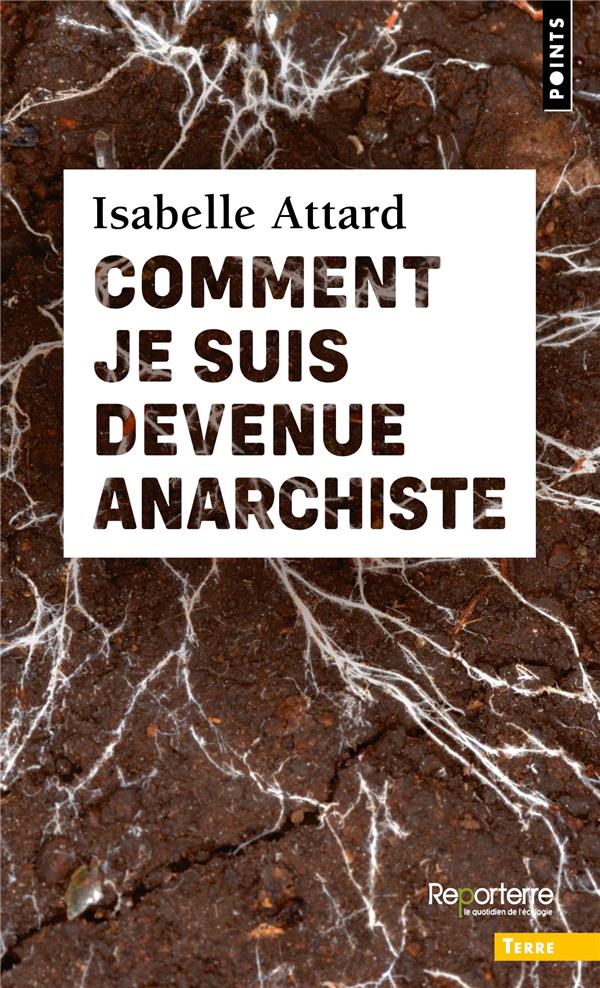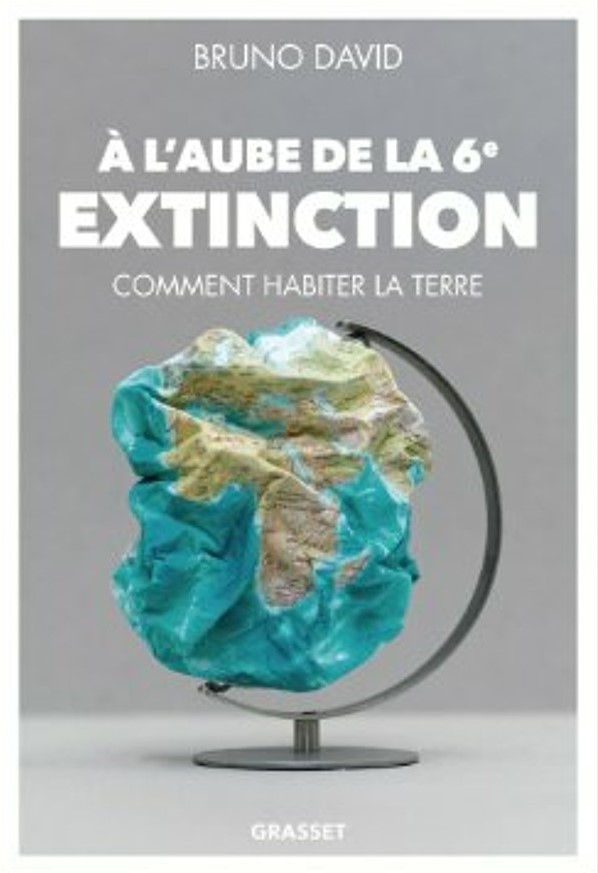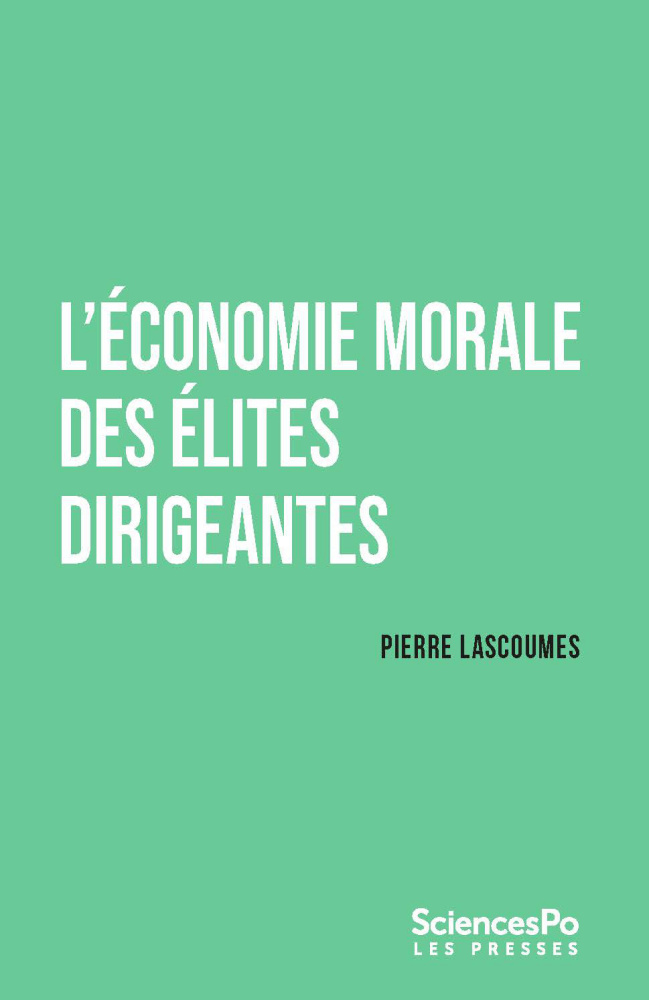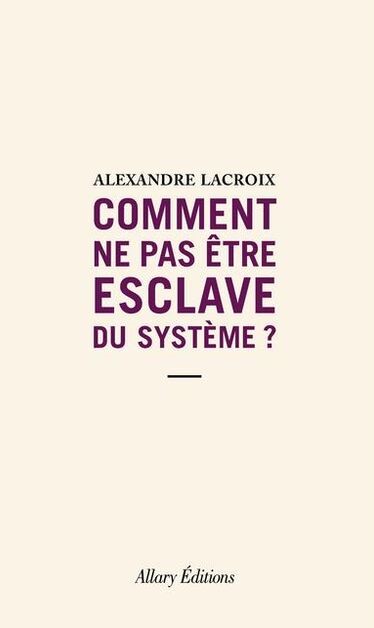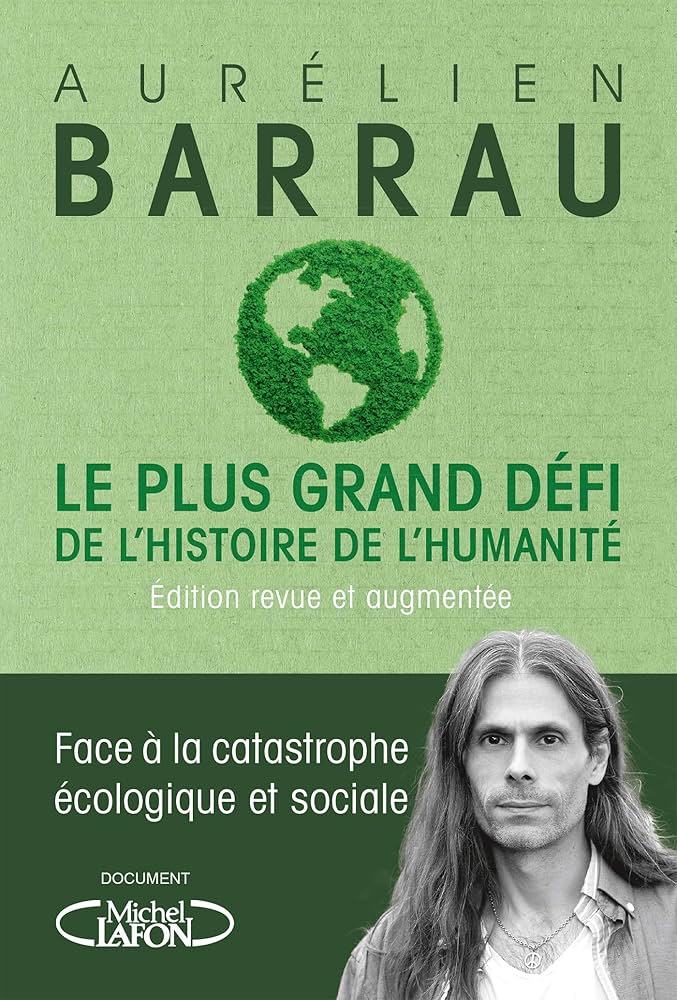Précis d’économie citoyenne
Eric Berr, Léo Charles, Arthur Jatteau, Jonathan Marie, Alban Pellegris, Editions du Seuil 2024
« La dette publique s’est imposée comme un thème central tant dans le débat politique que dans l’espace médiatique« . Mais c’est un sujet complexe dans lequel les discours politiques ou médiatiques sont souvent beaucoup trop réducteurs quand ils ne masquent pas des parti-pris idéologiques, comme c’est le cas des 3% de déficit. « Fruit de l’idéologie néolibérale dominante dans l’Union européenne qui vise à gérer les comptes de l’État comme le ferait un ménage, ces règles n’ont aucun fondement économique ». Dans la lignée des précédents ouvrages des Économistes Atterrés (https://www.atterres.org), cinq membres de l’association se sont attelés à décortiquer le sujet de la dette publique, de son utilité, de la réalité de l’endettement de la France et à proposer des solutions.
L’ouvrage est structuré autour de 3 parties.
Dans une première partie, les auteurs se posent la question de l’utilité et/ou de la dangerosité de la dette publique. « La dette publique est avant tout une relation sociale qui lie des créanciers actuels et des débiteurs actuels« . Si l’on se place du point de vue des générations futures, dans la mesure « où l’endettement public finance des investissements qui bénéficient à tous« , la dette publique n’est pas un fardeau. Quand on mesure, en face du « passif » que représente la dette, l’actif correspondant, « à ce jour, un Français naît avec près de 5500€ de patrimoine net« . Par contre « Les politiques menées actuellement en faveur de l’offre et des intérêts privés creusent des déficits pour de mauvaises raisons et alimentent une dette inutile qui alourdit le passif des administrations publiques« , ce qui érode le patrimoine net des français.
« En temps de crise, il ne faut pas se serrer la ceinture« . A partir de l’analyse des « multiplicateurs » keynésiens, les auteurs nous montrent comment une politique d’austérité est « injuste et douloureuse socialement en plus d’être inefficace« .
Ceux qui profitent de la dette ce sont les créanciers, c’est-à-dire les plus riches. « La dette publique est détenue par les plus riches et ça leur rapporte« . De plus, les différentes crises de la dette qui se sont développées depuis les années 80, d’abord dans des pays en développement, puis plus récemment dans un pays comme la Grèce, ont montré que la dette pouvait être un outil de domination pour imposer des politiques néolibérales. Comme le dit David Graeber, cité par les auteurs « L’histoire montre que le meilleur moyen de justifier des relations fondées sur la violence, de les faire passer pour morales, est de les recadrer en termes de dettes – cela crée aussitôt l’illusion que c’est la victime qui commet un méfait ».
Dans la 2e partie, les auteurs s’attachent à répondre à la question « La France est-elle surendettée ? ».
Tout d’abord il faut se méfier du ratio dette publique/PIB qui est très réducteur. D’autres indicateurs permettent de mieux saisir le poids de la dette publique.
Ensuite, à partir des années 1960, le financement de la dette publique a connu d’importantes transformations. Pour arriver à une situation où, aujourd’hui, le financement de l’État par les banques centrales est interdit. La France est ainsi devenue complètement dépendante des marchés financiers. « Les créanciers acquièrent un droit de regard sur la politique économique devenant tierce partie au contrat social ».
Un message couramment véhiculé c’est que la France vit au-dessus de ses moyens. Les auteurs consacrent un chapitre à déconstruire cette idée. En 2021, la dépense publique rapportée au PIB est de 59%. « C’est un fait statistique mais l’interprétation qui en est généralement faite est fausse« . En prenant la même approche, on peut calculer que la dépense privée représente 189% du PIB en 2021. De fait « La production non marchande, les services publics représentent en 2021, 17,8% du PIB en France« . Ce qui correspond à un choix de société : éducation, santé, services publics…
Quand on parle de dépenses, il faut parler aussi de recettes. « Les politiques néolibérales menées depuis la fin des années 70 ont conduit à amputer une partie des recettes de l’État sous couvert d’une politique de l’offre favorable au secteur privé ».
Les déficits publics récurrents ont conduit à un accroissement de la dette publique dont il est dit régulièrement qu’elle est insoutenable. En s’appuyant sur une comparaison historique et spatiale de la dette publique française, les auteurs montrent que : « Dès lors que l’on accepte de déconstruire l’indicateur d’aide publique sur PIB et de considérer d’autres approches de l’endettement public, on dispose d’une vision nettement moins alarmiste que celle qui nous est régulièrement donnée à voir ».
Alors « que faire ? ». La troisième partie propose des pistes pour le futur. Mettre la dette au service de la bifurcation sociale et écologique, cela veut dire mobiliser « l’impôt pour sanctionner les activités socialement et écologiquement nuisibles« , mais aussi éventuellement une « monétisation directe du déficit budgétaire » par les banques centrales. « En appui de ces politiques ambitieuses une restructuration de la dette publique est possible en cas de nécessité« . Mais en tout cas, il faut sortir de la dépendance aux marchés financiers pour financer la dette.
La conclusion nous rappelle l’importance de la démocratie en matière de dette, « C’est donc grâce à plus de démocratie, et non moins, et à plus de liberté , et non moins, que les pistes évoquées tout au long de cet ouvrage pourront avoir une chance d’être appliquées et que la dette publique pourra être mise au service de l’accroissement du bien être du plus grand nombre et la bifurcation écologique ».
Un petit ouvrage très pédagogique à lire par tous pour mieux comprendre les enjeux de la dette et les sous jacents idéologiques derrière les discours sur la dette.