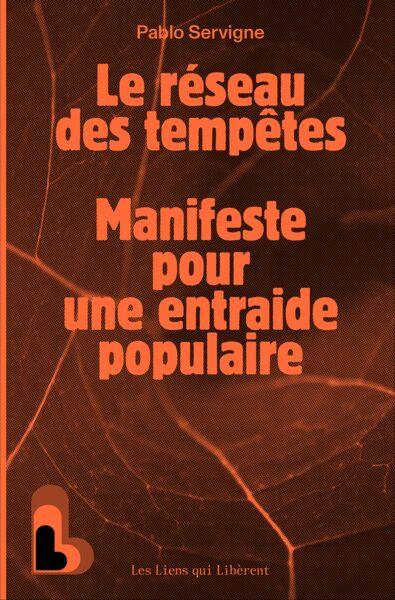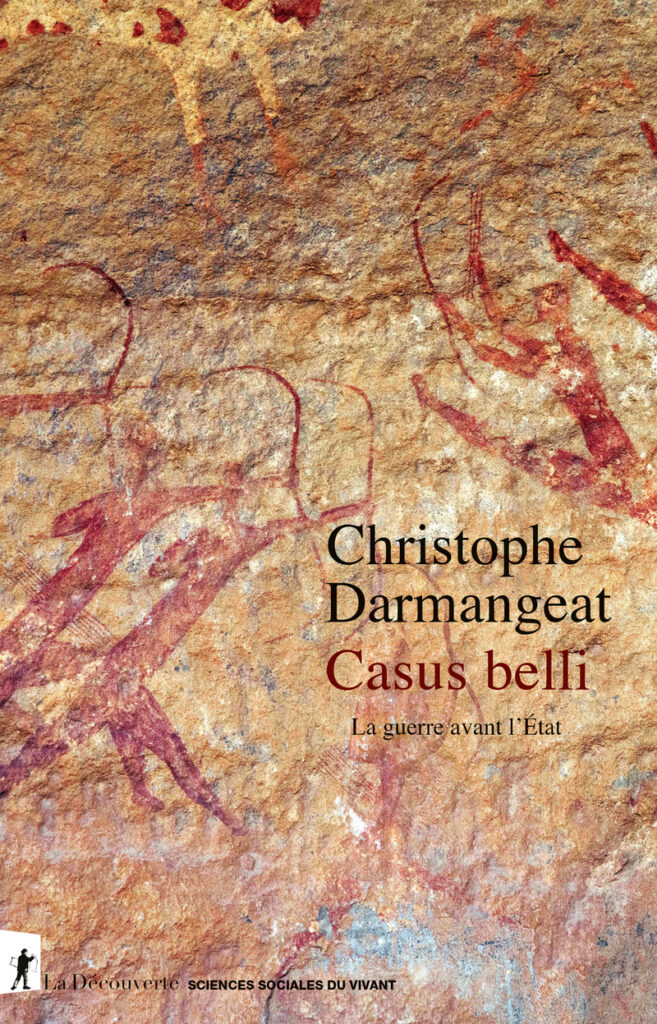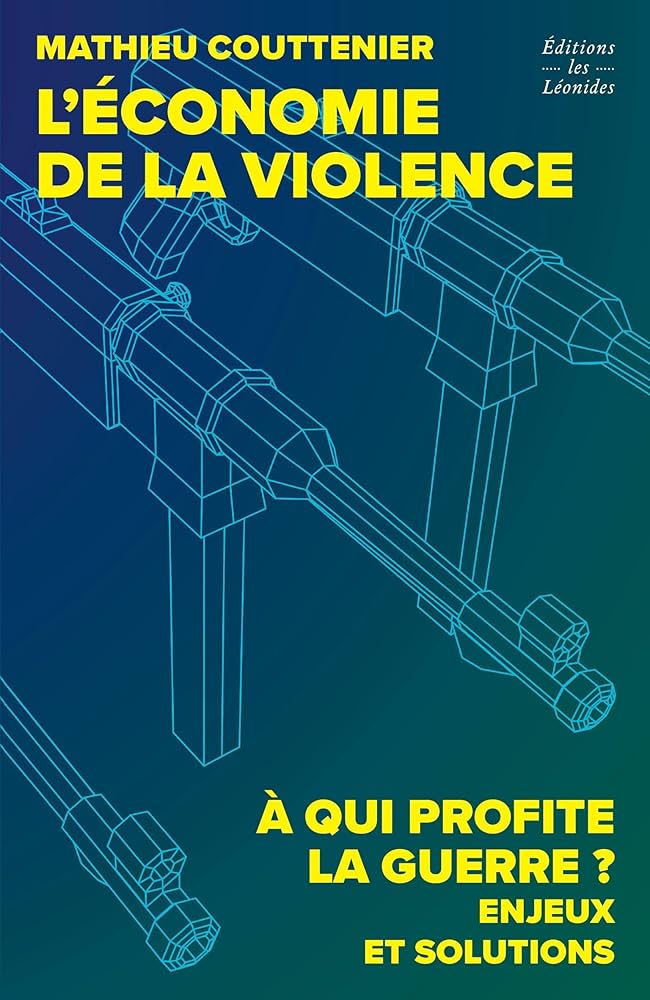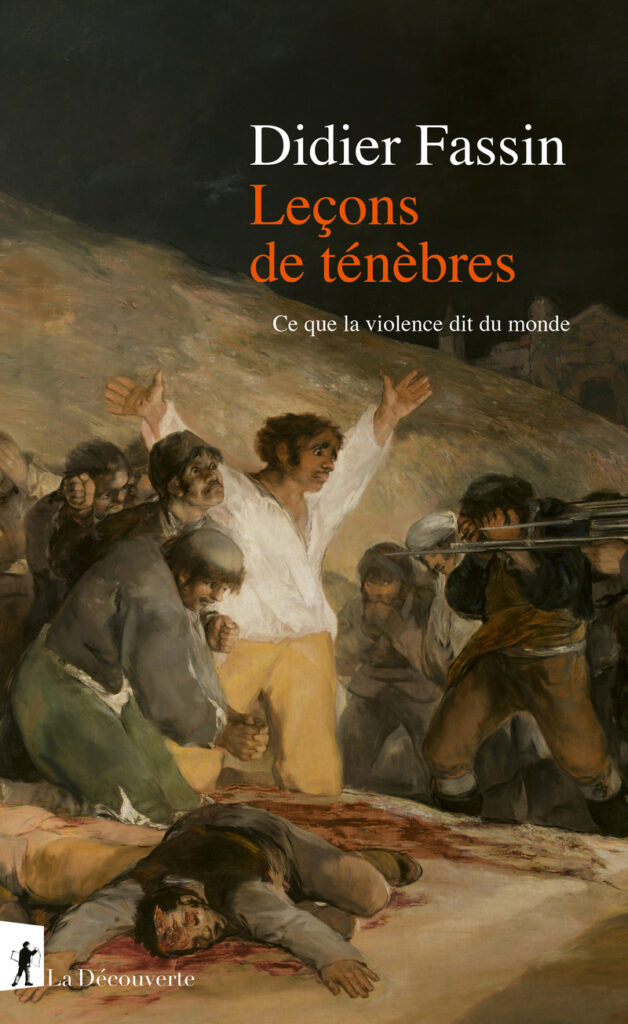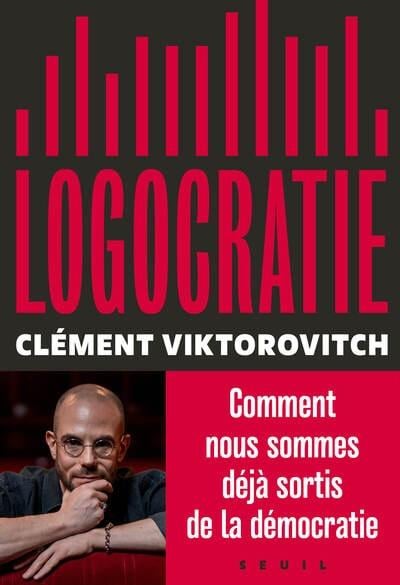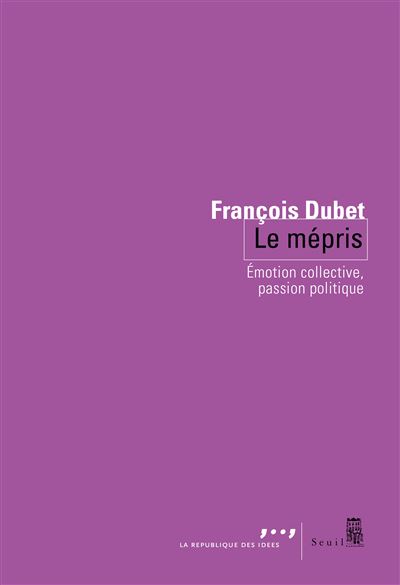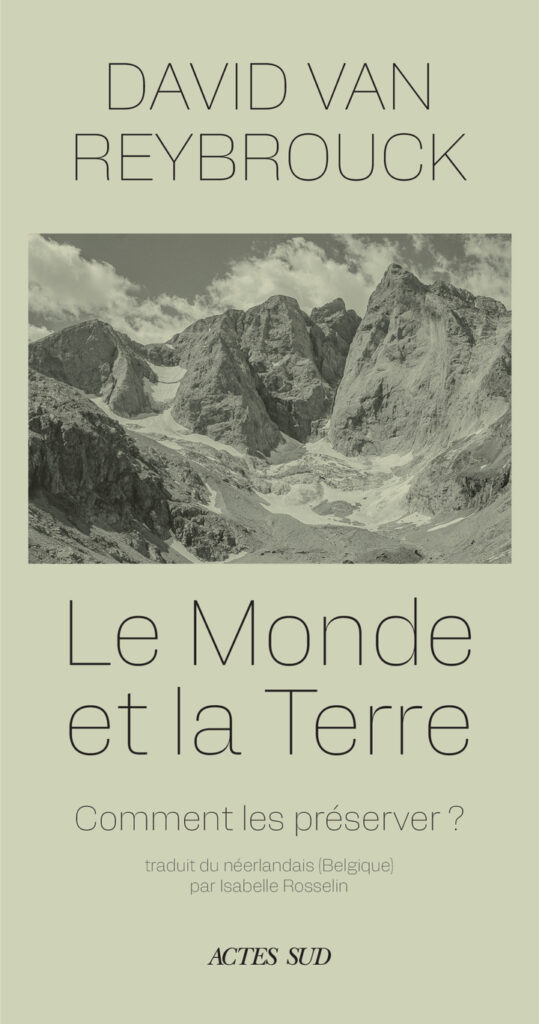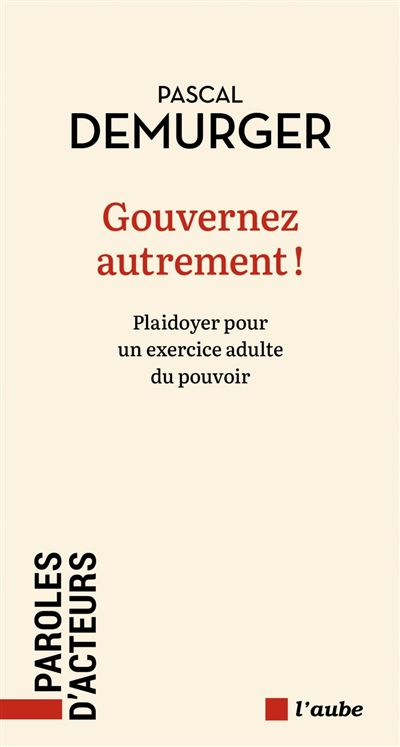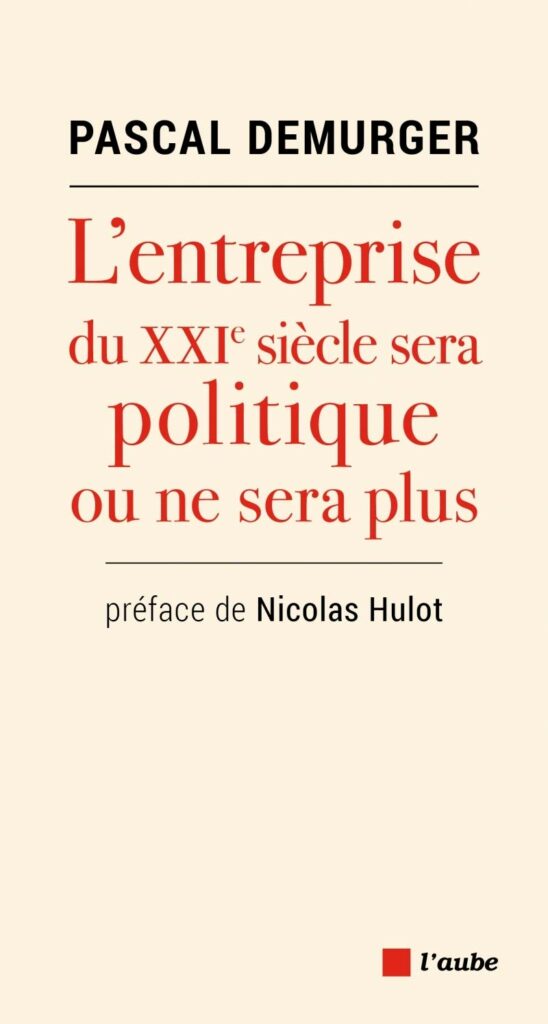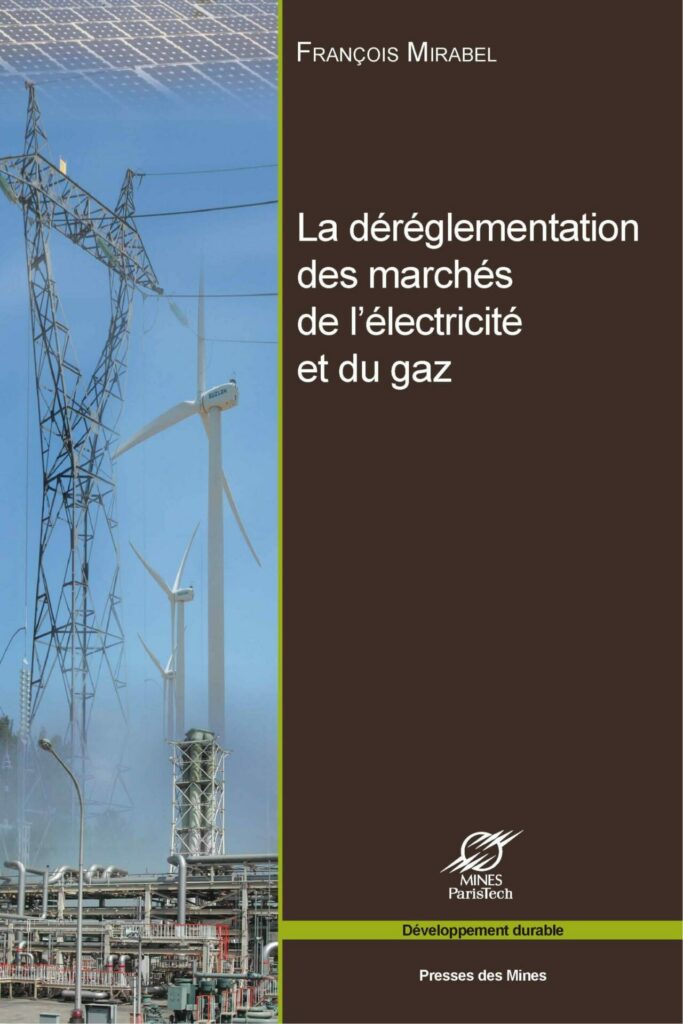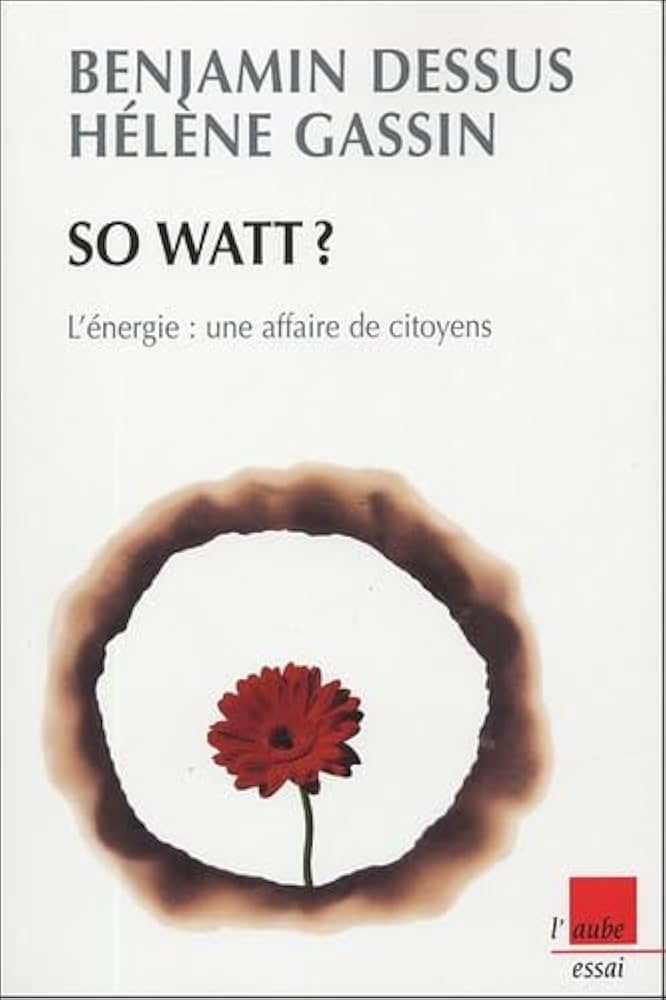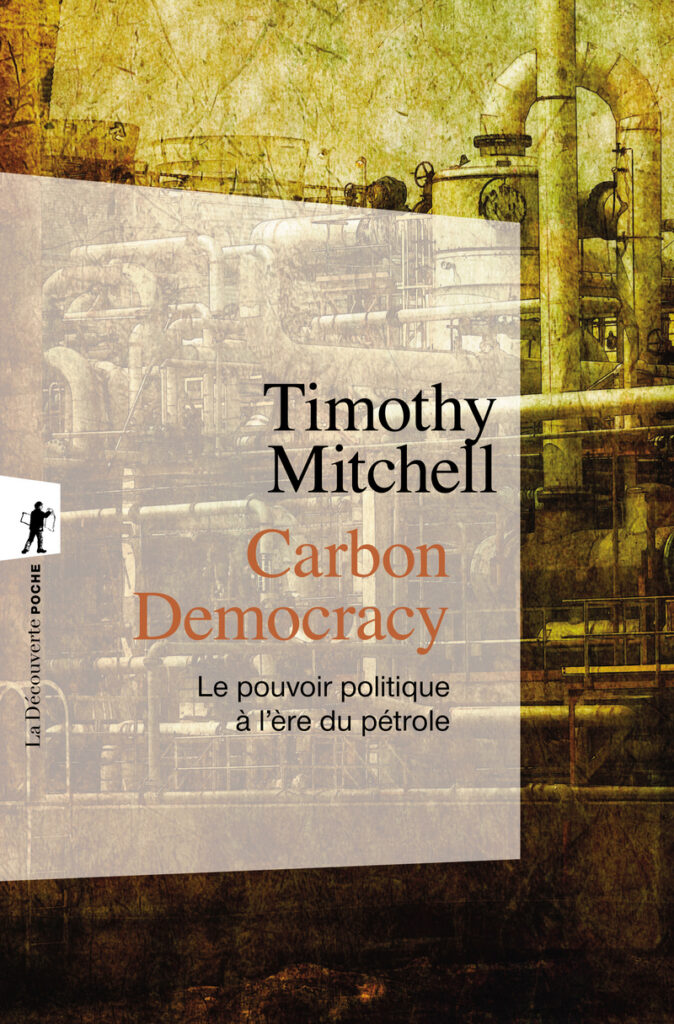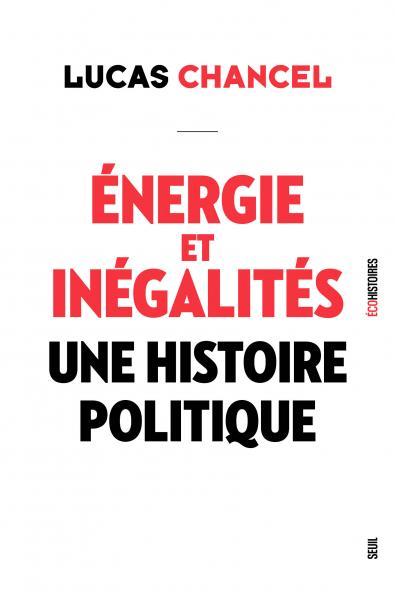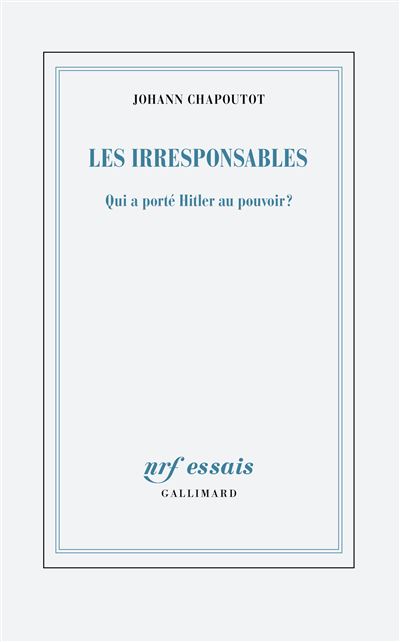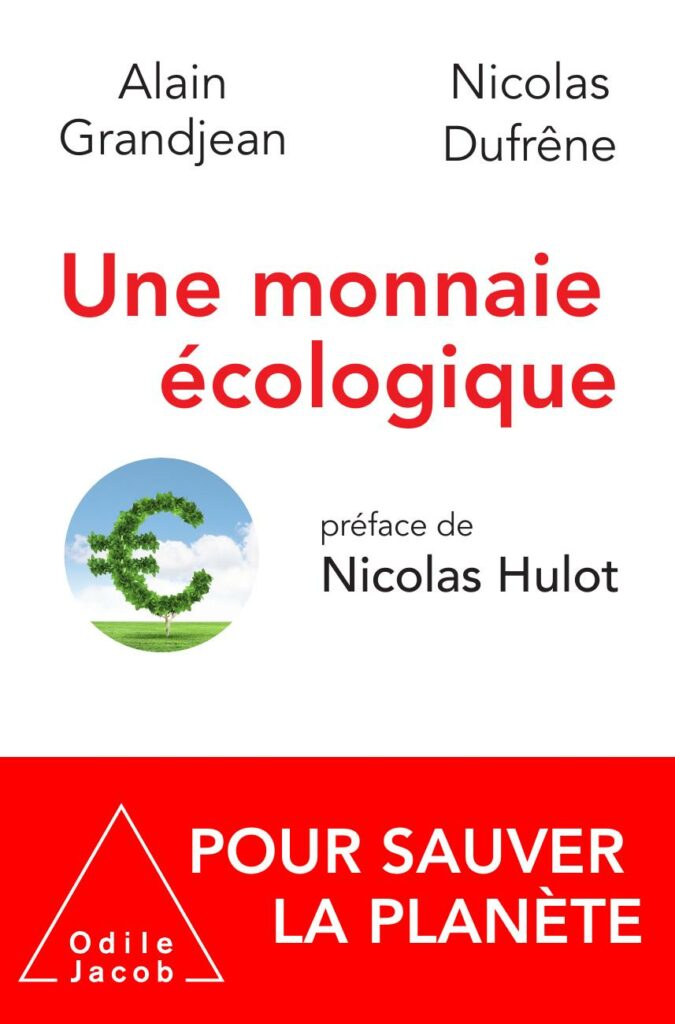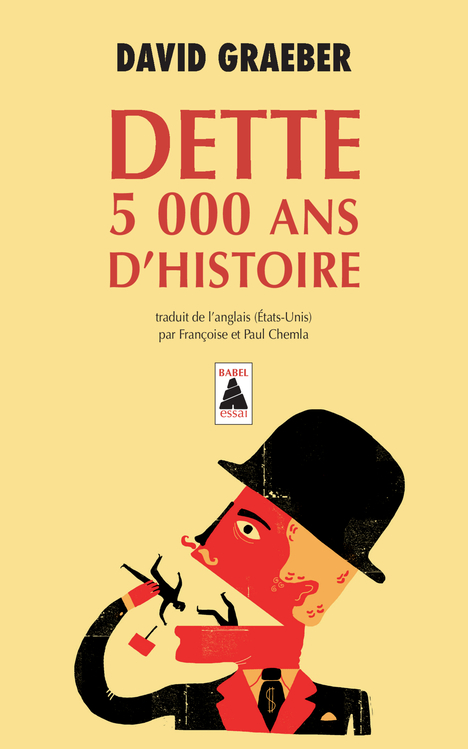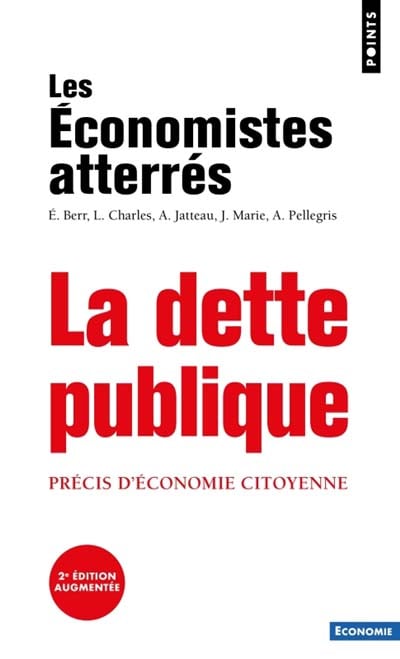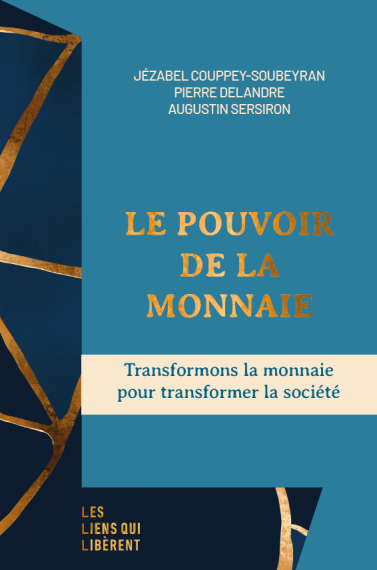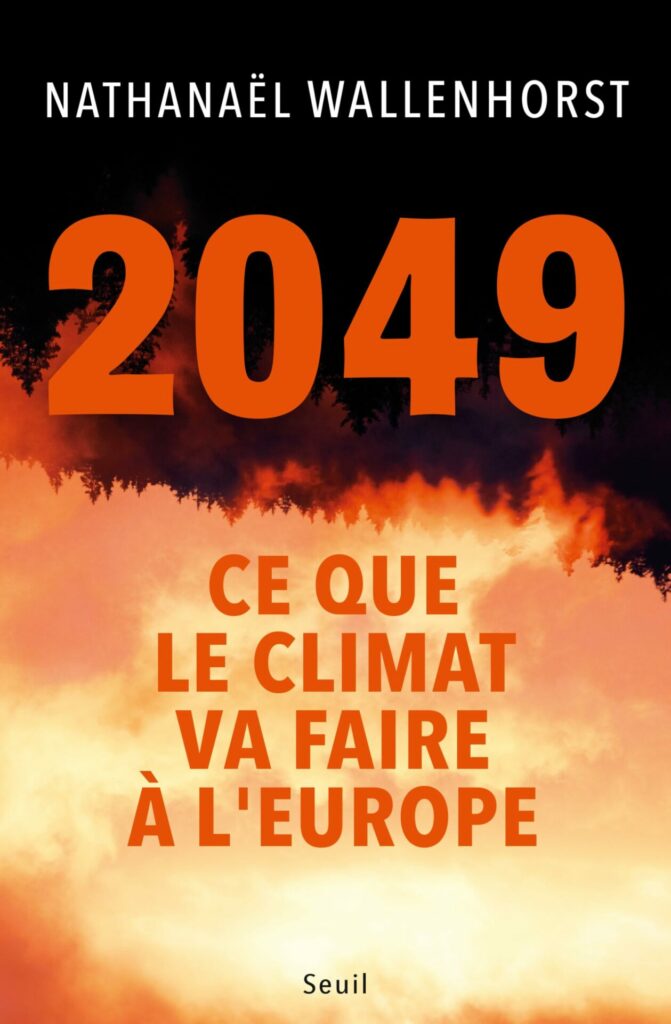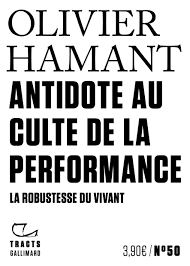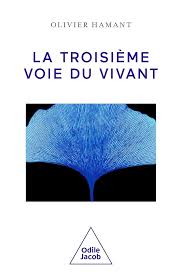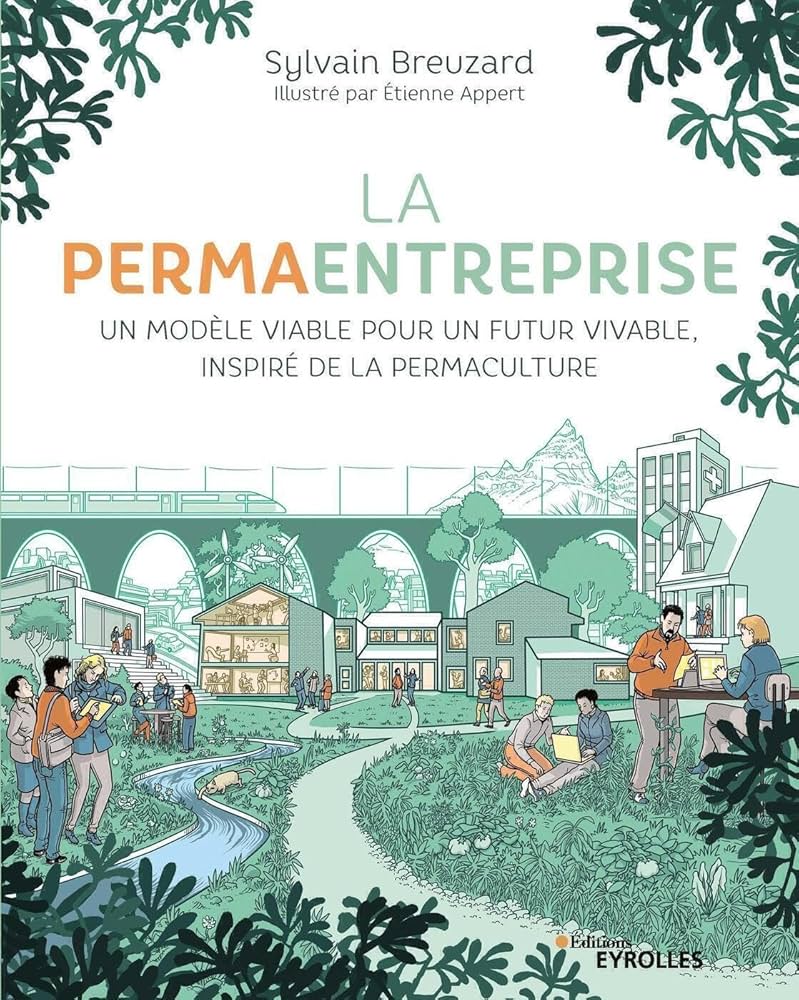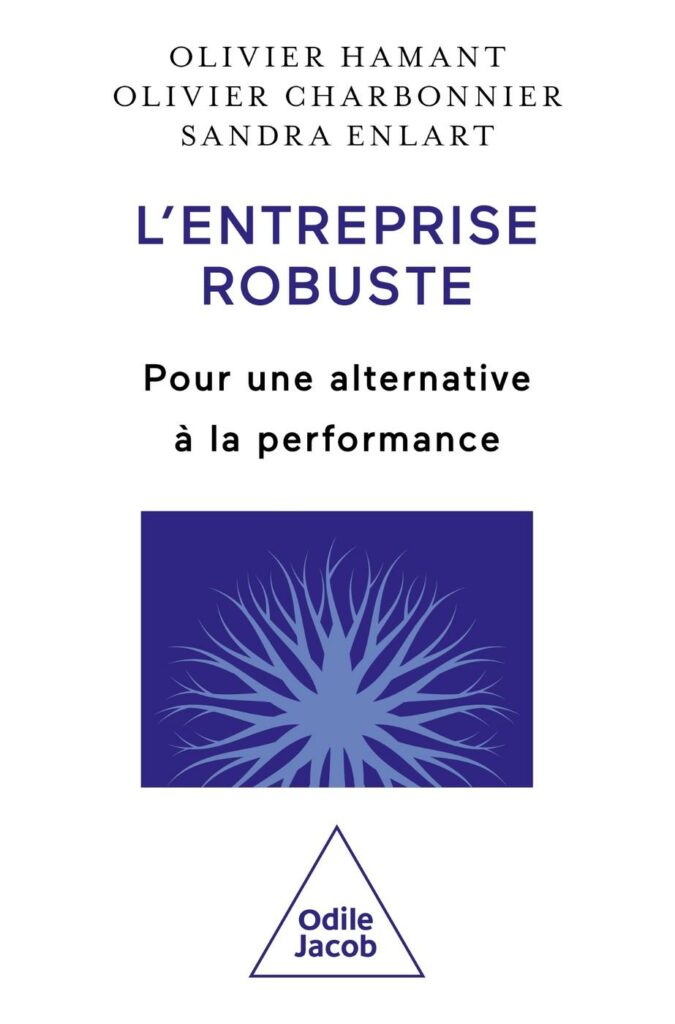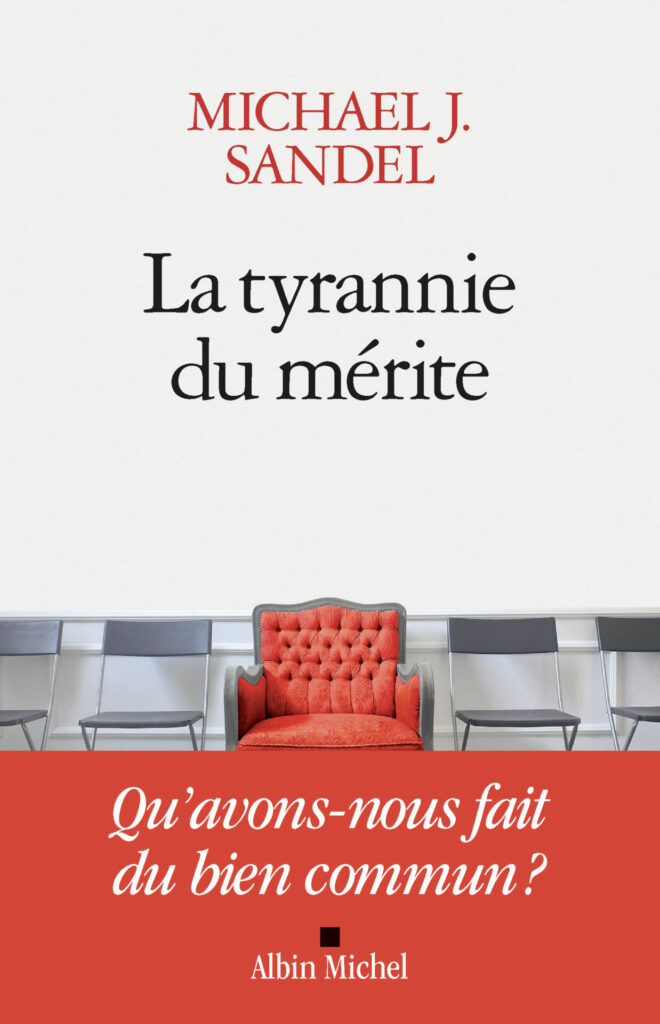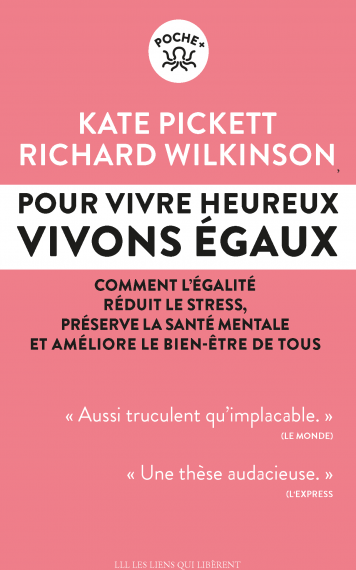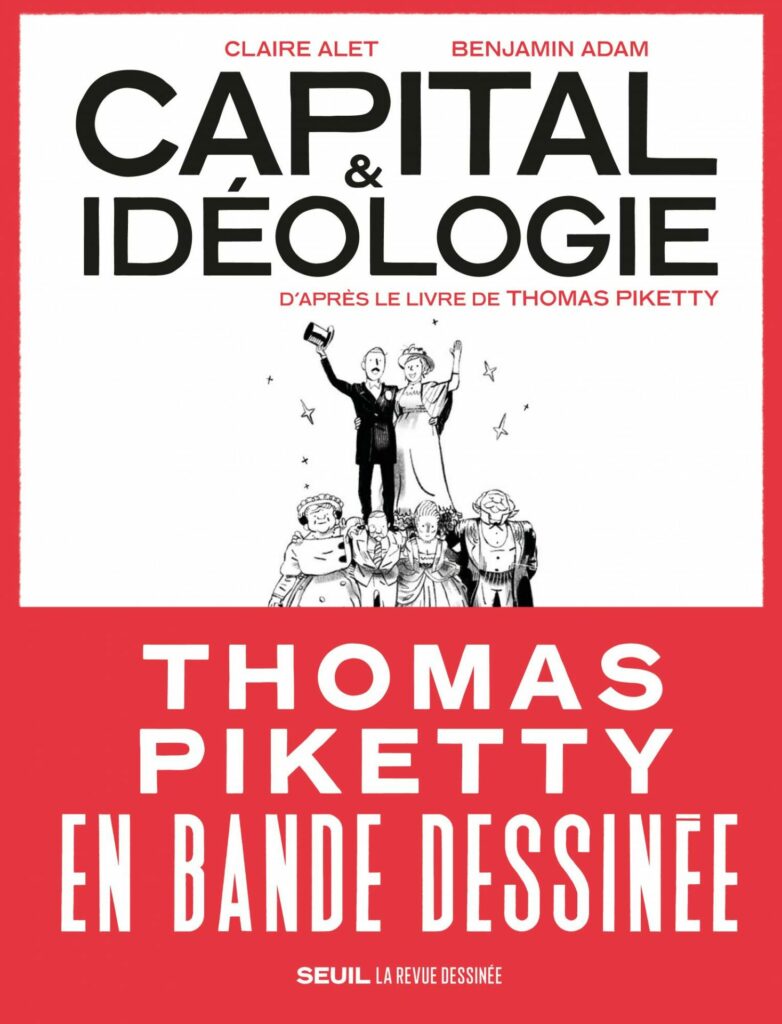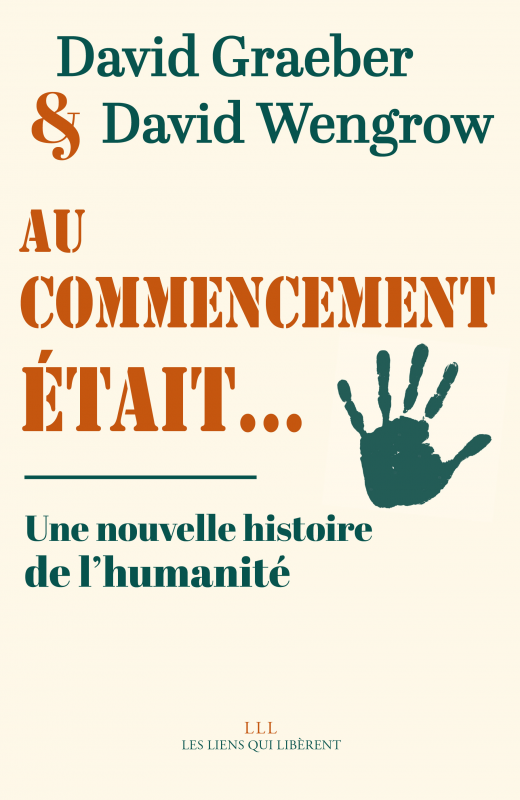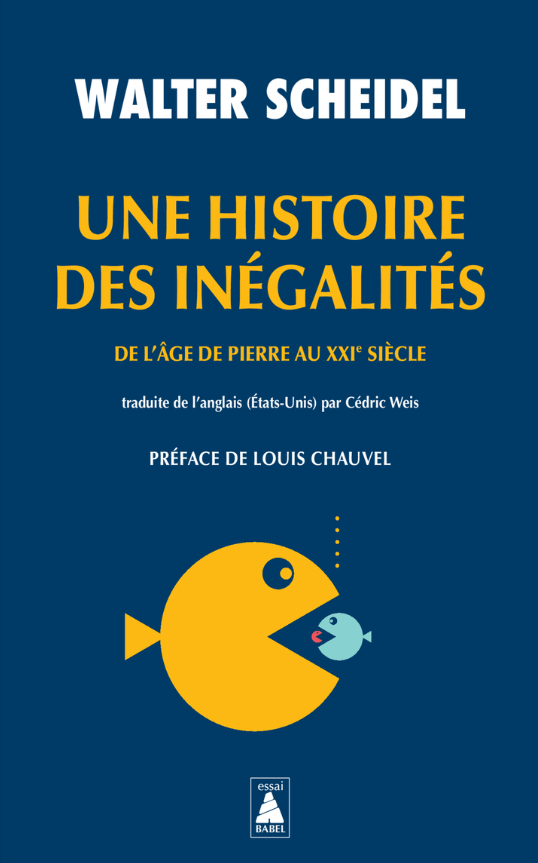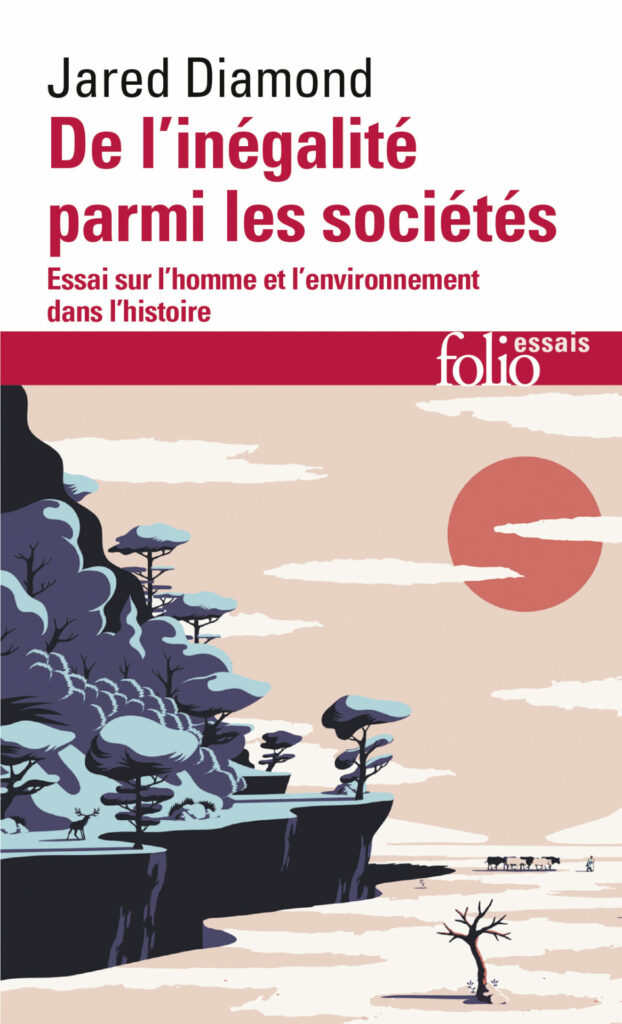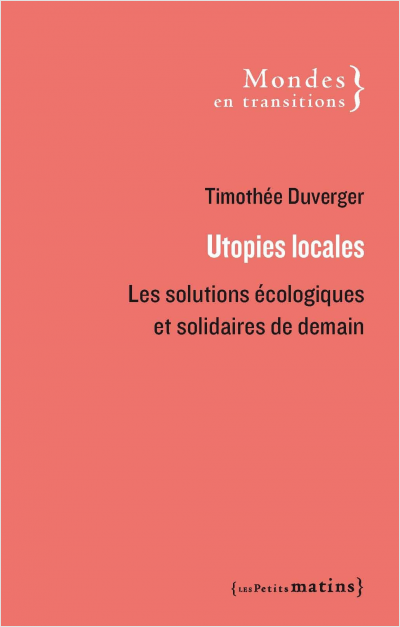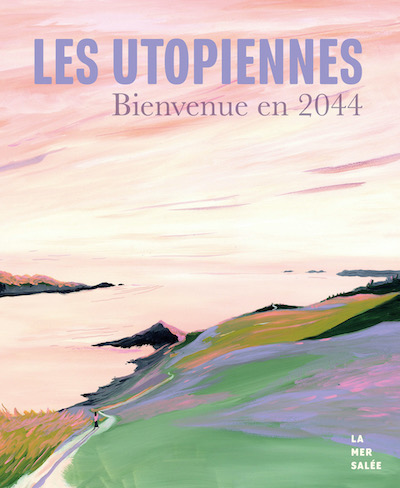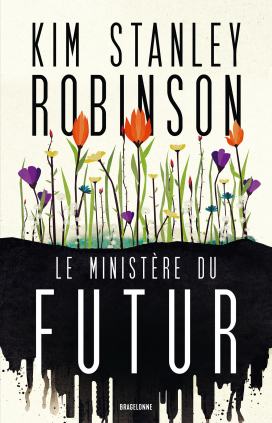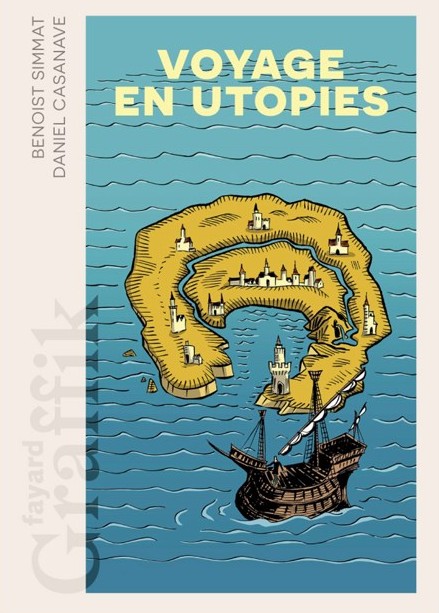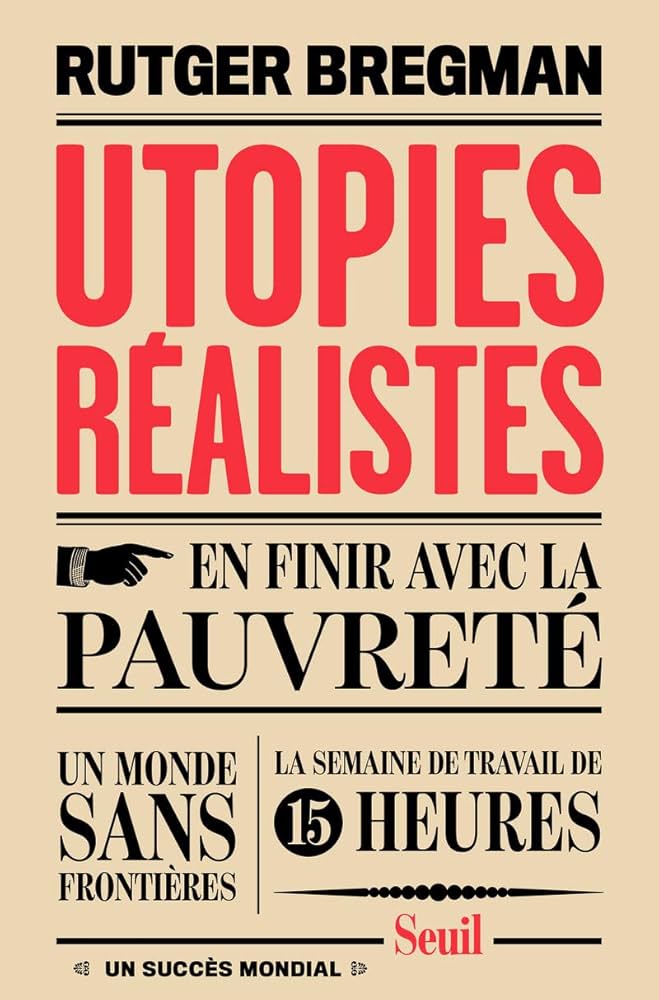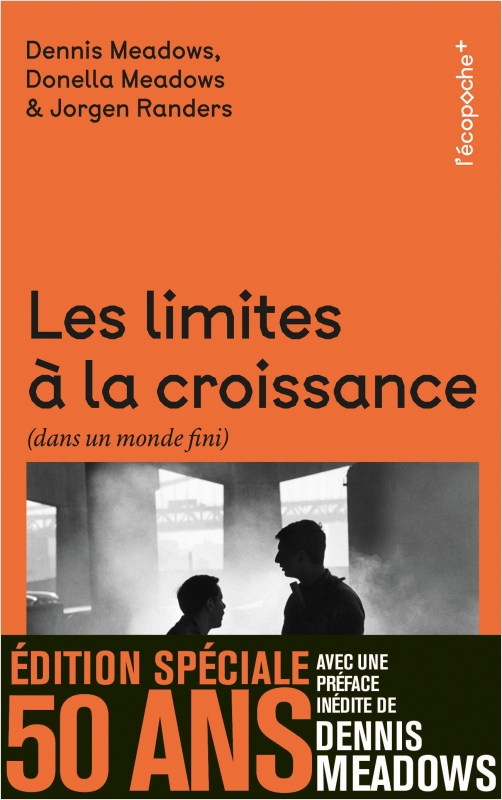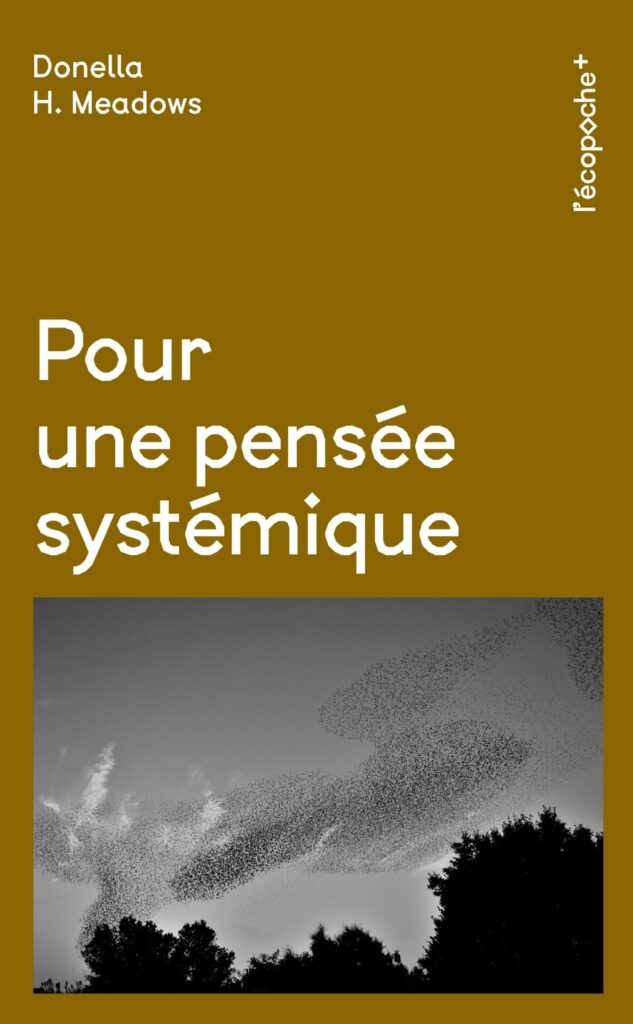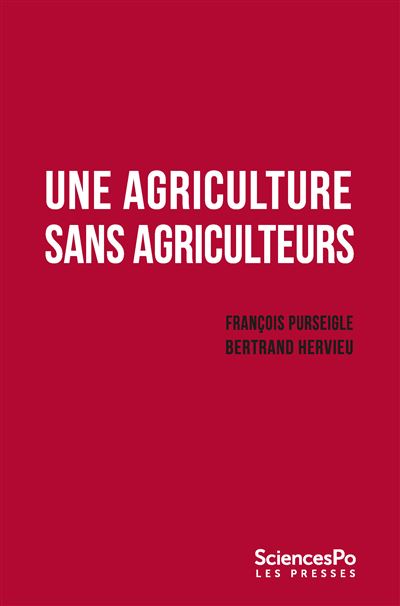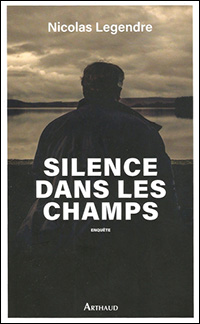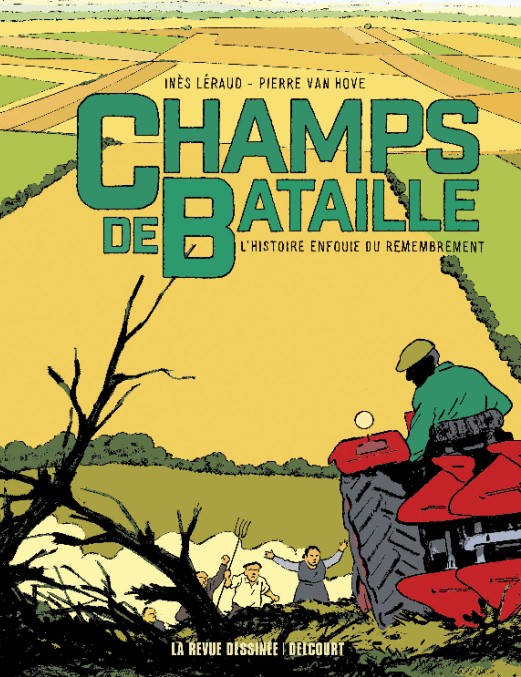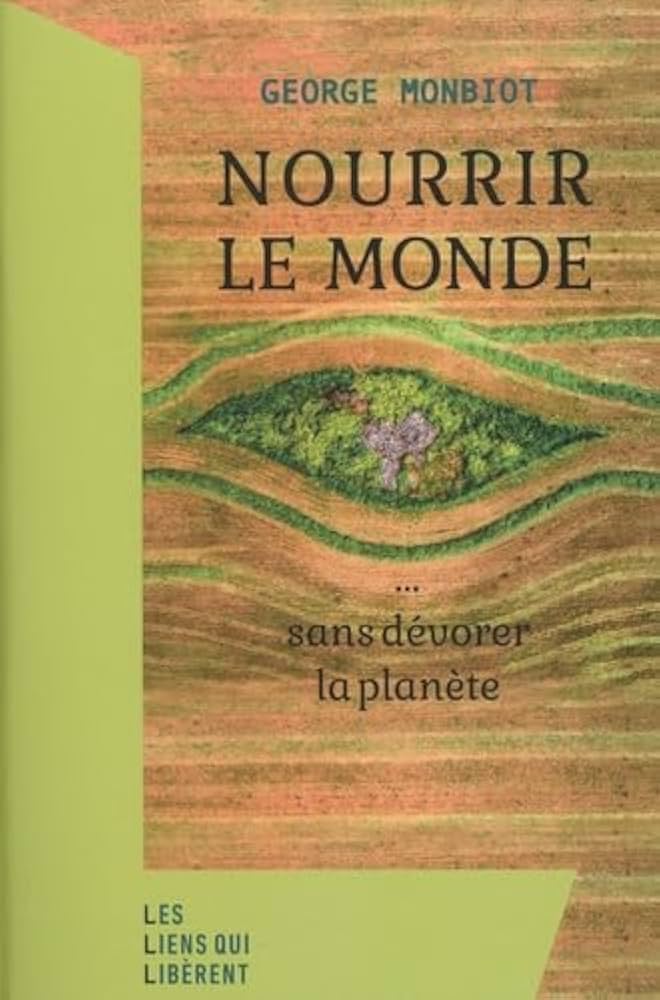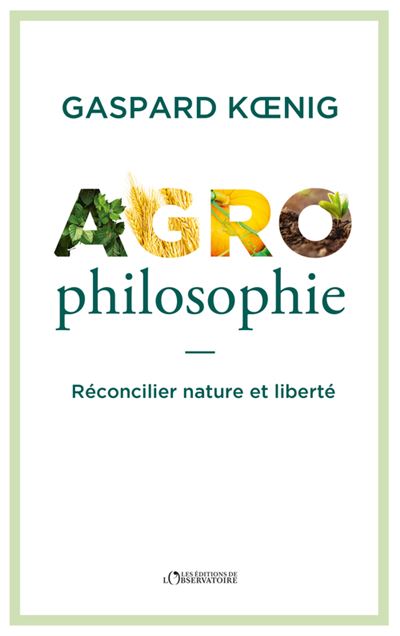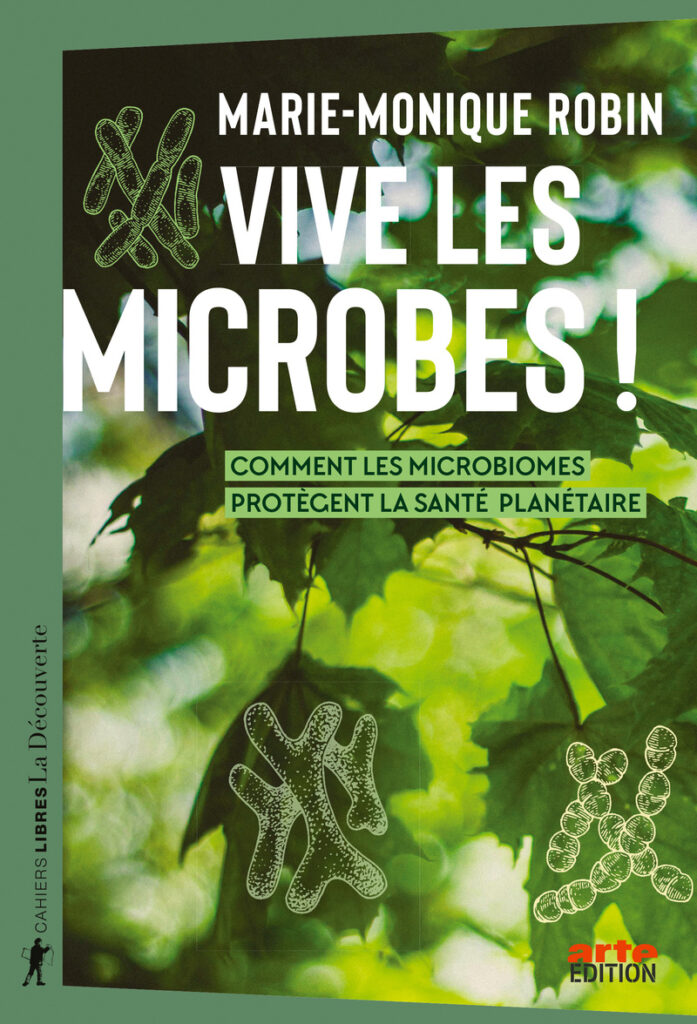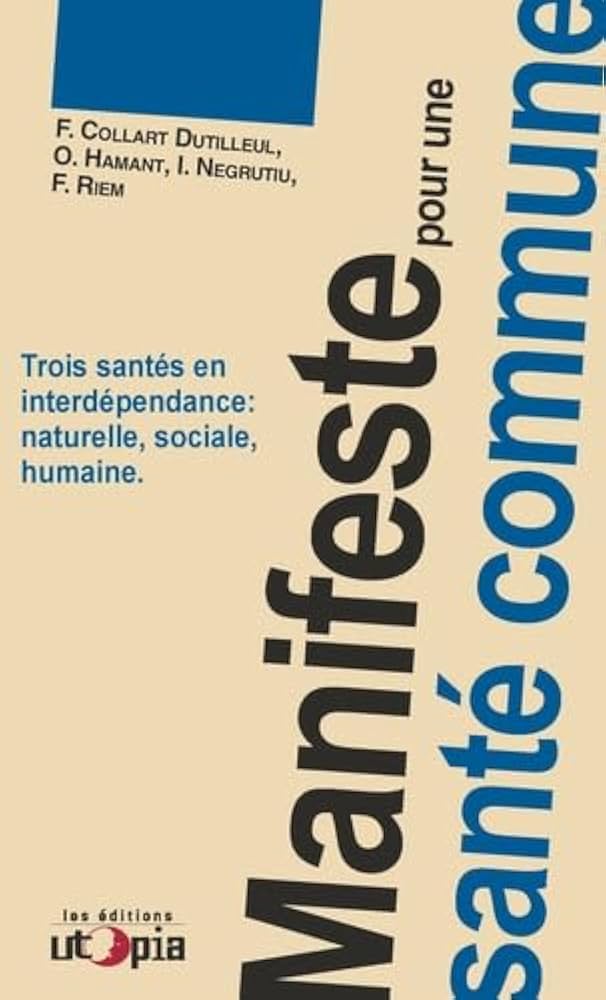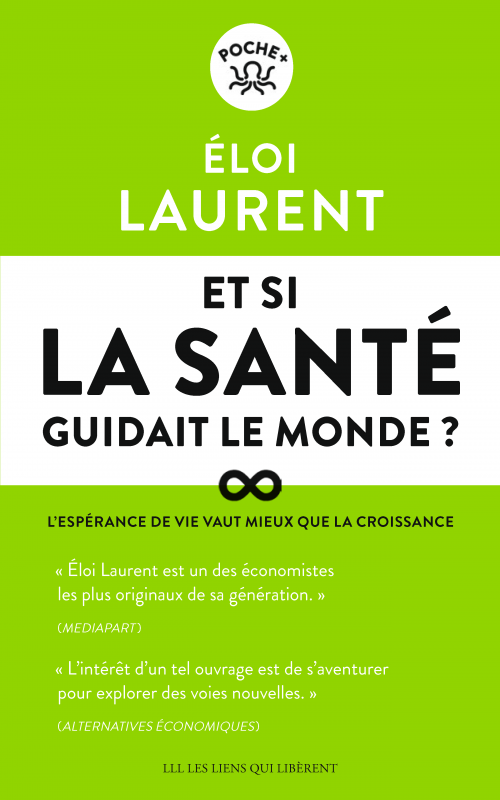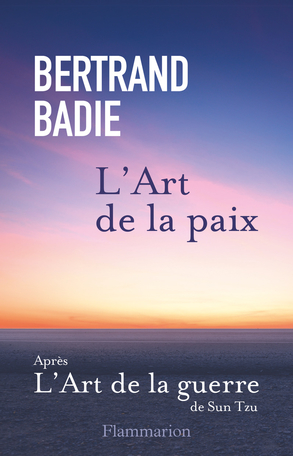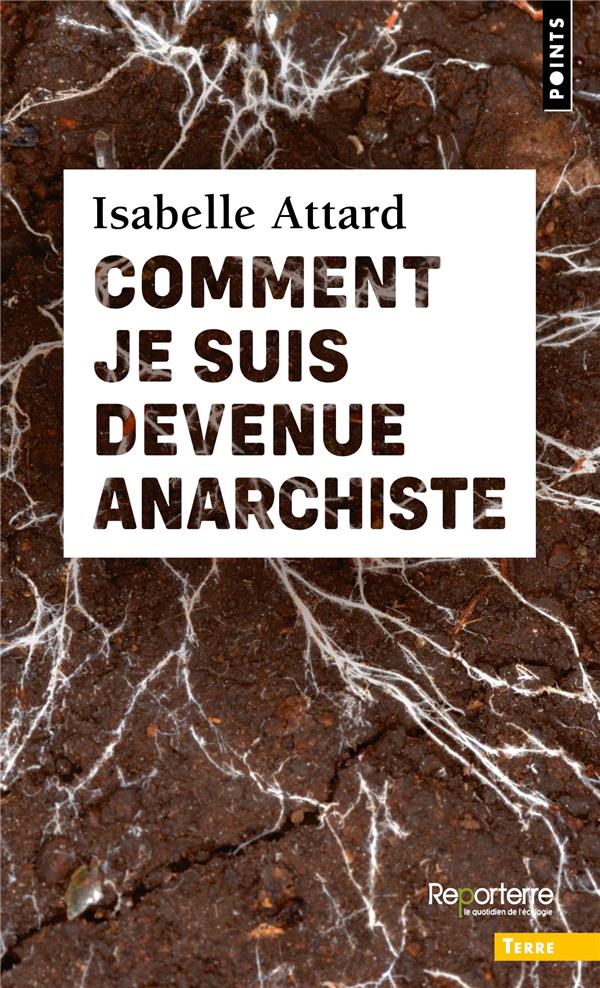Michael Sandel, Éditions Albin Michel, 2021
La culture américaine actuelle est imprégnée d’une vision méritocratique qui veut que « ceux qui travaillent dur et respectent les règles iront aussi loin que leurs talents les portent ». Michael Sandel, professeur de philosophie politique à Harvard, porte un regard sévère sur cette vision méritocratique qui, creusant les écarts entre les gagnants et les perdants, sapent les bases de la démocratie et nous éloignent toujours plus du bien commun.
L’ouvrage commence par l’histoire d’une tricherie médiatisée en 2019 : trente-trois parents fortunés avaient payé un expert spécialiste de la manipulation du système d’admission des universités pour permettre à leurs enfants – qui n’avaient pas le niveau – de rentrer dans les universités les plus prestigieuses des Etats Unis. Ce cas particulier, malheureusement pas isolé, donne l’occasion à l’auteur de poser la question : « pourquoi l’admission dans les universités prestigieuses est-elle à ce point recherchée qu’elle conduise les parents privilégiés à commettre des fraudes ». La réponse se trouve dans la croissance des inégalités depuis plusieurs décennies. Ces tricheries correspondent à la « réponse angoissée mais compréhensible aux inégalités croissantes » pour des parents qui veulent éviter à leurs enfants la précarité que connaissent les classes moyennes, le diplôme représentant une garantie méritocratique. Le cas de l’admission à l’université n’est qu’une facette de la réflexion sur le mérite. Ce qui est en jeu, c’est une vision de « la manière dont nous définissons le succès et l’échec, la victoire et la perte, et sur les comportements que les vainqueurs devraient adopter vis-à vis de ceux qui réussissent moins bien qu’eux ».
Aujourd’hui la montée de la xénophobie et le soutien populaire croissant à des figures autocratiques mettent à rude épreuve la démocratie. Analysant les raisons de l’élection de Donald Trump, l’auteur l’attribue en grande partie à l’échec de l’idéal méritocratique américain : la croyance américaine selon laquelle on peut s’extraire de sa condition à condition de travailler dur ne correspond plus à la réalité empirique ». Beaucoup des perdants de la méritocratie ont « un sentiment d’humiliation et du ressentiment » – sentiment très bien exploité par Donald Trump –, face à des gagnants de la méritocratie qui ressemblent plutôt à « une aristocratie héréditaire », qui de plus faitun mauvais usage du pouvoir. « Les élites méritocratiques n’ont pas bien gouverné ».
Les votes pour des leaders autoritaires correspond donc à « un verdict de colère après des décennies d’augmentation des inégalités. Elle exprime une opposition à une forme de globalisation qui profite aux individus placés en haut de l’échelle sociale et maintient le citoyen ordinaire dans un sentiment d’impuissance ».
L’auteur consacre un chapitre à une « brève histoire du mérite ». Si aujourd’hui le mérite concerne l’emploi et la position sociale, dans le passé, la réflexion sur le mérite portait sur la faveur divine : Comment faire pour mériter le salut éternel ? Ce débat qui a opposé catholique et protestants a conduit à une « éthique méritocratique du travail que les puritains et leurs successeurs ont importé en Amérique ». Ce qui conduit à la vision providentialiste qui veut que « Les gens ont ce qu’ils méritent » Ainsi « les riches sont riches parce qu’ils sont plus méritants que les pauvres ». En poussant la logique jusqu’au bout, certains chrétiens conservateurs voient dans les catastrophes naturelles des punitions divines pour des personnes non méritantes. Cette « conception exaltée de la responsabilité individuelle contenue dans l’évangile de la prospérité est gratifiante quand tout va bien. Mais démoralisante, punitive même, lorsque les choses se passent mal ».
La suite de l’ouvrage permet à l’auteur d’analyser en détail les conséquences de la méritocratie. La rhétorique de l’ascension et de la responsabilité « a un côté cruel : les victimes des aléas du sort méritent notre aide, les responsables de leur propre infortune, non ». Par ailleurs « Depuis que la pensée méritocratique s’est imposée c’est bien le couple intelligent versus stupide qui apparaît prédominant », et le critère de l’intelligence, c’est le diplôme. La prime au diplôme (la différence de revenus entre un diplômé et un non diplômé) a plus que doublé en 20 ans. D’où une course vers les universités qui deviennent des « machines à trier ». Cette prime au diplôme « a infligé une blessure plus insidieuse aux travailleurs : elle a érodé la dignité du travail », car « aux yeux de la société, et peut être à leurs propres yeux, le travail ne fait plus partie des contributions valorisées au bien commun ». Et la tendance au développement d’une activité financière complètement déconnectée de la vie réelle et générant des revenus indécents n’est pas pour améliorer les choses. « Le prestige disproportionné dont bénéficient les acteurs de la spéculation est un affront pour la dignité de ceux qui gagnent leur vie en produisant des biens et des services utiles pour l’économie réelle ». Pour reprendre la terminologie utilisée lors de la pandémie de COVID,les « premiers de corvée » ne supportent plus de voir les « premiers de cordée » s’enrichir sans contribuer au bien commun.
Un ouvrage très riche ou l’auteur explore vraiment à fond – au point qu’on peut avoir l’impression parfois de redites – les différents aspects de la méritocratie, ses sous-jacents idéologiques et ses conséquences politiques et économiques. La conclusion claire est que « l’ère du mérite » et la vision individualiste qui l’accompagne, a défait les liens sociaux. Il va nous falloir en sortir et retrouver le sens du bien commun « Il faut aux citoyens un sens de la communauté suffisamment robuste pour dire que nous sommes tous dans le même bateau – non pas de manière rituelle comme une incantation pour temps de crise, mais comme une description plausible de notre vie quotidienne ».