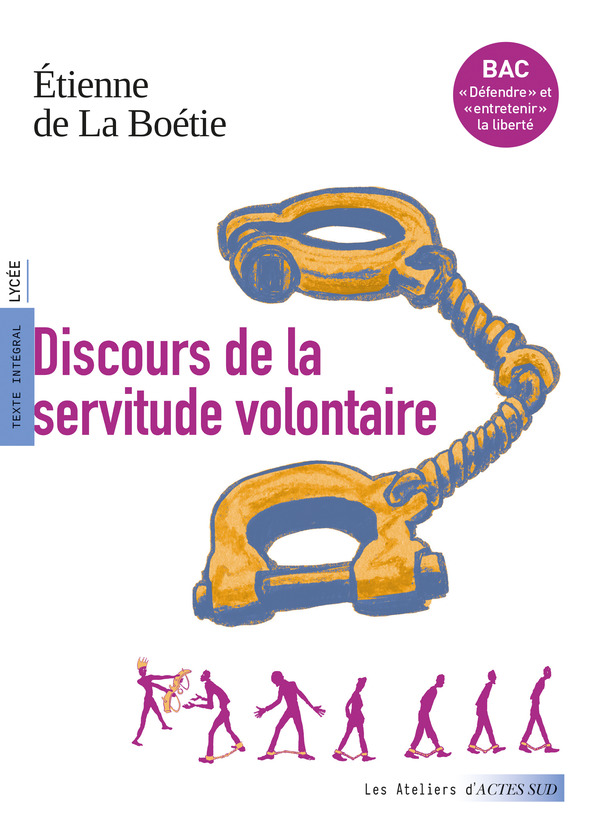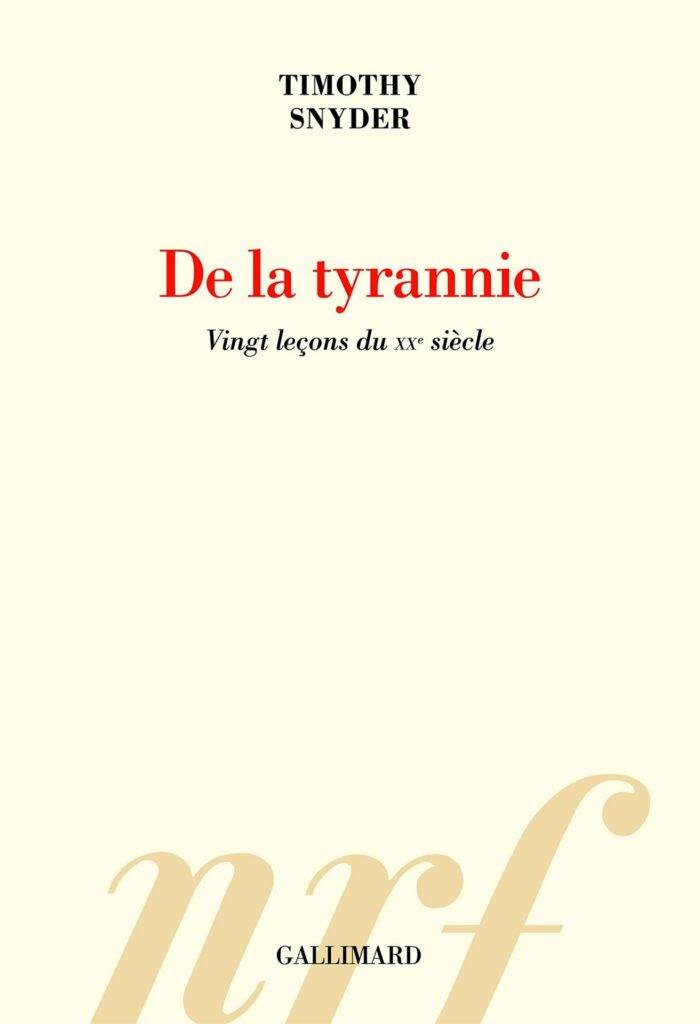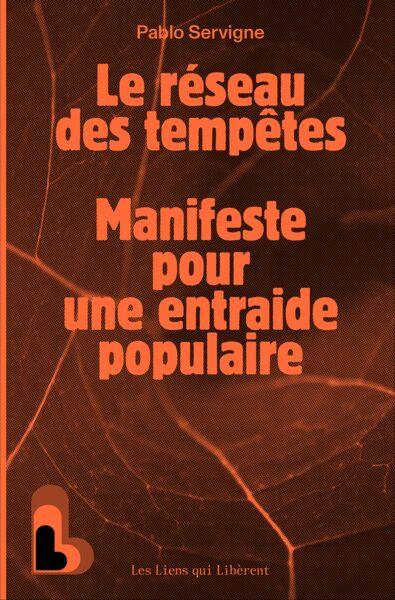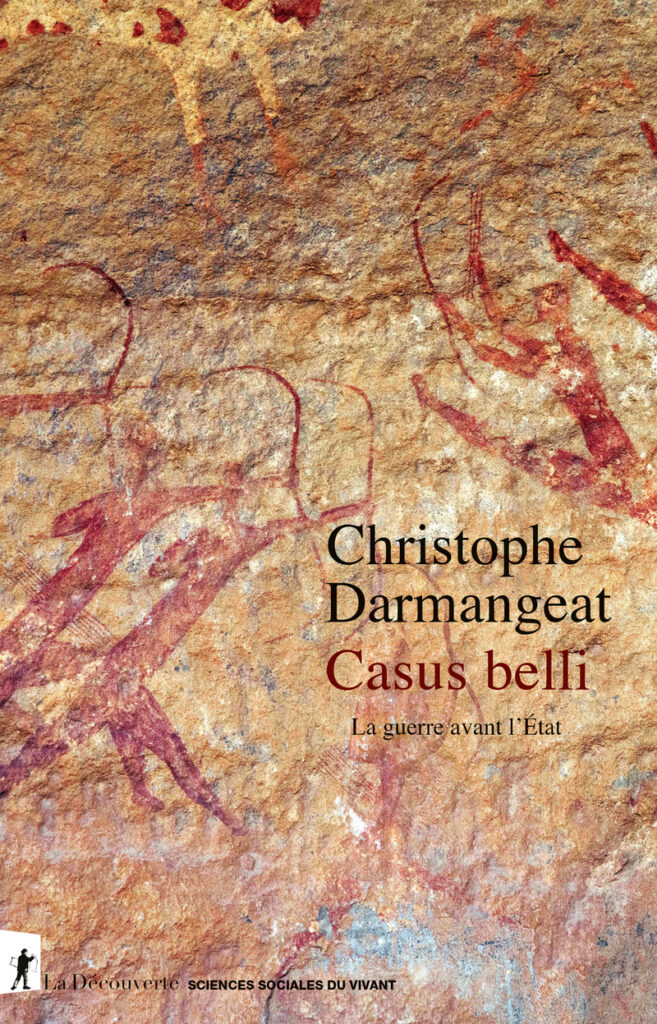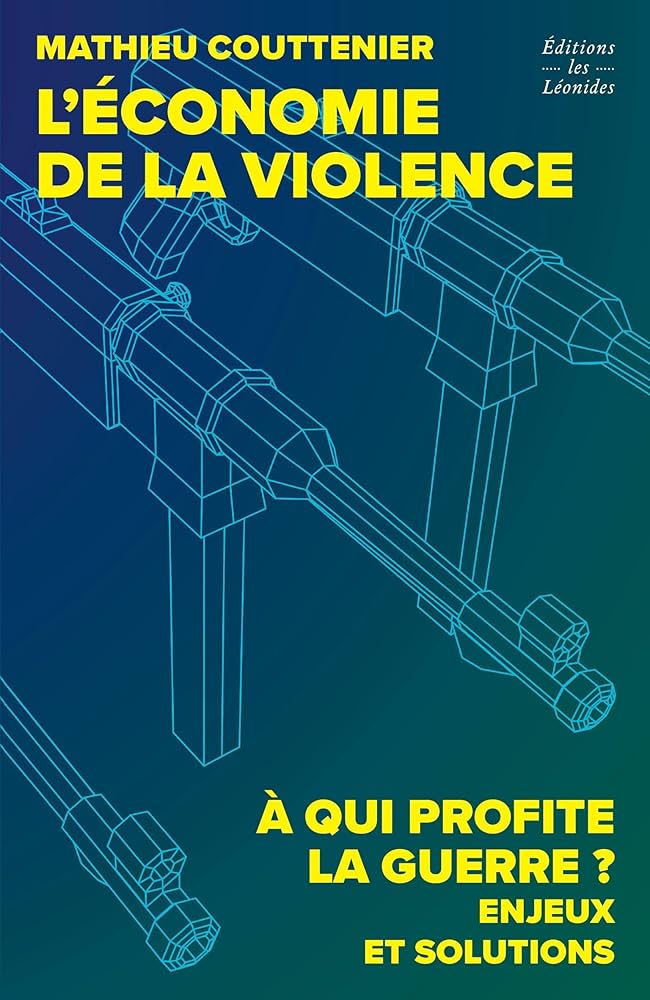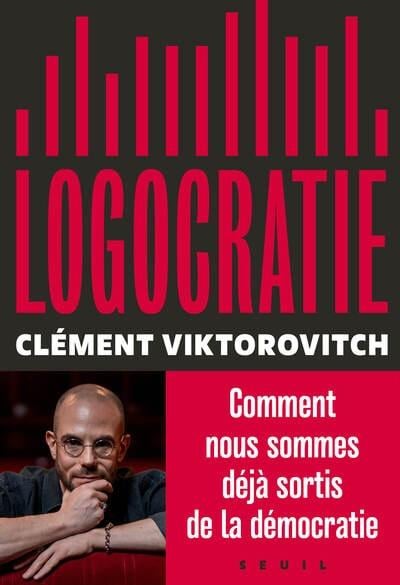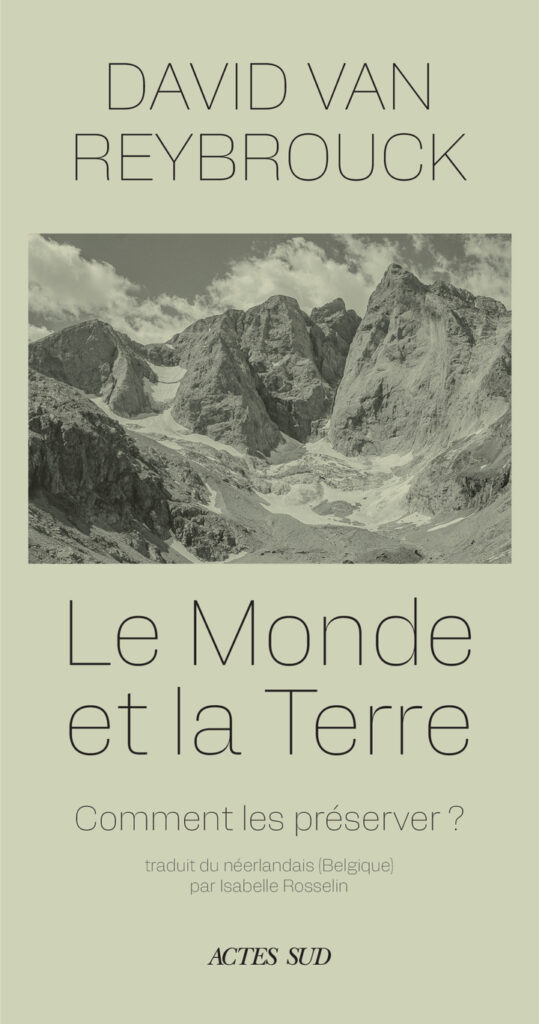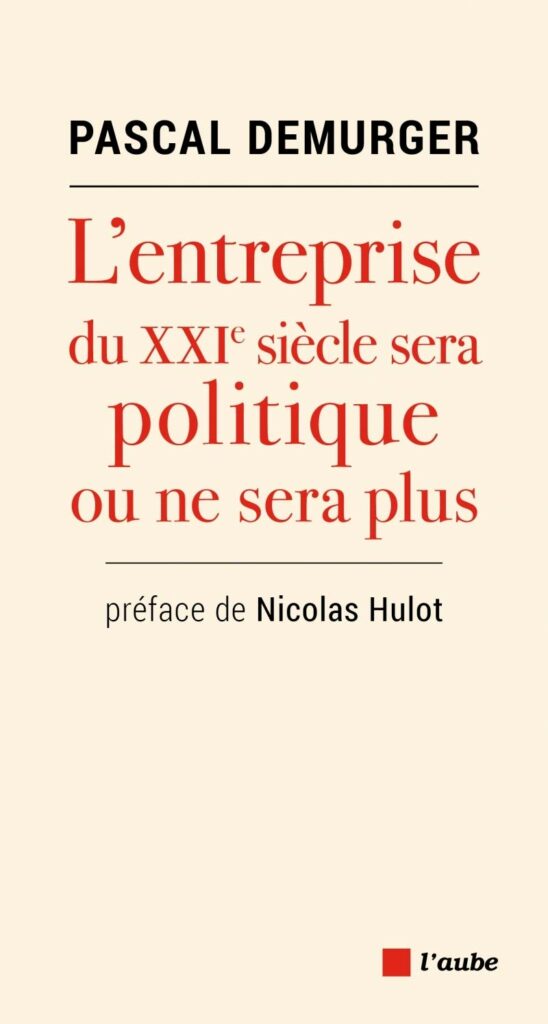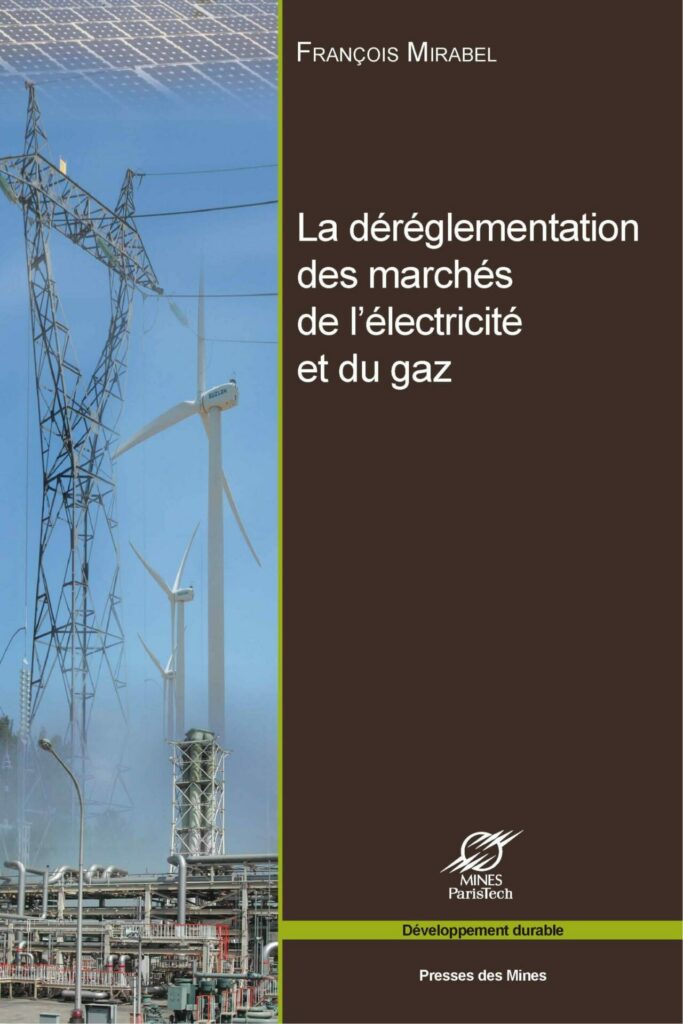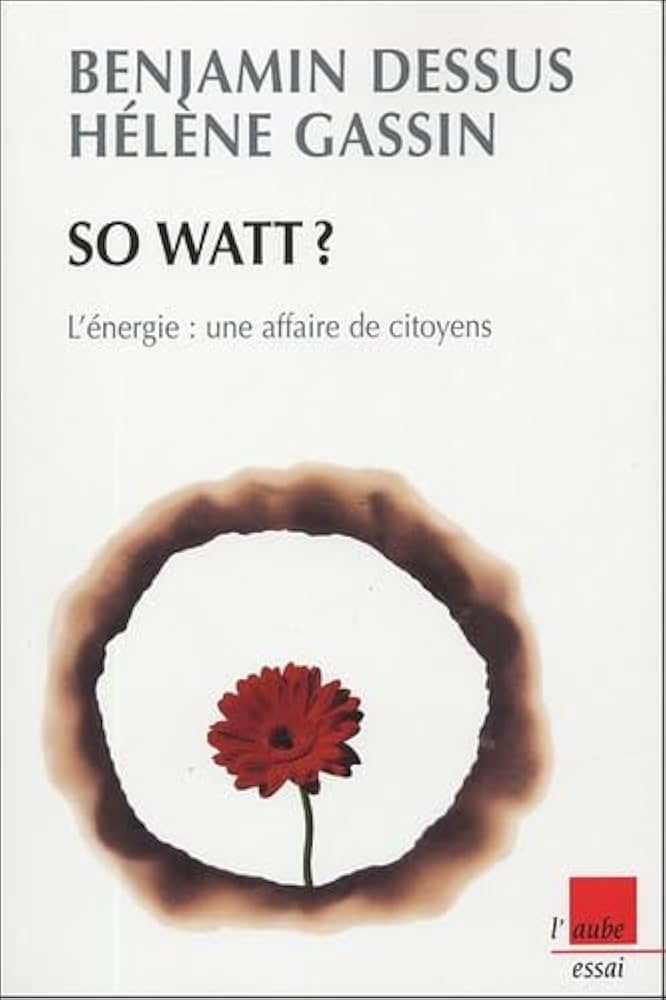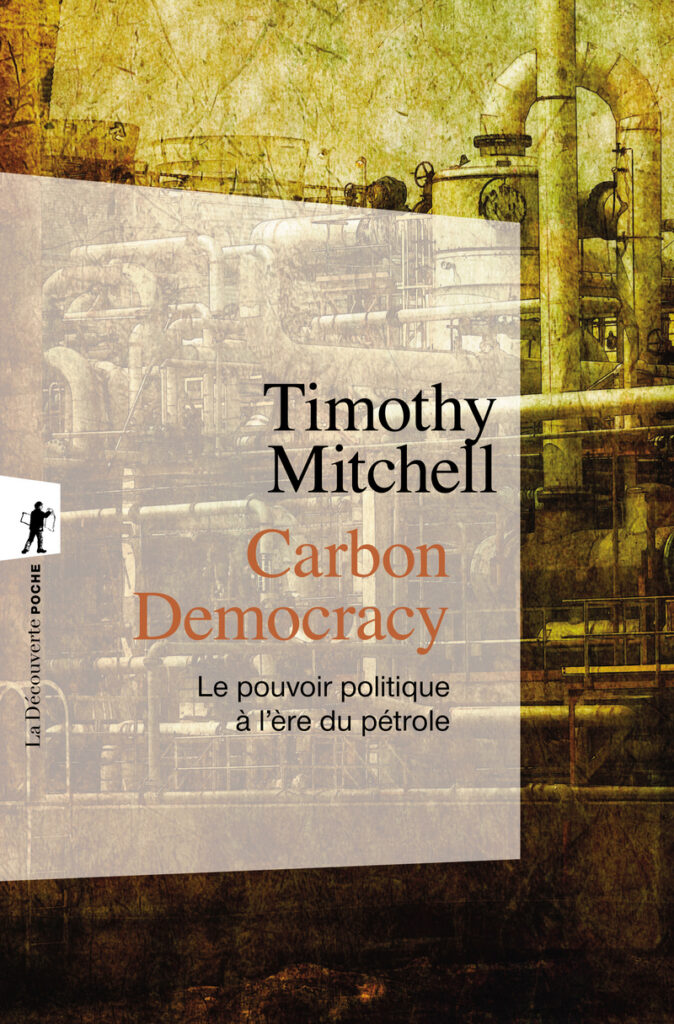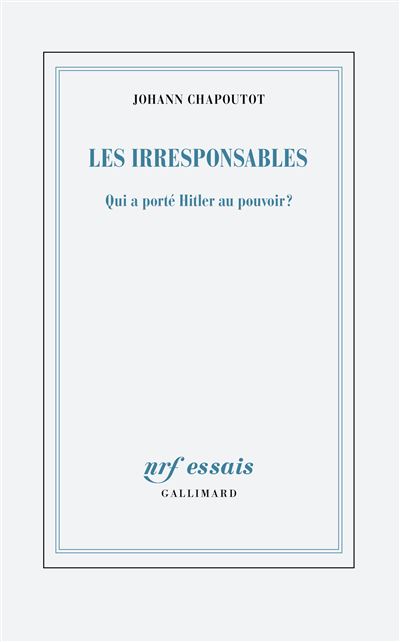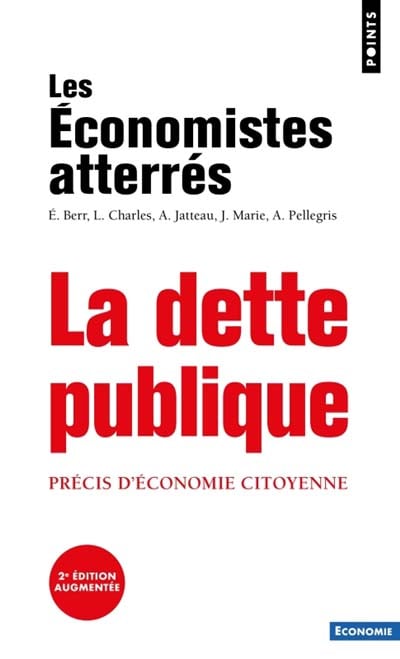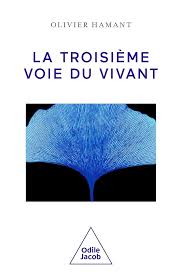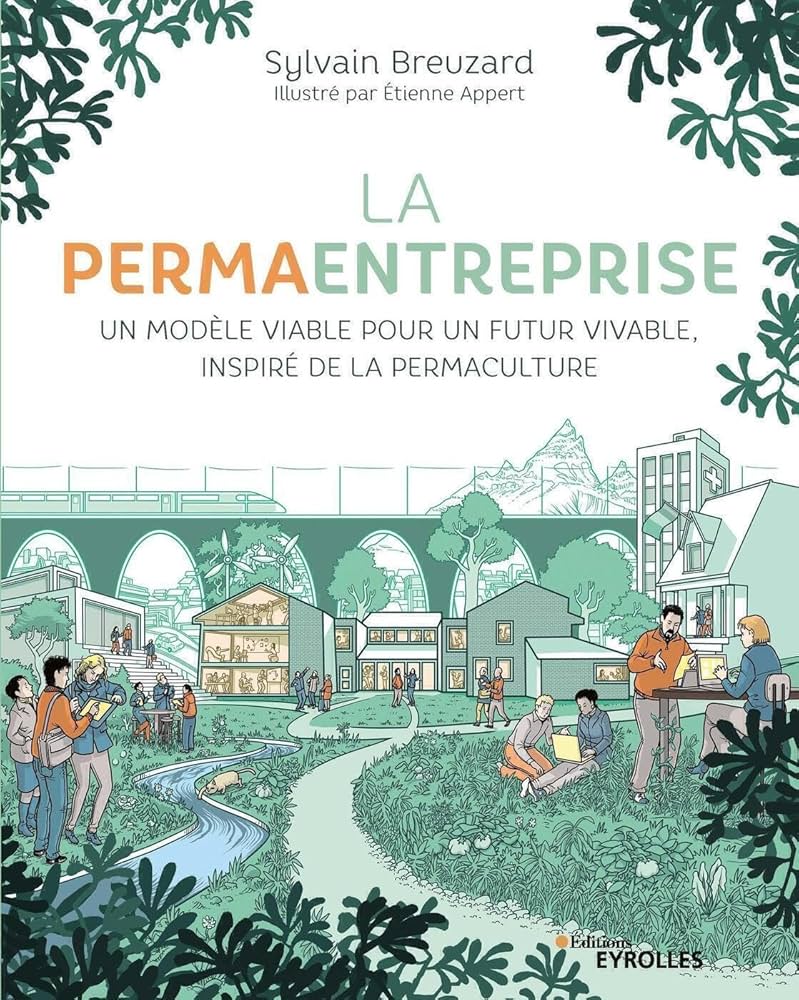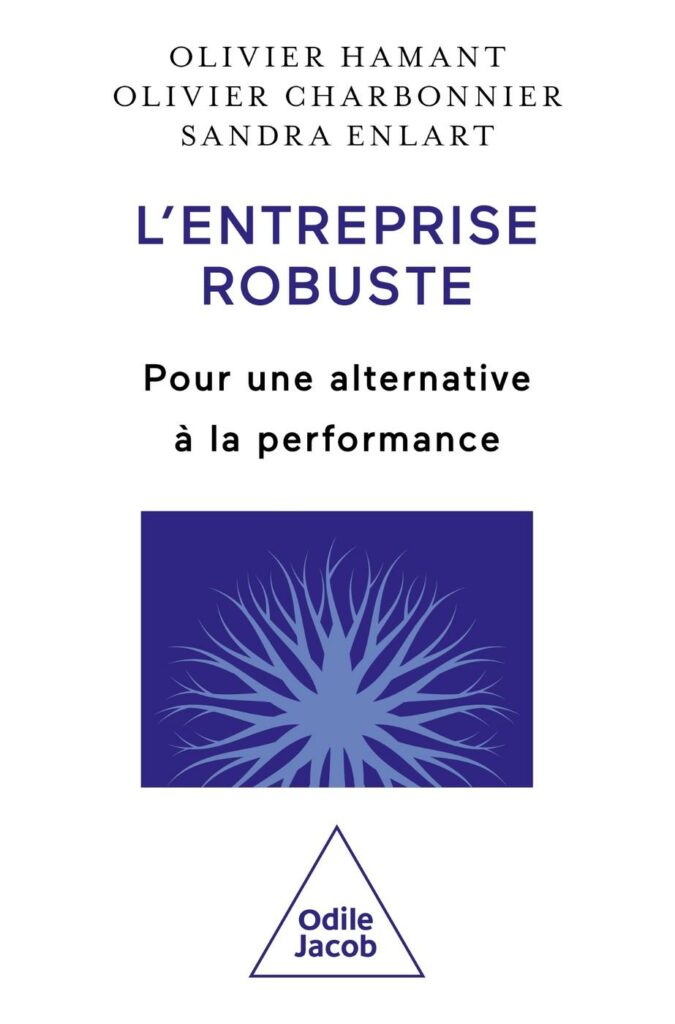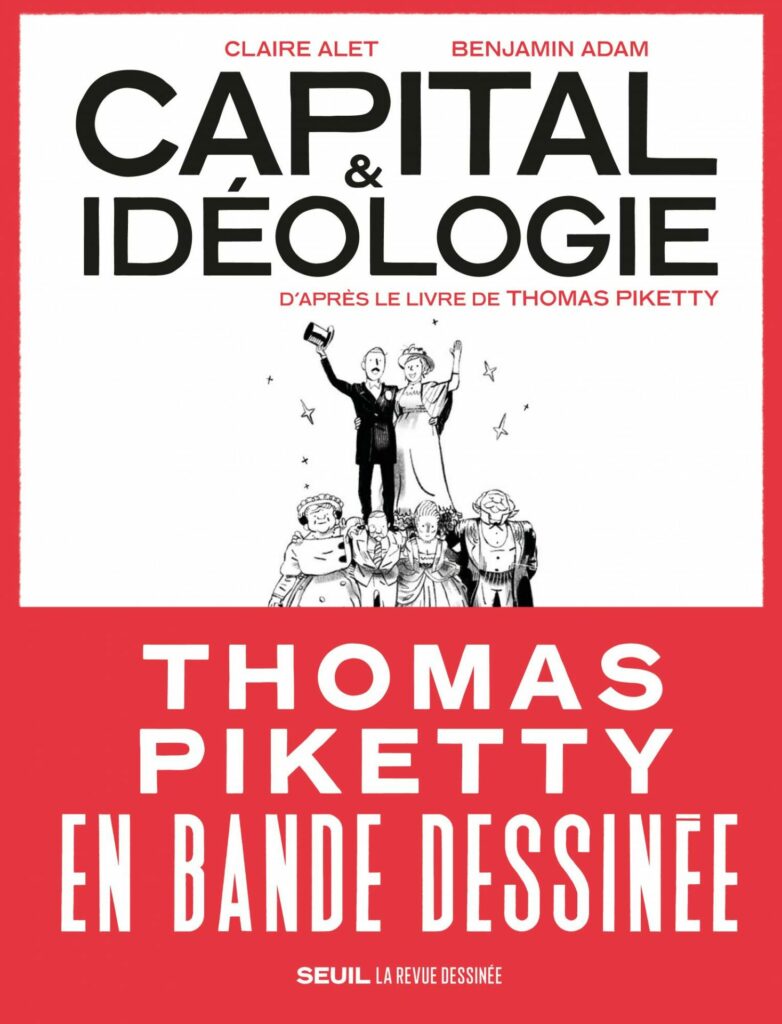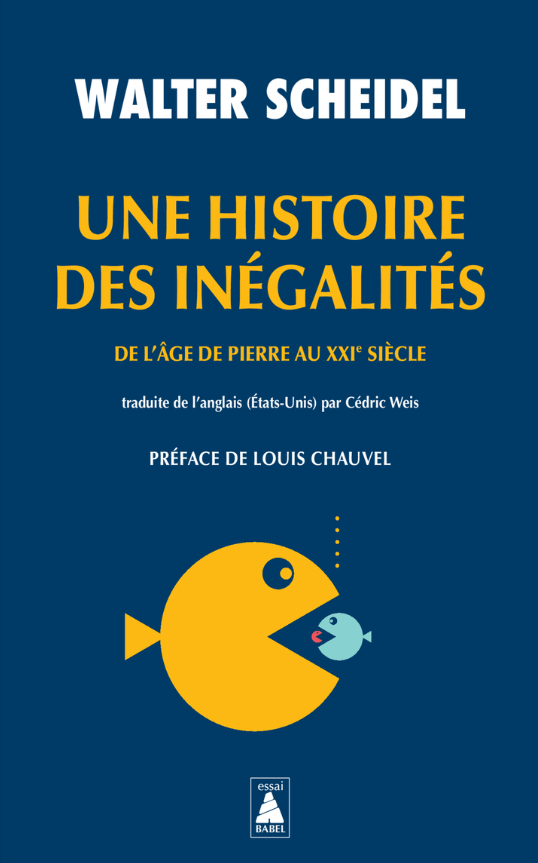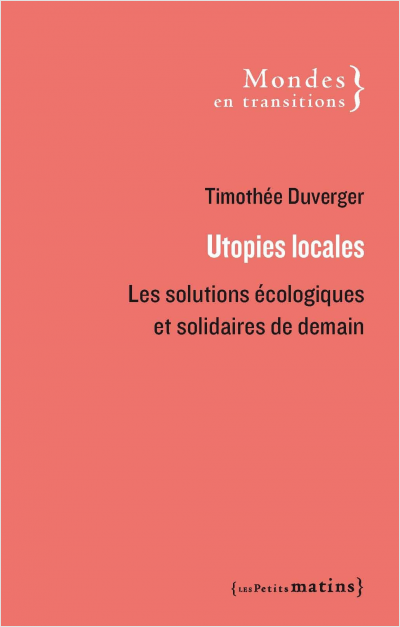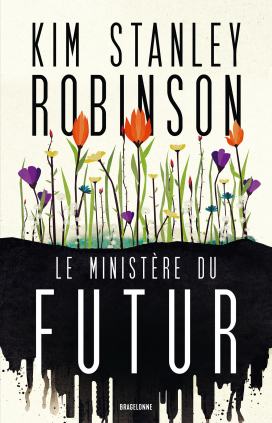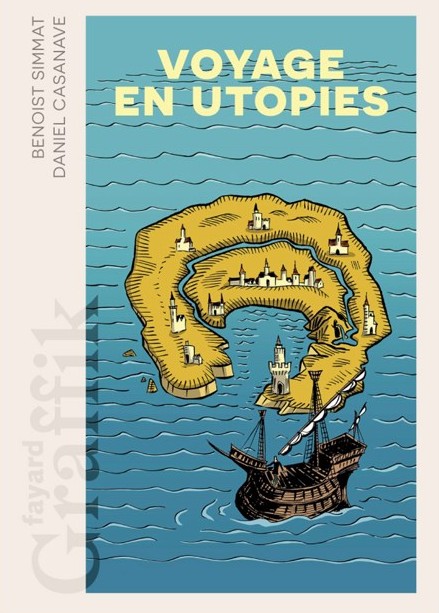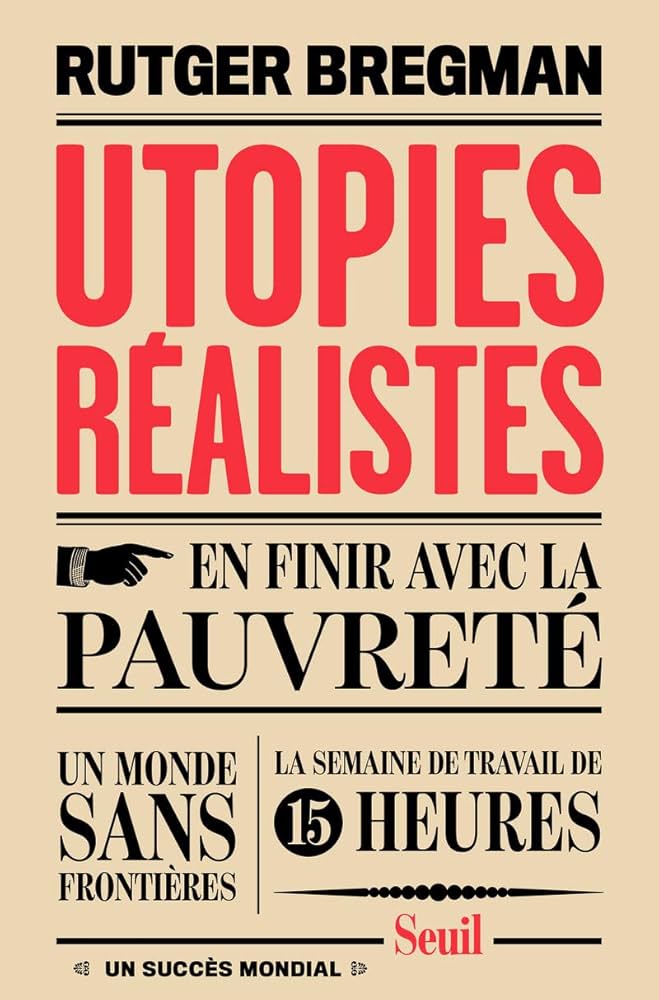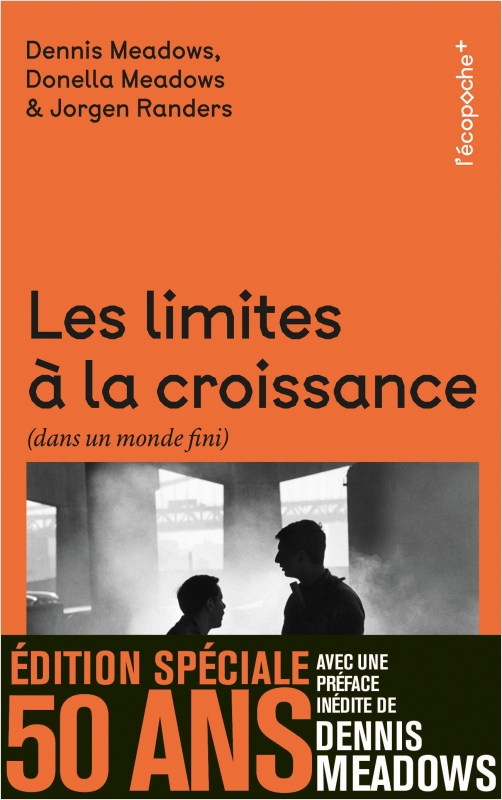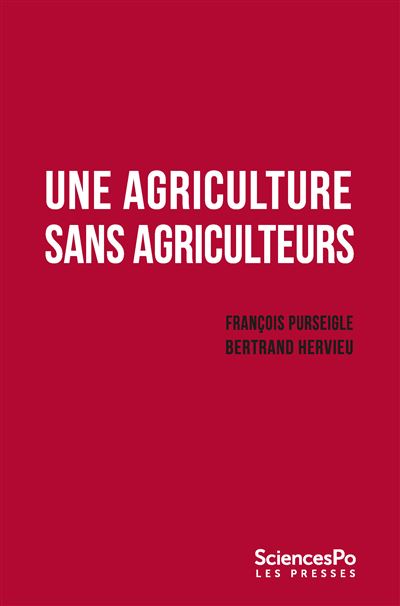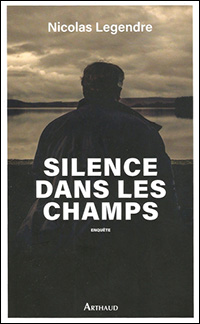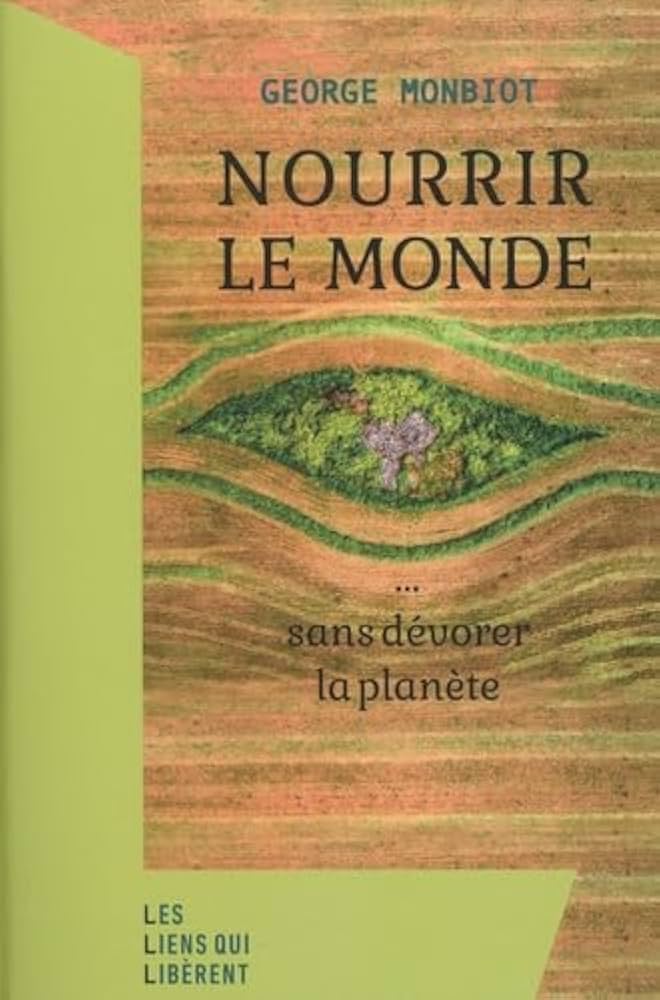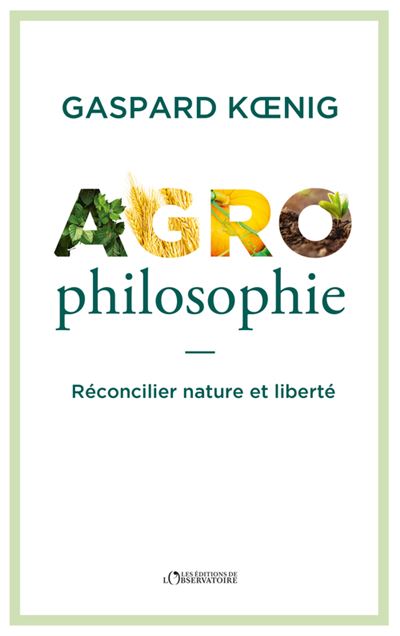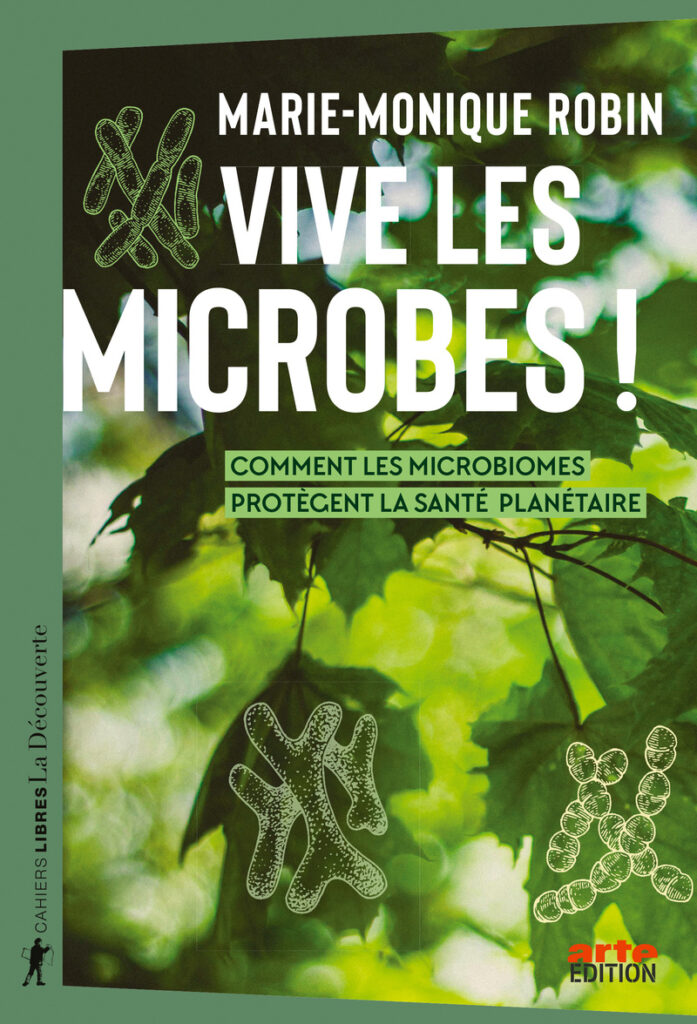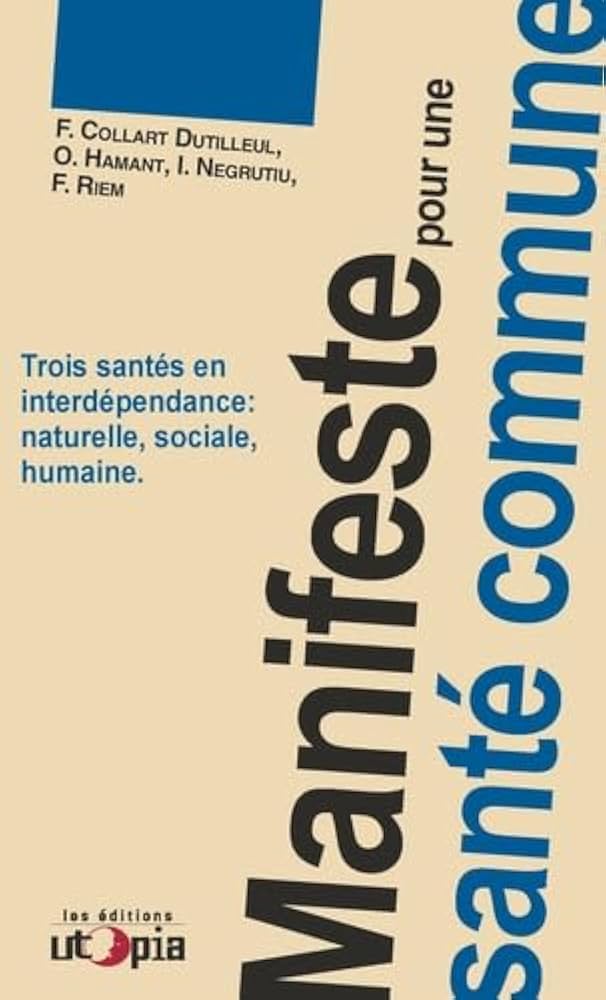Didier Fassin
« Le ciel du monde contemporain s’est fortement obscurci au cours des dernières décennies aussi bien dans l’approfondissement des inégalités dans nombre de sociétés… que dans la progression des idéologies et des partis mêlant autoritarisme et néolibéralisme. Dans ces temps sombres la violence est devenue plus visible ». D’où le titre « Leçon des ténèbres » utilisé par Didier Fassin, médecin et anthropologue, professeur au collège de France pour cet ouvrage qui traite de la violence et de ce qu’elle dit de notre monde. Structuré en dix chapitres, correspondants aux 10 leçons données par Didier Fassin au Collège de France au printemps 2025, l’ouvrage est très transdisciplinaire. « C’est dans une perspective anthropologique, sociologique et historique que je me propose dans ce livre de traiter de la violence, mais j’y convoquerai aussi des œuvres littéraires, d’autant que la frontière entre les 2 champs n’est certainement pas étanche ».
La première des grandes questions traitées par l’auteur, c’est le savoir : qu’est-ce que la violence ?
Si la littérature et la philosophie se sont emparées depuis longtemps du sujet de la violence, ce n’est que très récemment que l’anthropologie et la sociologie s’y sont intéressées. « Le contraste est notable entre cette lenteur des sciences sociales à se saisir de l’objet qu’est la violence et la multiplicité des écrits des philosophes, d’intellectuels et d’écrivains qui s’en emparent tout au long du 20e siècle ».
Peut-être est-ce la « représentation commune qu’anthropologue et sociologue se faisaient des sociétés et de ce qu’elles devaient être en termes d’unité d’identité et de cohésion » qui ont fait que pendant très longtemps des violences comme la violence coloniale ont été ignorées.
Plutôt que nous assener une définition, l’auteur nous emmène ensuite en quête des origines de la violence. « Il est souvent plus intéressant et surtout plus utile de problématiser une notion ou un concept que de le définir, autrement dit d’ouvrir des questions plutôt que d’enfermer dans une convention. C’est pourquoi renonçant à la quête d’une définition j’ai préféré cette enquête autour de sa matière ». Cette enquête commence dans la mythologie « La violence originaire est donc inscrite dans les récits mythiques et les textes sacrés, dans les tragédies antiques et les chroniques médiévales ». Et c’est souvent en mobilisant ces récits mythiques que sont justifiées des violences contemporaines.
Le dernier chapitre de cette première partie s’intéresse à des « généalogies de la violence », avec les visions de Nietzsche, Foucault, Freud, Rousseau, Hobbes… sur le sujet.
La deuxième des grandes questions traitées par l’auteur, c’est de savoir ce que l’on peut faire face à la violence. « Je vais donc la traiter comme objet d’une recherche portant sur les manières de l’écrire, de la représenter, de l’attester, de la qualifier et finalement, peut-être, de la comprendre, et même de la refuser ».
Écrire la violence, c’est ce qu’a été fait par de nombreux auteurs de romans. Didier Fassin analyse à travers quelques exemples « les solutions imaginées par des autrices et des auteurs pour rendre compte des différents points de vue ». Il se penche ensuite sur l’écriture de la violence en sciences sociales qui « n’a pas la fluidité et la consistance de celle des ouvrages de fiction » plus contrainte qu’elle est que la littérature.
Représenter la violence : « S’agissant de représentations de la violence, je m’attacherai à deux violences collectives et à deux modes de représentation : la violence coloniale à travers les textes et la violence guerrière à travers l’image ». C’est ainsi que le roman « Heart of Darkness » de Joseph Conrad et le rapport de Roger Casement, consul de Grande-Bretagne au Congo ont permis de représenter la violence coloniale au Congo au tout début du 20e siècle. Et le monde de l’image dans lequel nous vivons permet à chaque partie de représenter sa vision des guerres.
Écrire la violence ou représenter la violence sont des moyens de l’attester, « contre celles et ceux qui détiennent ou ont détenu des pouvoirs et ont souvent intérêt à ce que les violences qu’ils ont perpétrées ne soient pas connues ». D’où l’importance des témoins, que ce soient ceux qui ont assisté à la scène de violence, ceux qui en ont été victimes, ou ceux, extérieurs au fait violent, qui apportent le poids de leur crédibilité ou leur expertise.
« Parler de violence suppose donc qu’on ait qualifié ainsi un acte ou un fait, autrement dit qu’il en a été socialement décidé ». Le premier niveau de qualification consiste à établir que l’acte considéré est effectivement violent. Cela correspond d’un côté à un jugement moral – pendant longtemps frapper un enfant quand on estimait qu’il avait commis une faute a eu une connotation positive, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui en France – et d’un autre côté un jugement pénal défini par la loi. « Mais il est des situations dans lesquelles la qualification de premier ordre n’a pas lieu car elle est volontairement écartée notamment en raison de ses implications judiciaires. C’est le cas des violences policières ». L’auteur consacre plusieurs pages à ce qu’il appelle la violence d’État, qui ne se limite pas aux violences policières d’un État envers ses citoyens, mais à toutes les violences commises par des États envers d’autres populations, comme la guerre en Ukraine ou ce qui est qualifié par beaucoup de génocide à Gaza. Dans tous ces cas « La qualification se joue à travers des relations de pouvoir et les questions morales qu’elle soulève sont sous-tendues par des enjeux politiques ».
La question du refus de la violence est complexe. Le dernier chapitre en explore les différentes formes, allant de la non-violence de Gandhi ou Martin Luther King, la désobéissance civile de Thoreau, les actions violentes mais légitimes puisque destinées à contrer la violence d’État comme le prônent Frederick Douglas et Franz Fanon. Ce peut être aussi le refus pour certains dominants de participer à une opération mortifère (objecteurs de conscience israéliens), ou « pour ceux qui se situent du côté dominé se soustraire par l’imagination à la terreur imposée par l’ennemi, tels les civils palestiniens sous les bombes ».
J’ai tenté à travers ces quelques lignes de résumer 10 remarquables leçons d’un grand penseur de notre temps. Mais il ne m’a pas été possible de rendre compte de toute la subtilité de la pensée de Didier Fassin, de tous les exemples concrets issus de son expérience personnelle, de tous les auteurs et tous les livres auxquels il fait référence. Je vous encourage donc vivement à découvrir cette exploration du sujet de la violence qui est écrit dans une langue très accessible.
« Un parcours se dessine qui m’a conduit à explorer la violence, des silences qui l’entourent aux récits qui la justifient, des théories qui la pensent aux romans qui la racontent, des témoignages qui l’attestent aux philosophies qui la refusent. Parcours au fil duquel n’ont pas été éludées les douloureuses questions morales et les complexes d’enjeux politiques ».