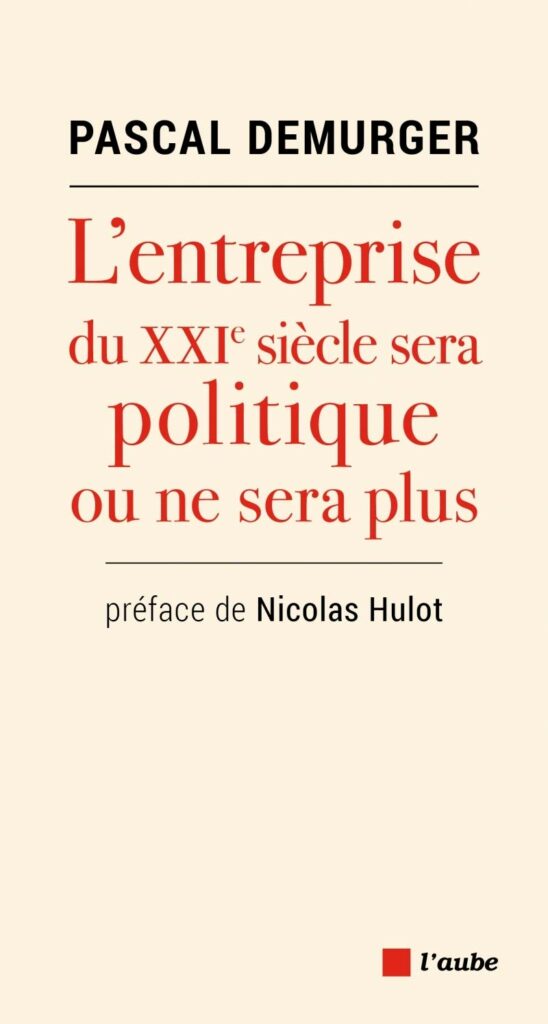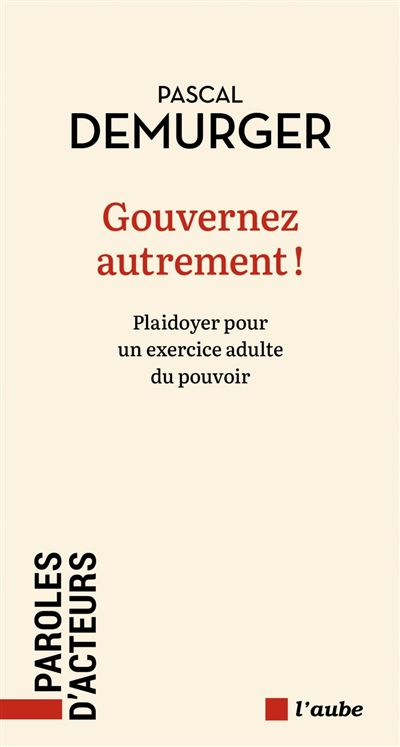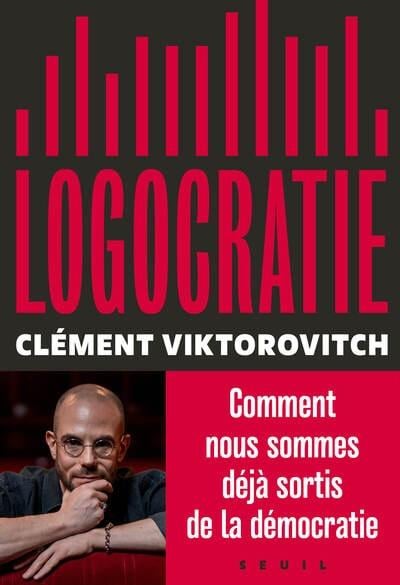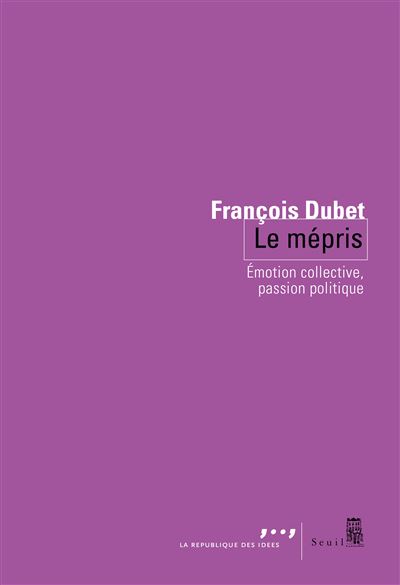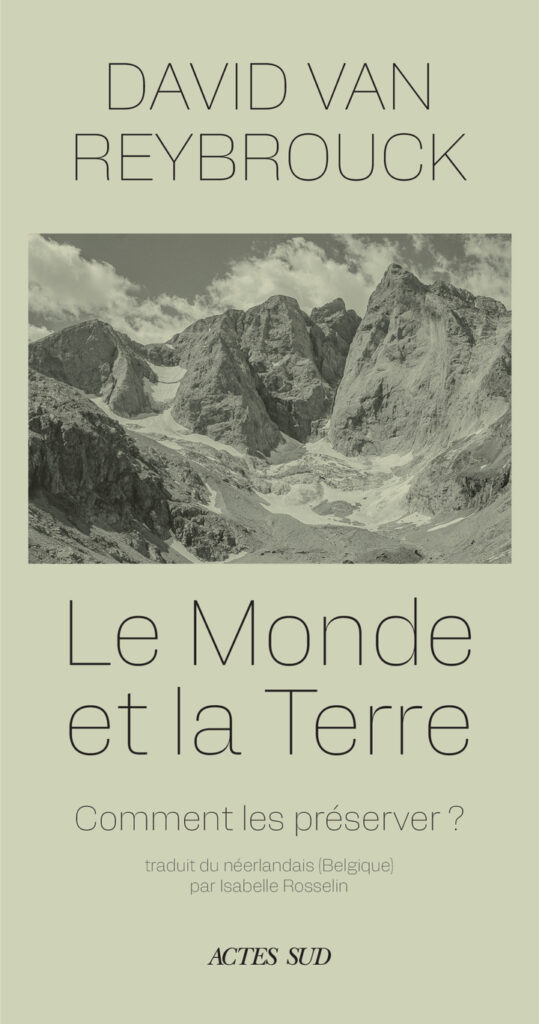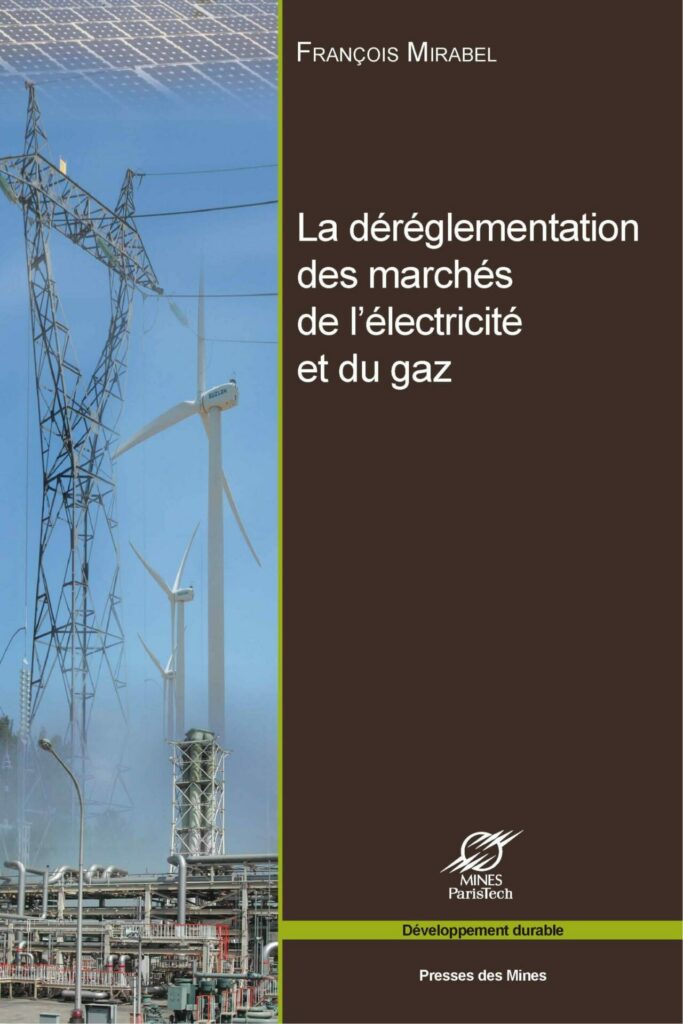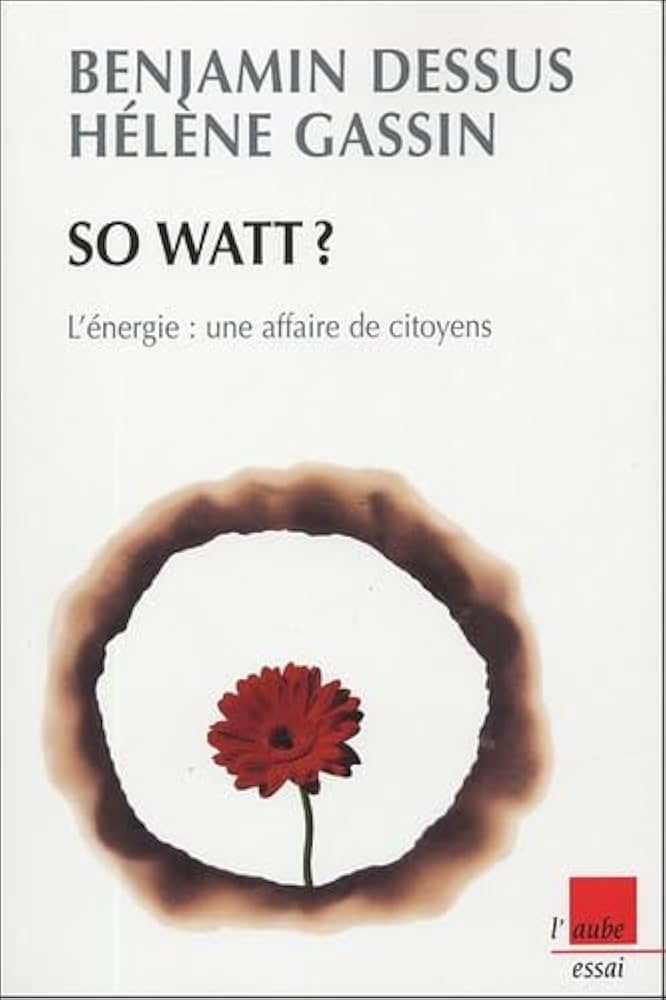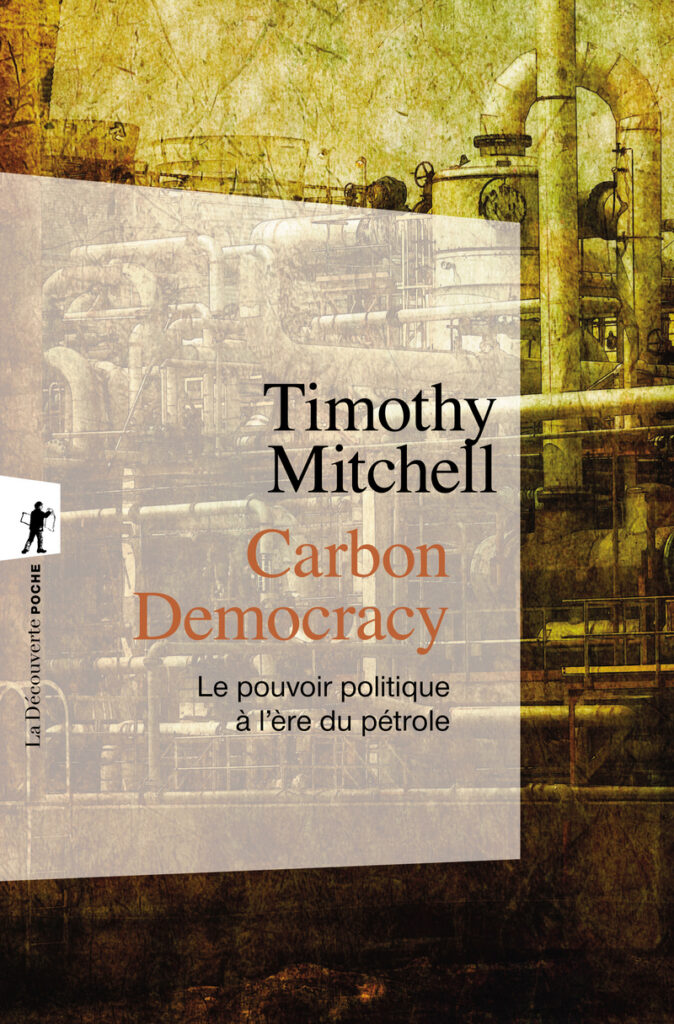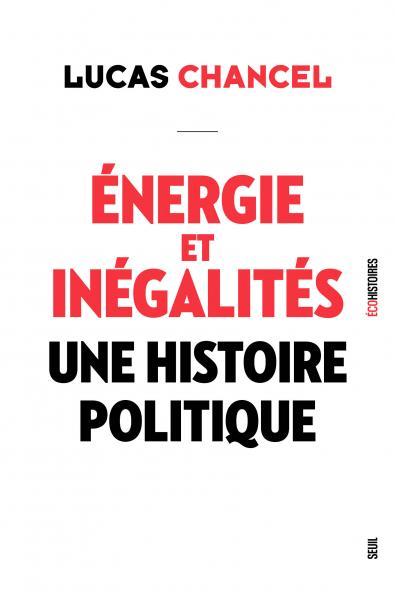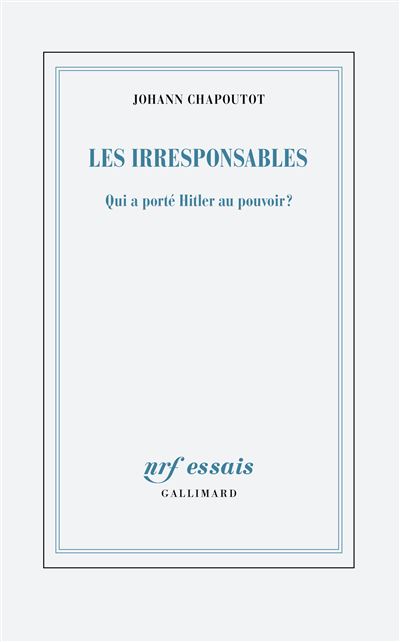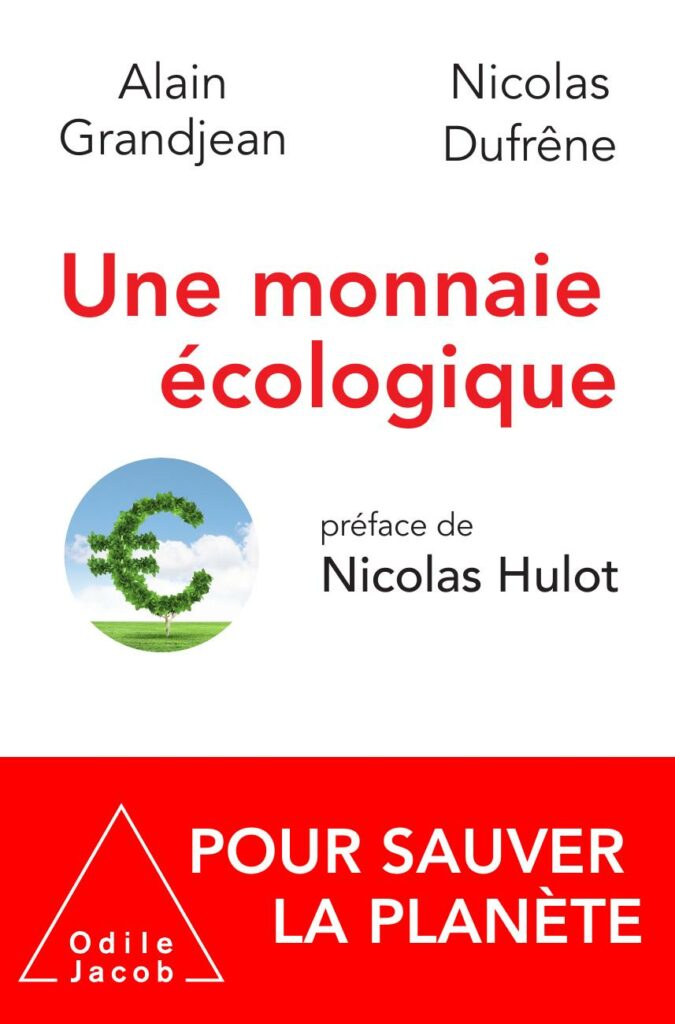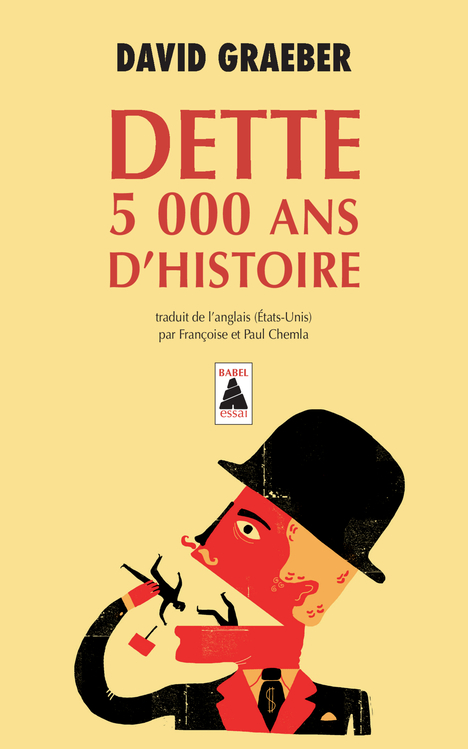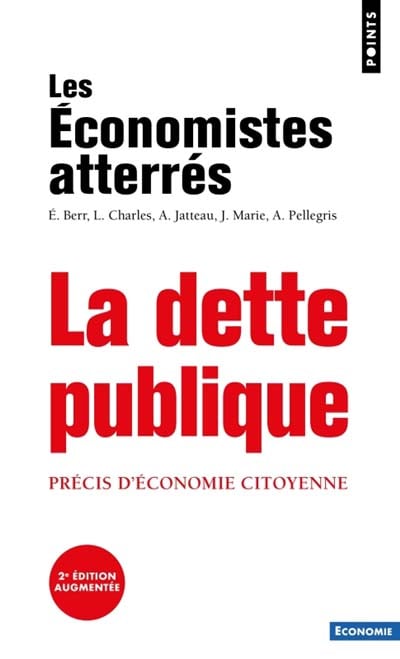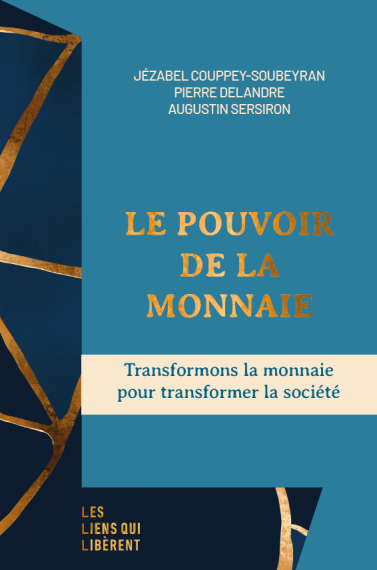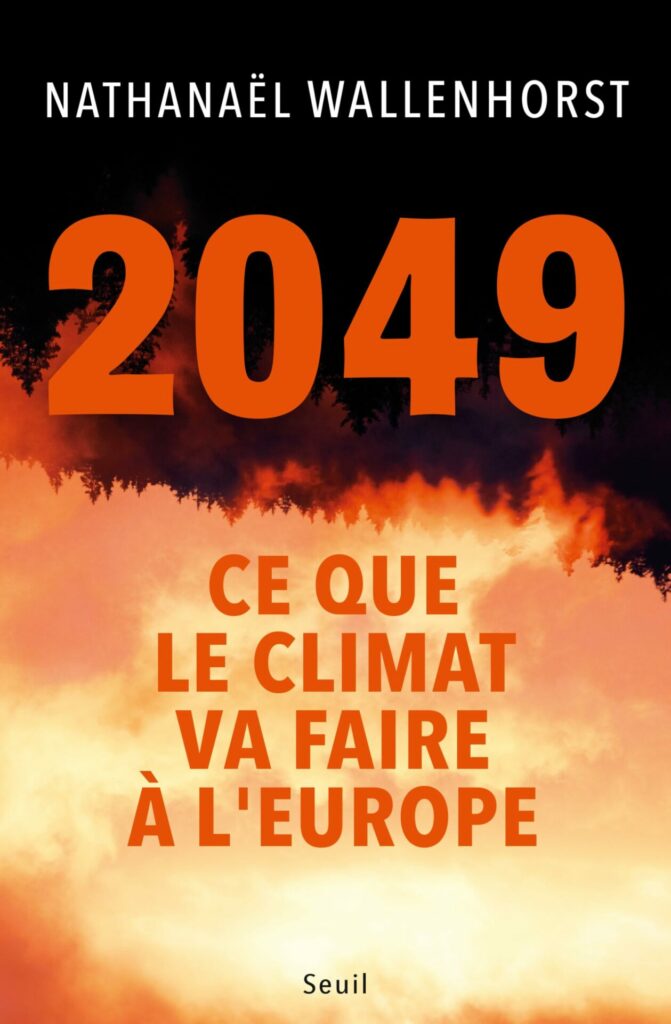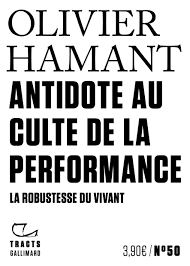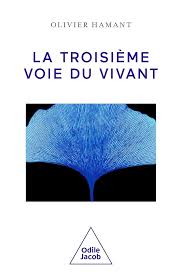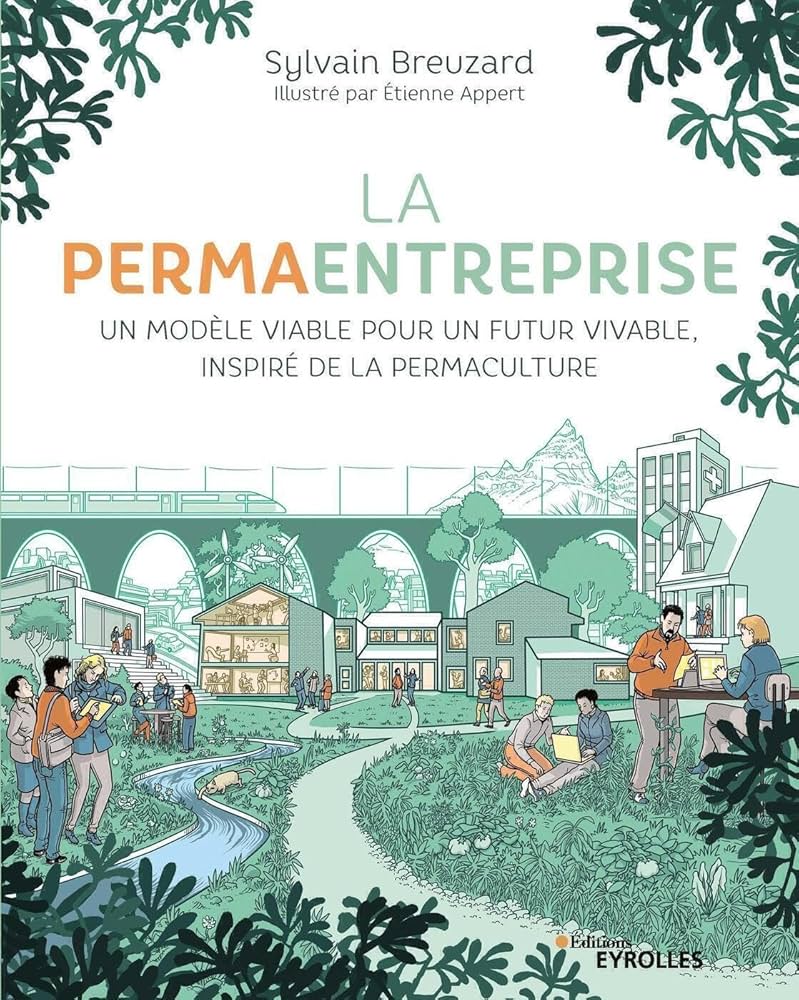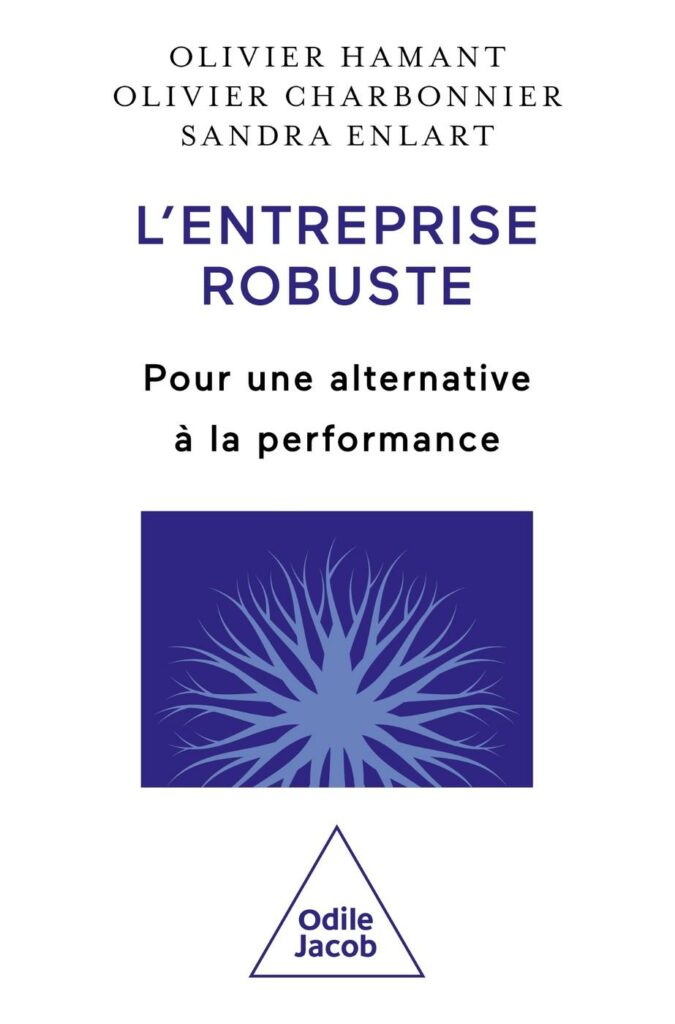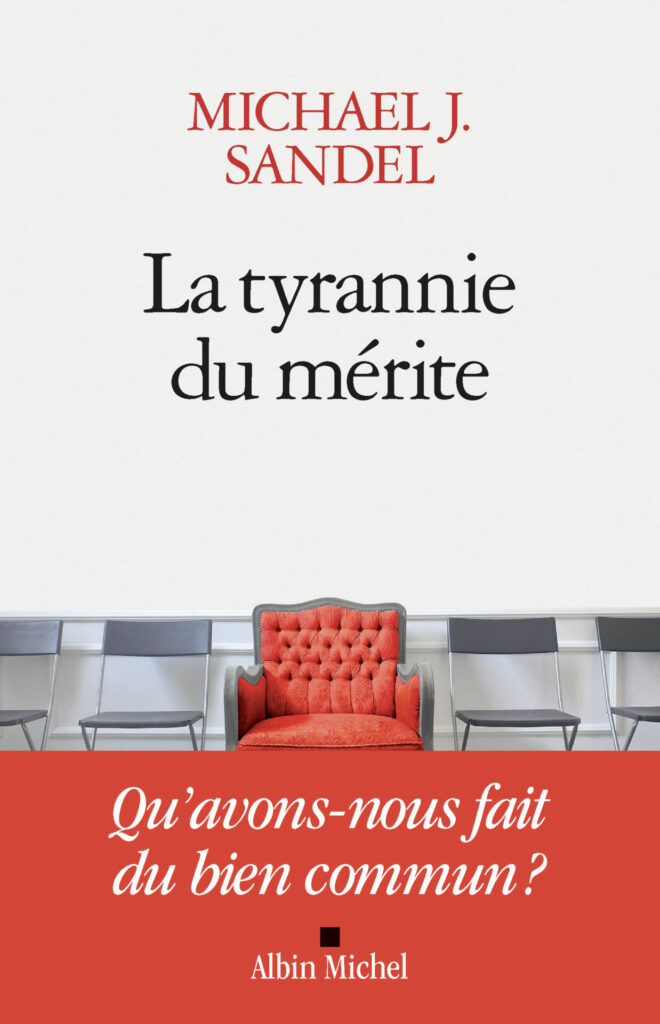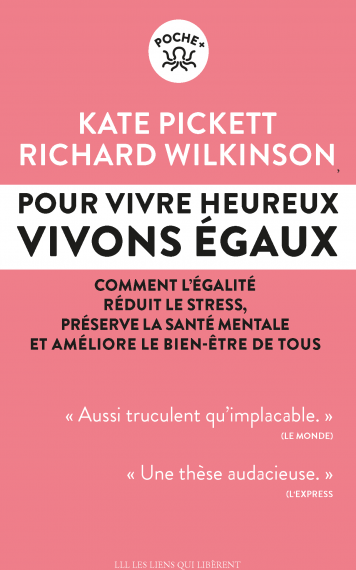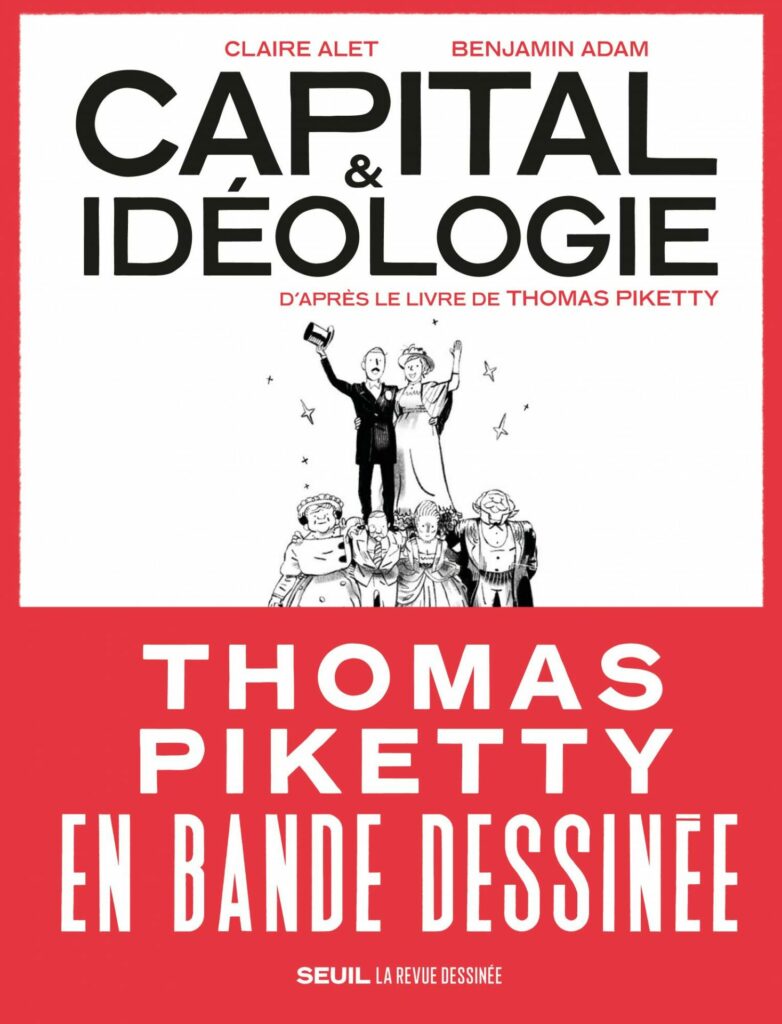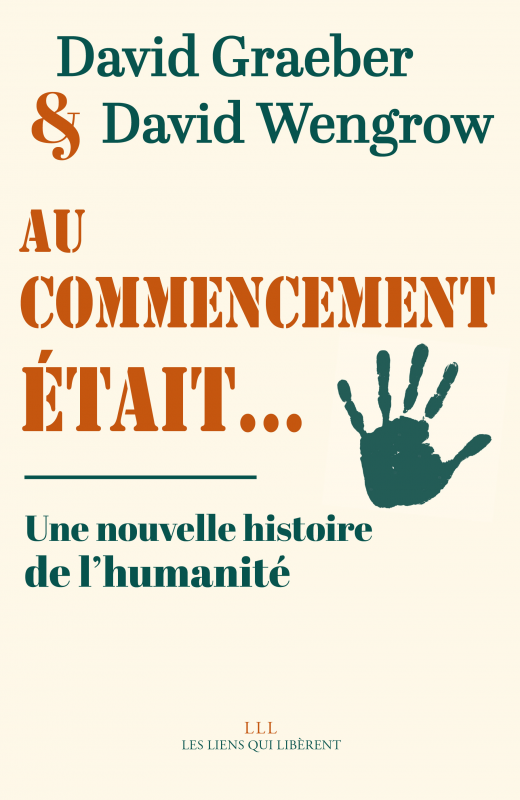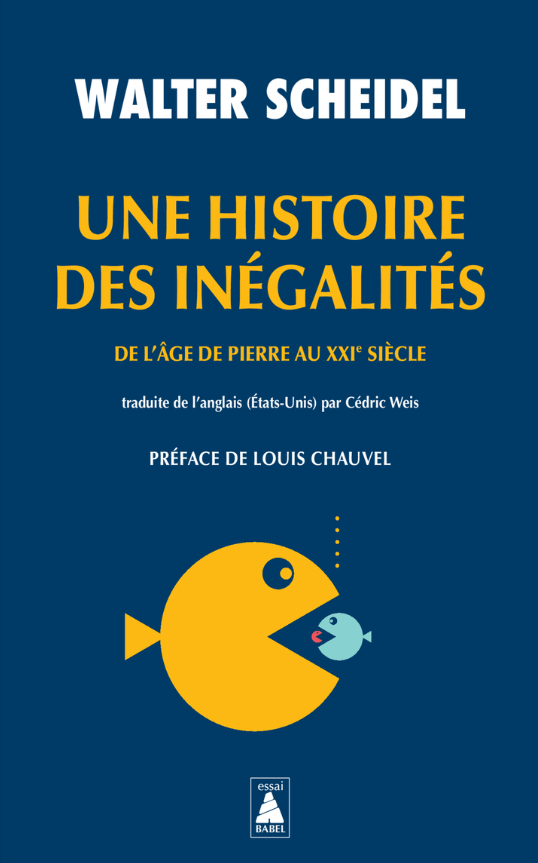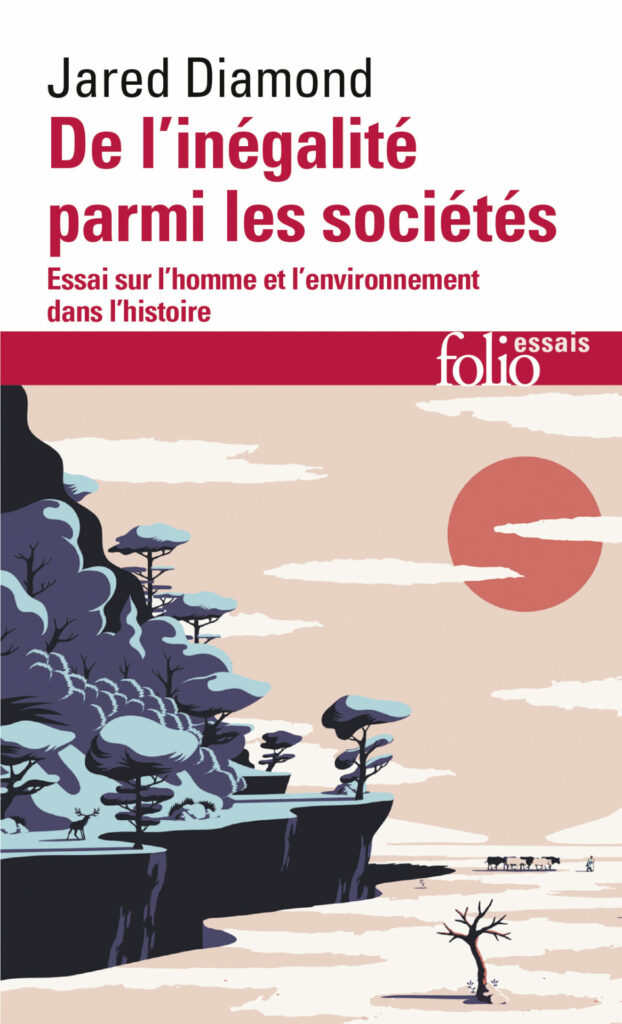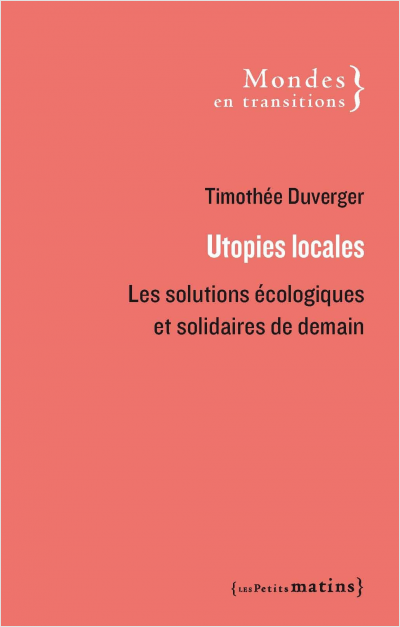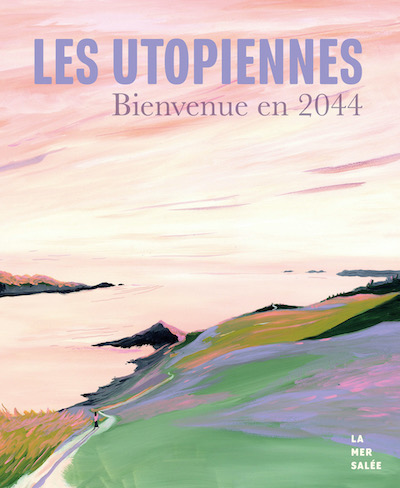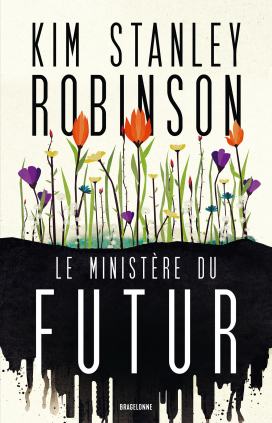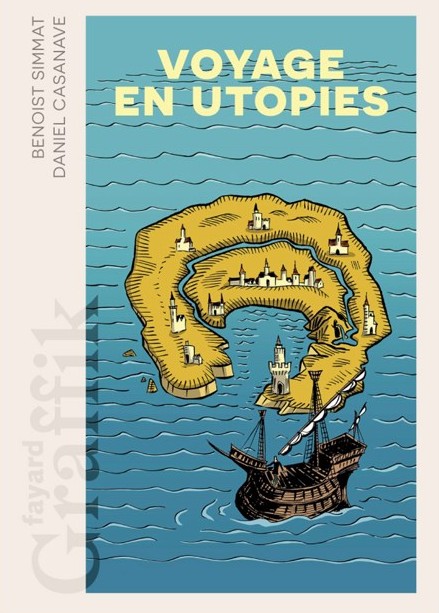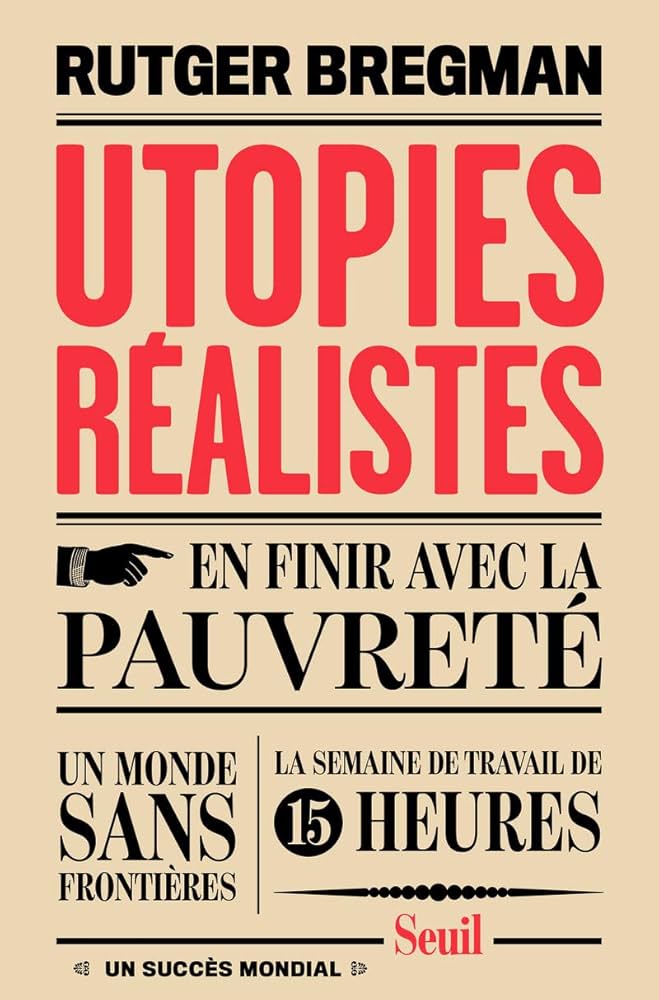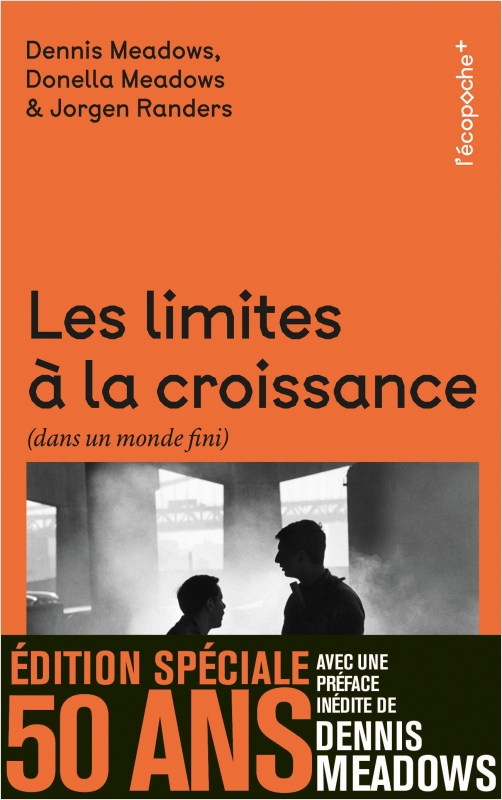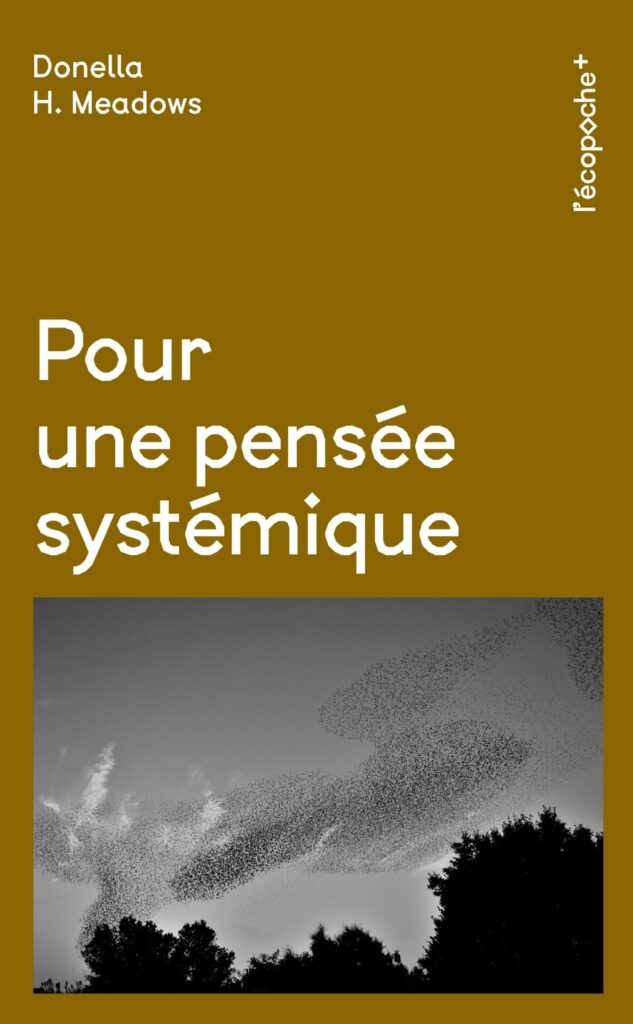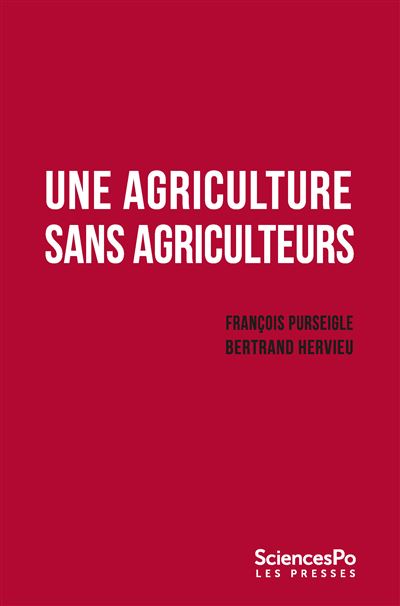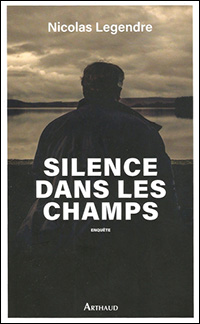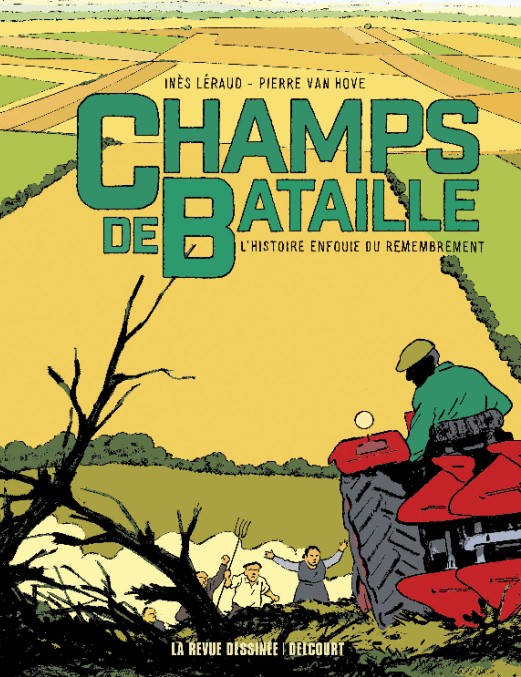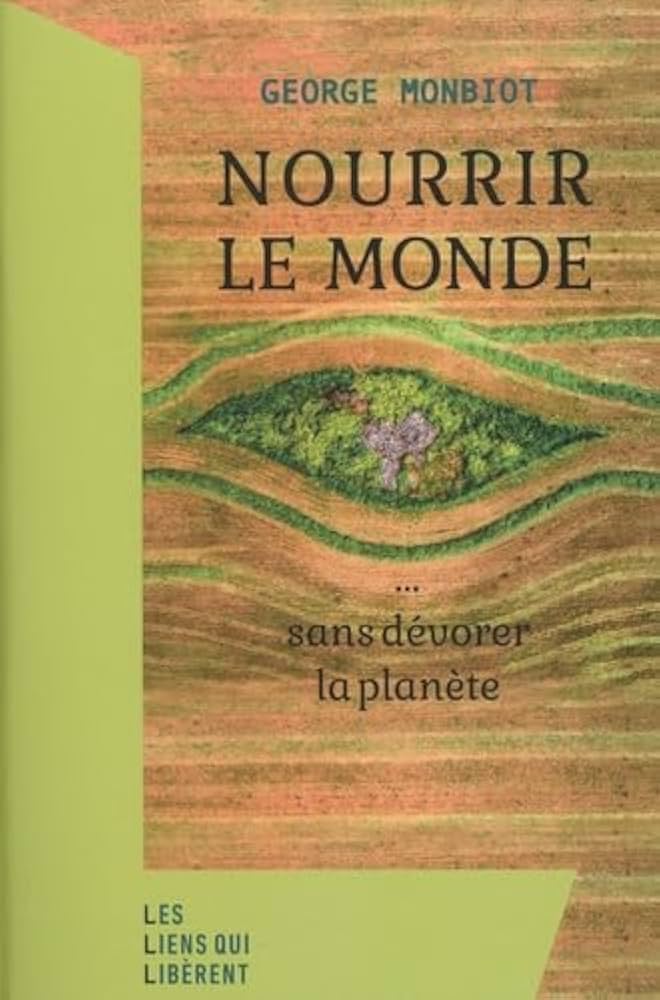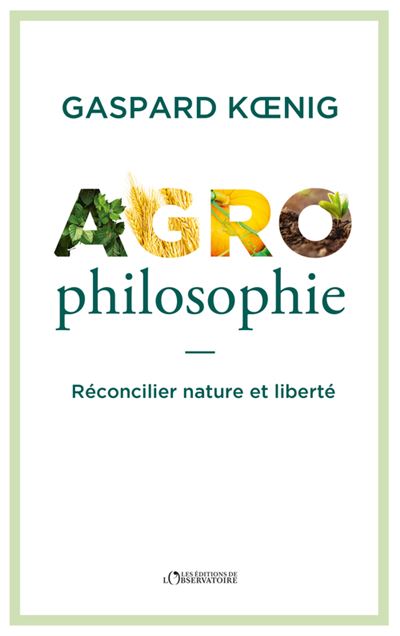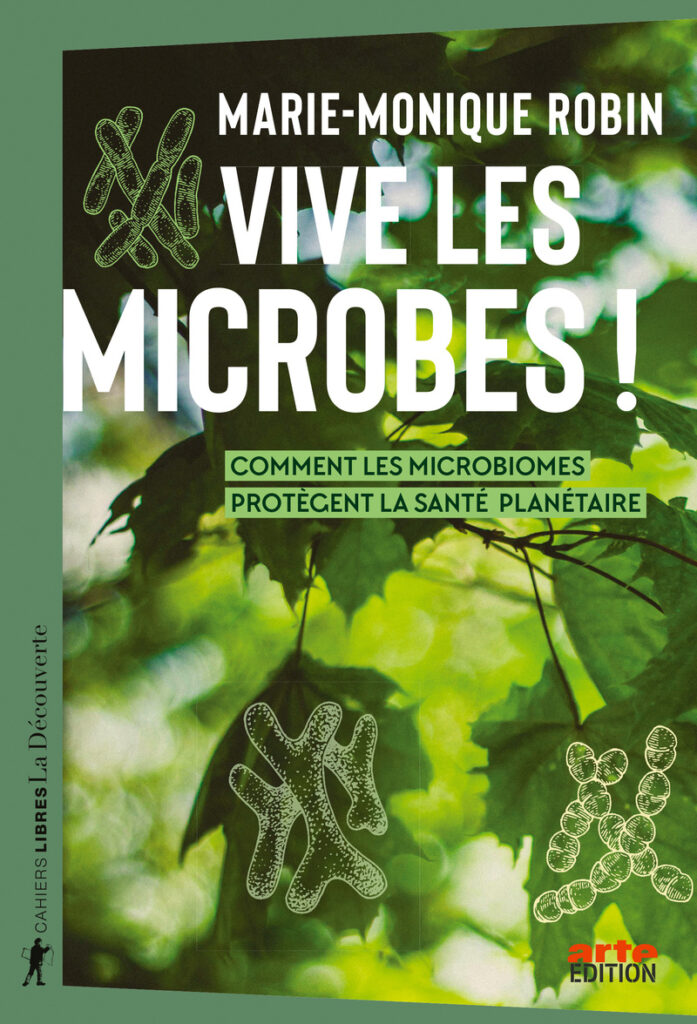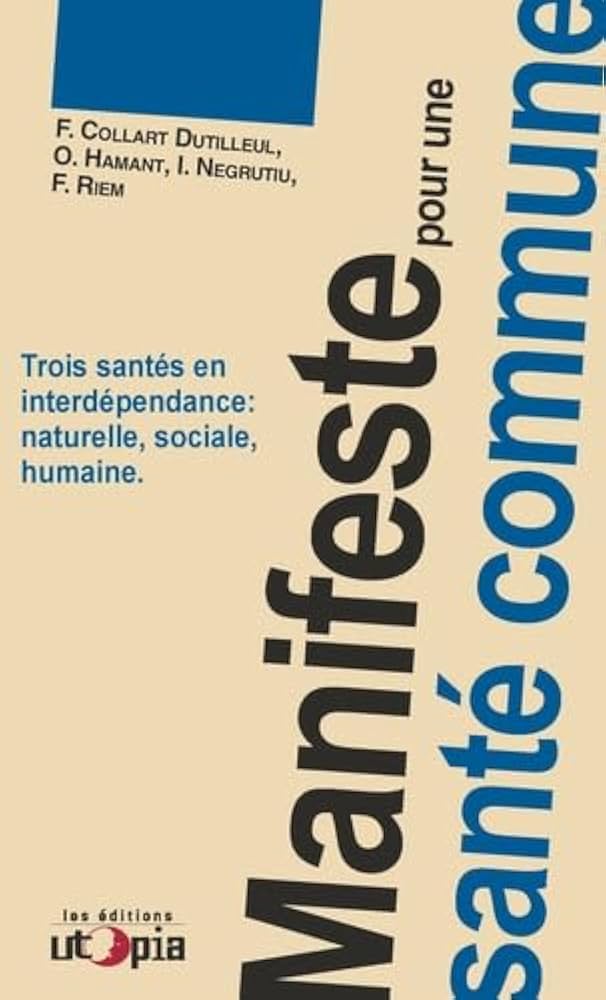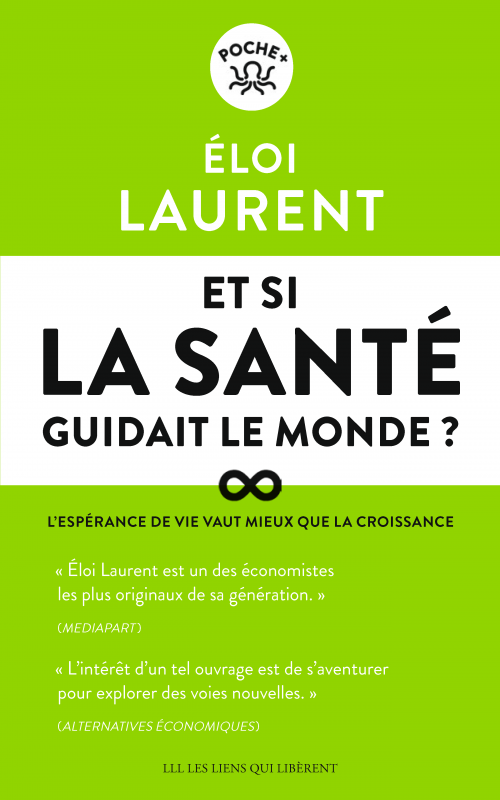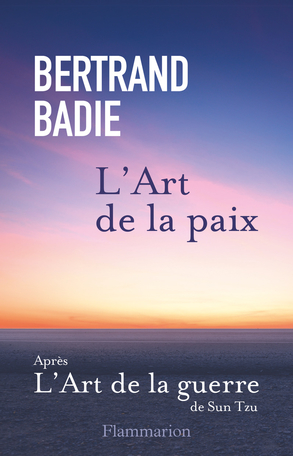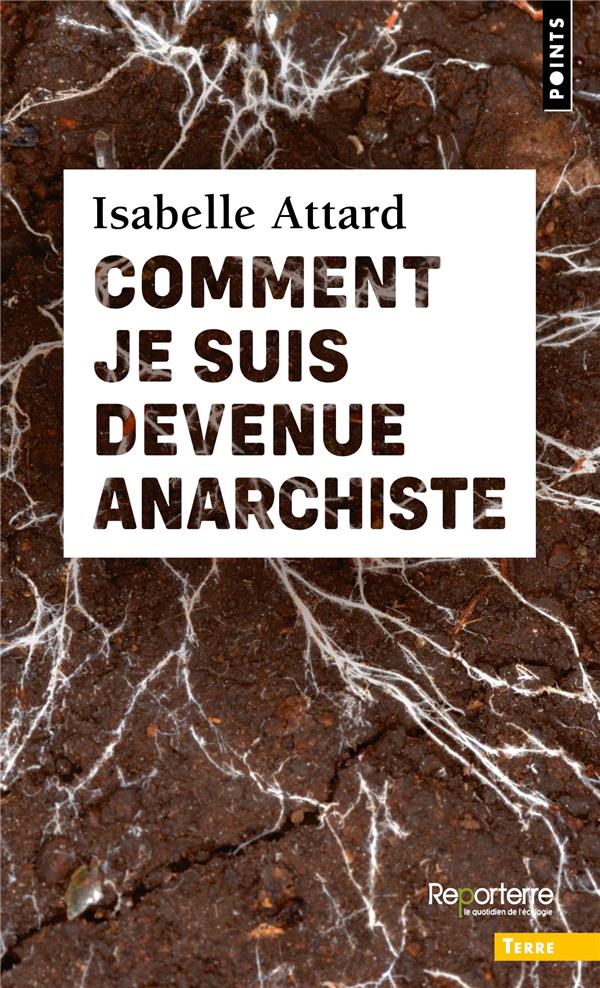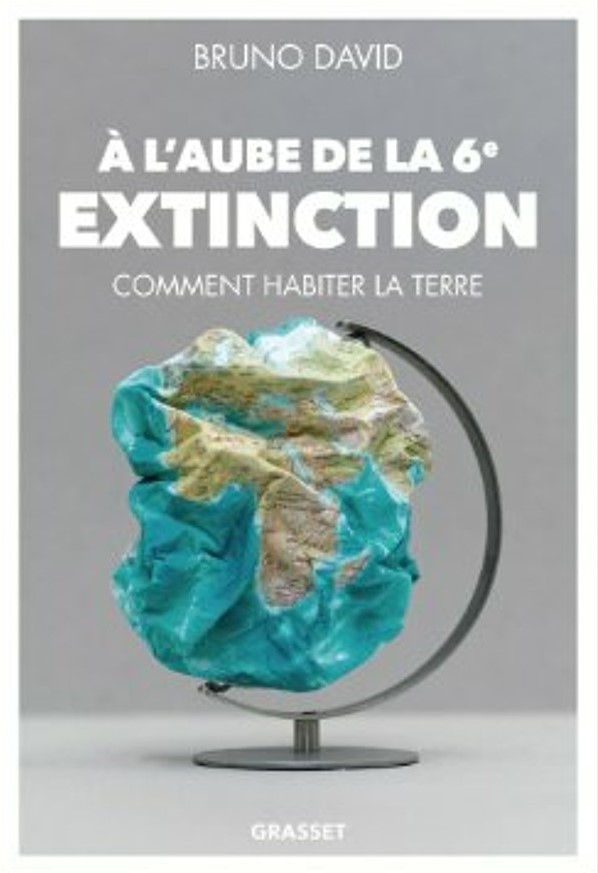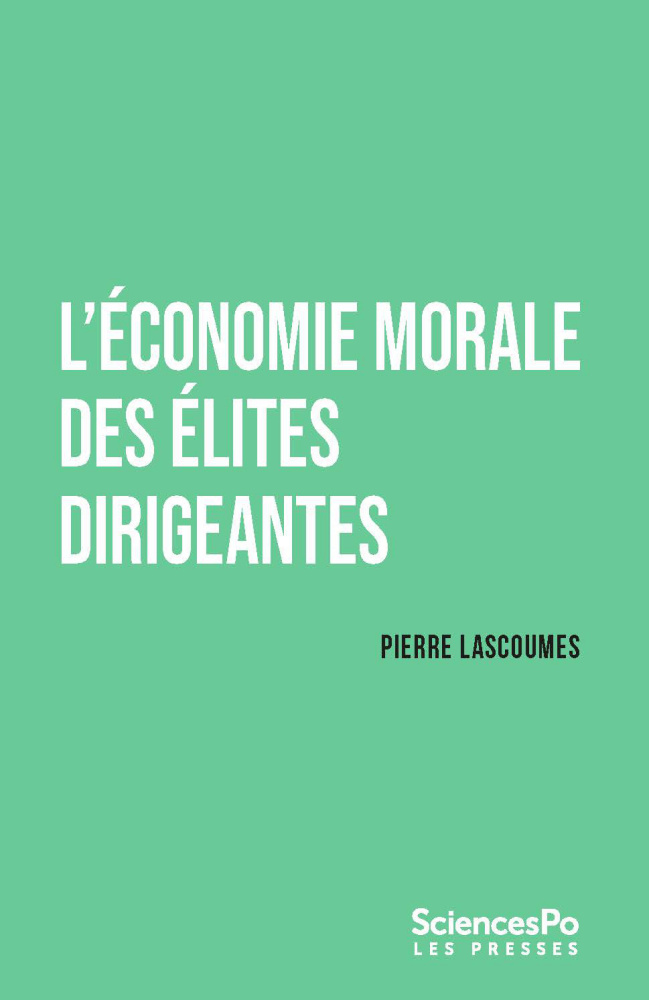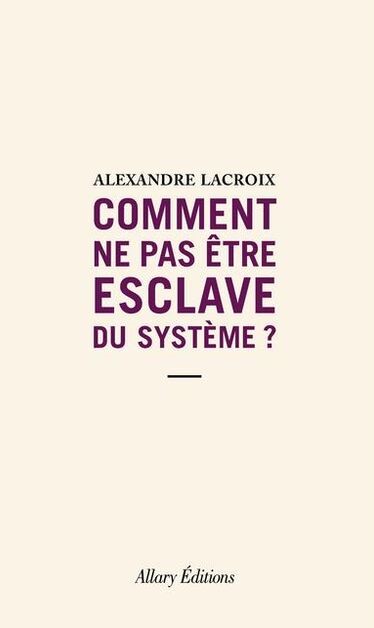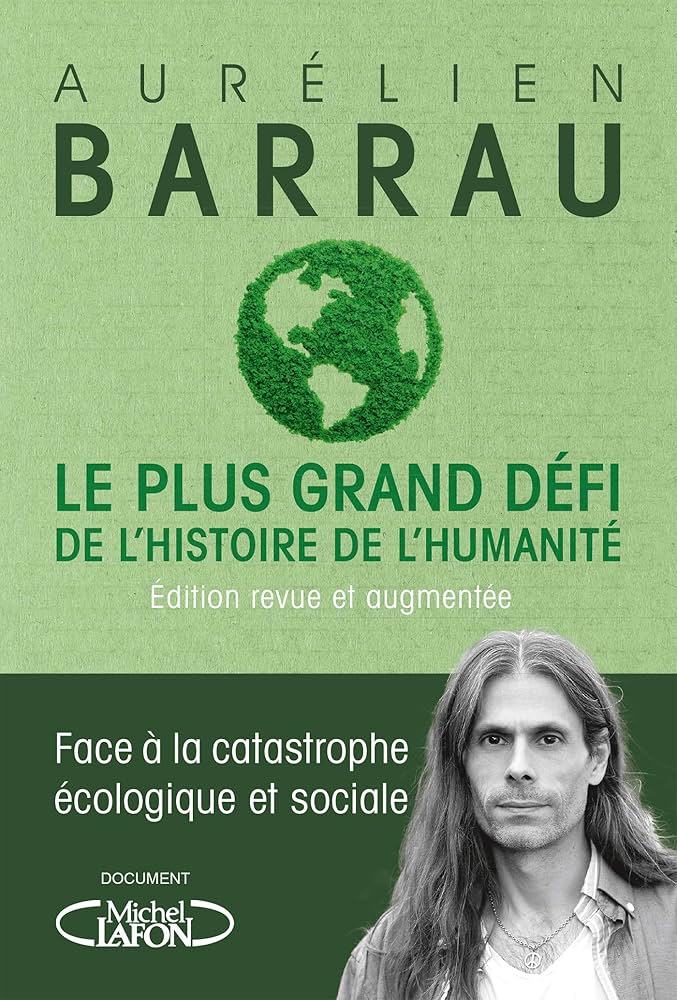De l’âge de pierre au 21ième siècle
Walter Scheidel, Editions Actes Sud 2021
Walter Scheidel est un historien, professeur à Stanford. Son histoire des inégalités, c’est un panorama mondial et à travers le temps de l’évolution des inégalités économiques au sein des sociétés. Son propos peut être résumé en deux grandes idées. Au fur et à mesure du développement des sociétés, la tendance a toujours été une concentration des richesses dans un petit nombre de mains et un accroissement des inégalités. Historiquement les réductions d’inégalités, quand il y en a eu, se sont pour l’instant toujours faites au prix de turbulences très violentes : guerres, effondrement des états, révolutions, pandémies.
En bon scientifique, l’auteur précise dès le début de l’ouvrage le cadre de son travail : il exclut de son analyse les inégalités autres qu’économiques (genre, sexe, âge, race…) et ne s’intéresse pas aux inégalités entre nations. En terme de méthode, il s’appuie beaucoup sur le coefficient de Gini et la répartition des revenus et des patrimoines. Pour les derniers siècles, ce type de données est déjà bien connu (voir le livre de Thomas Piketty, le Capital au 21ième siècle). Un des grands intérêt de l’ouvrage de Walter Scheidel est de rassembler des données pour des périodes beaucoup plus anciennes : on voit ainsi par exemple l’évolution des salaires réels dans les campagnes anglaises entre 1200 et 1869 (mesurés en équivalent grain) ou l’évolution des grandes fortunes dans la Rome Impériale (en million de sesterces). « L’archéologie nous a même permis de repousser les frontières des inégalités matérielles jusqu’à l’époque de la dernière période glaciaire, au Paléolithique ».
L’ouvrage commence par une analyse de l’évolution des inégalités sur le temps long : « les inégalités de pouvoir et les hiérarchies existaient déjà chez les singes d’Afrique, voilà plusieurs millions d’années ; elles ont progressivement diminué avec les représentants du genre Homo, au cours des 2 derniers millions d’année d’évolution ; la domestication des plantes et des animaux, apparu au début de holocène, a conduit à une hausse des inégalités de pouvoir et de richesses, qui a atteint son plus haut niveau avec la naissance des grands Etats prédateurs ».
Cette évolution des inégalités, toujours croissante en tendance depuis que l’humain a inventé l’agriculture et s’est sédentarisé, connait toutefois des hauts et des bas. Dans la suite de l’ouvrage, l’auteur analyse les facteurs qui ont conduit à « ces bas », ces réductions des inégalités. Il identifie ce qu’il appelle les Quatre Cavaliers du nivellement par la violence (par analogie avec les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse) : ce sont la guerre, la révolution, l’effondrement de l’Etat et la pandémie.
Le plus gros de l’ouvrage est consacré à l’analyse de ce qui s’est passé quand sont apparus un ou plusieurs de ces Quatre Cavaliers. « Les guerres de moindre ampleur n’ont pas cessé de rythmer l’histoire, mais elles n’ont pas produit de résultats homogènes » en matière de réduction des inégalités. Par contre les deux guerres mondiales ont correspondu à une « grande compression » : une réduction très forte des inégalités et des programmes de redistribution qui ont maintenu les inégalités à un niveau beaucoup plus faible qu’à la fin du 19ième siècle jusqu’au tournant néolibéral des années 1980.
« Les seules guerres civiles qui ont véritablement transformé la répartition des revenus et des patrimoines ont été celles qui ont mis au pouvoir des régimes radicaux dont l’objectif était d’exproprier et de redistribuer les plus complètement possible, et qui n’ont reculé devant aucun carnage pour y parvenir ». C’est le deuxième cavalier du nivellement par la violence, la révolution. On y découvre que si les révolutions communistes (Lénine, Mao…) ont réussi un nivellement (par le bas) des inégalités, cela a été moins le cas de la révolution française. Et l’histoire nous montre que, même dans les pays ayant subi de fortes révolutions, les inégalités ont recommencé à croitre comme en Russie ou en Chine.
« La faillite de l’Etat et l’effondrement des systèmes sont parfois allés très loin dans le renversement des hiérarchies et la compression des inégalités ». L’auteur nous raconte ainsi la chute de l’empire Tang au 9ième siècle de notre ère, ou la chute de l’empire romain entre le 5ième et 6ième siècle de notre ère. « La plupart de ces catastrophes ont eu lieu avant l’ère moderne » et se sont déroulés avec de fortes violences.
Reste le quatrième cavalier que sont les pandémies. Tuant des proportions significatives des populations (on parle du tiers de la population européenne pour la peste noire du 14ième siècle), ces pandémies créent une pénurie de main d’œuvre, qui conduit à un rapport de force favorable aux plus pauvres. On peut ainsi constater une amélioration très sensible des salaires de la main d’œuvre après le passage de pandémies, que ce soit la peste noire au 14ième siècle en Europe, les maladies apportées par les conquistadors en Amérique du Sud, ou la peste de Justinien en Egypte du 6ième siècle.
Existe-t-il d’autres solutions que les Quatre Cavaliers pour réduire les inégalités ? « Pour le savoir, nous allons passer en revue le large éventail d’alternatives possibles, en nous arrêtant en particulier sur la réforme agraire, les crises économiques, la démocratisation et le développement économique ». L’auteur se penche en particulier sur le modèle économique de la courbe en cloche de Kuznets qui prévoit qu’avec la croissance, les inégalités augmentent dans un premier temps, se stabilisent, pour, à terme, décroitre. L’auteur consacre une dizaine de pages pour présenter des données qui lui permettent de constater que « les preuves venant à l’appui d’une relation systématique entre croissance économique et inégalités – telle qu’envisagé par Kuznets il y a soixante ans – manquent cruellement ».
Après avoir analysé les alternatives possibles, Walter Scheidel conclut « même après avoir envisagé les autres causes de compression des inégalités, il nous faut convenir qu’à l’évidence la violence, réelle ou latente, a longtemps été l’incontournable catalyseur des politiques égalisatrices ».
L’ouvrage se termine par une réflexion sur ce que l’avenir nous réserve. « De nos jours, les mécanismes de nivellement les plus efficaces ne sont plus en mesure de fonctionner – les Quatre cavaliers ont quitté leur monture – et aucune personne sensée ne voudrait les voir se remettre en selle. » Sans ces mécanismes, il semblerait qu’il soit très difficile de contrer la tendance naturelle à l’augmentation des inégalités.Se gardant toutefois de toute prévision précise, l’auteur nous rappelle simplement les leçons de l’Histoire « si nous souhaitons rééquilibrer la répartition actuelle des revenus et des patrimoines en faveur d’une plus grande égalité, nous ne pouvons pas simplement fermer les yeux sur ce qu’il en a couté jadis ».
Un ouvrage passionnant par l’originalité de l’approche et par la rigueur scientifique, le tout rendu digeste par un sens pédagogique affirmé.