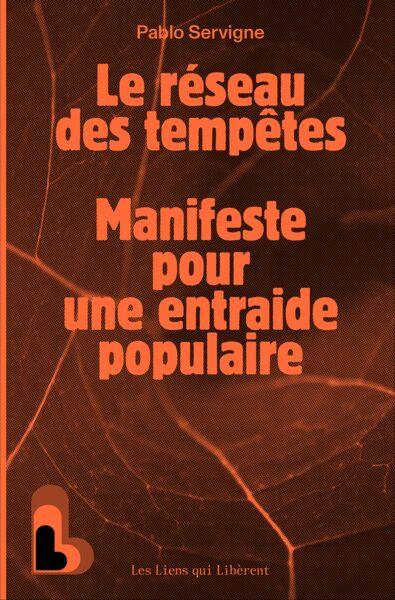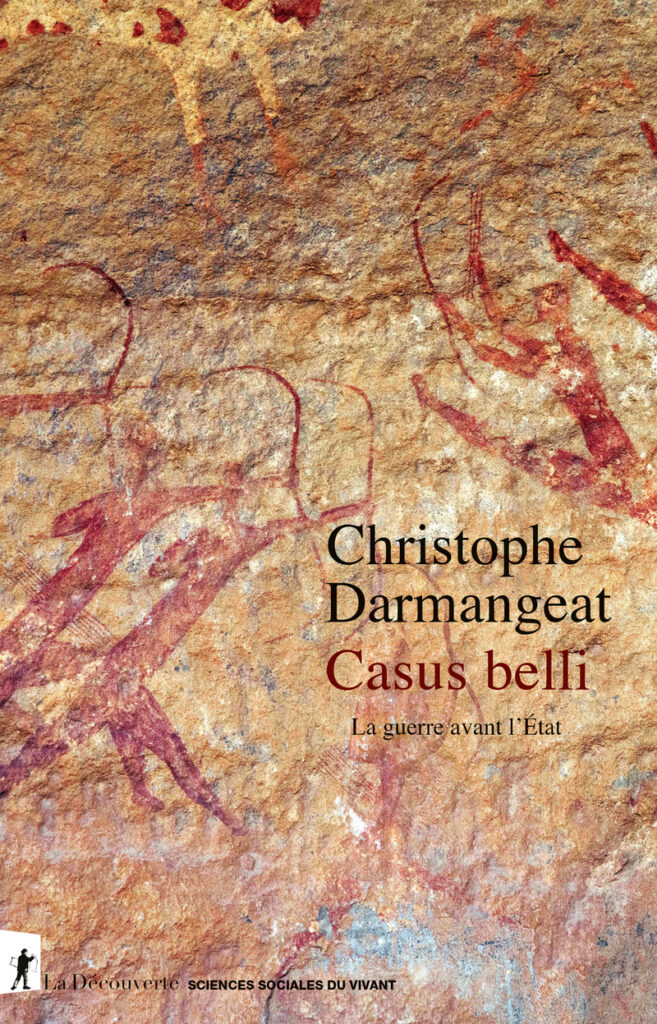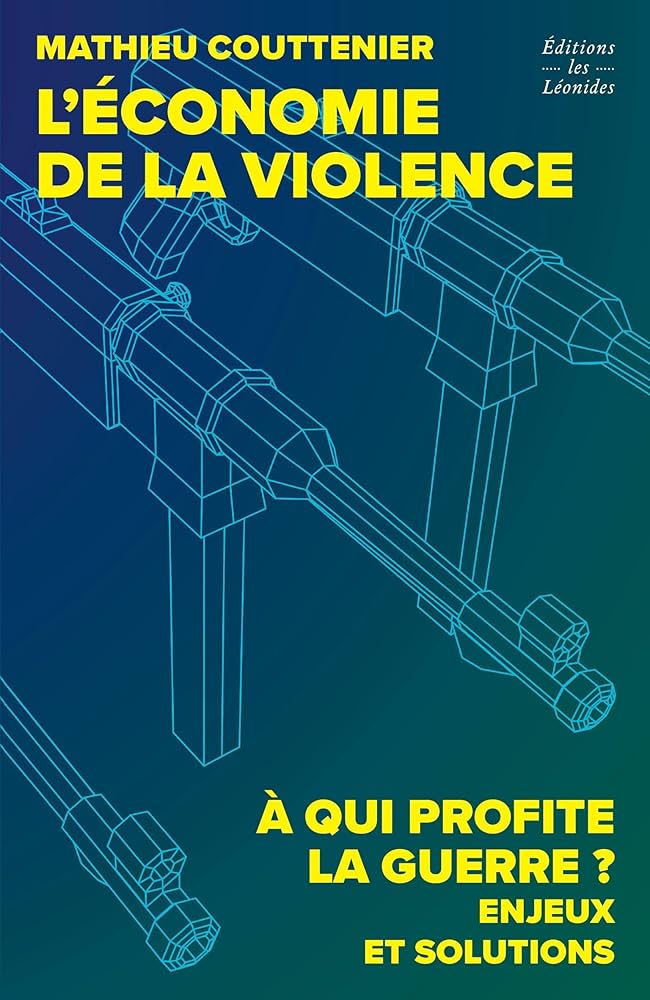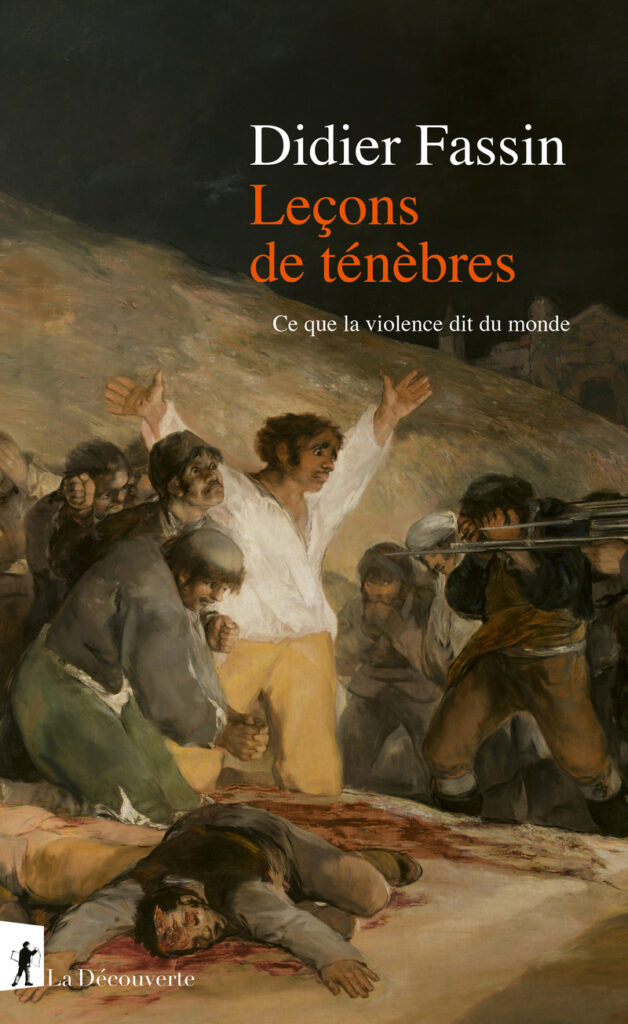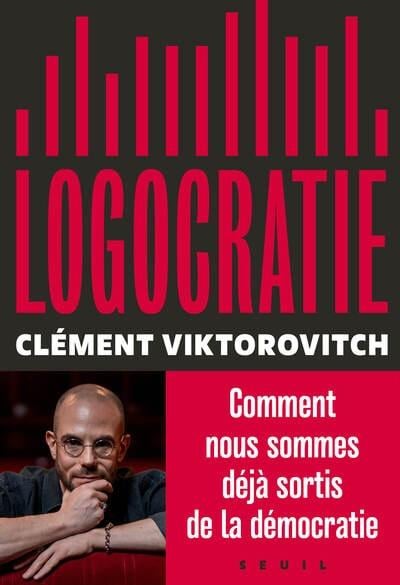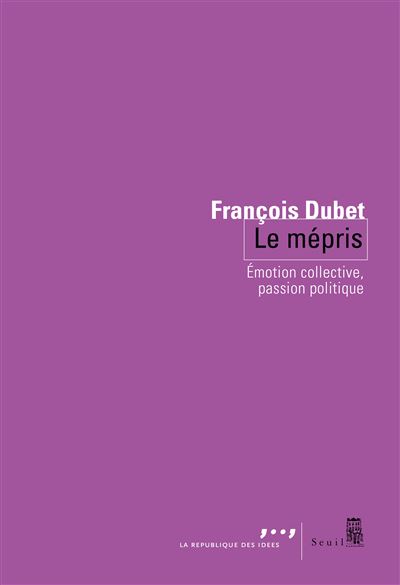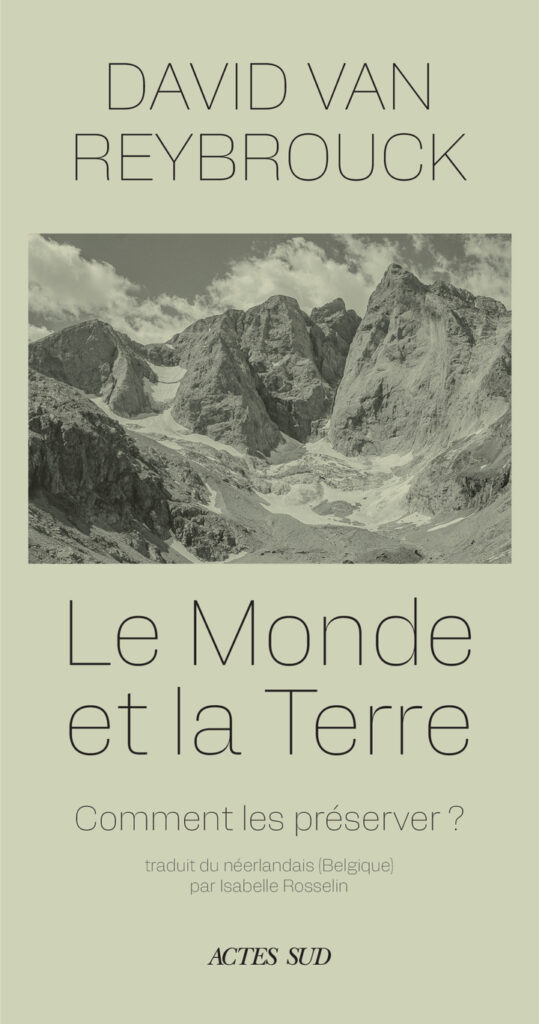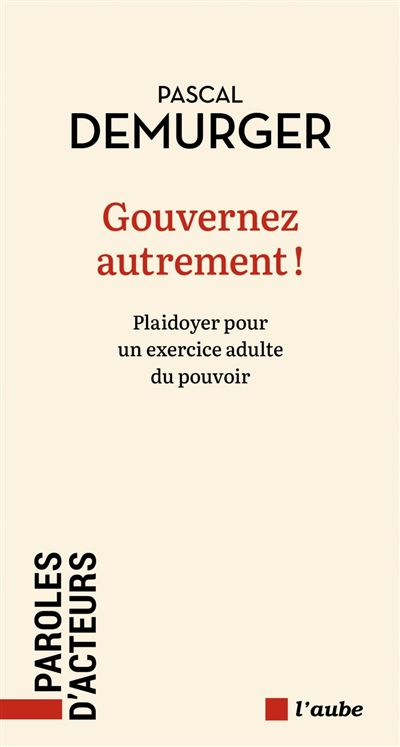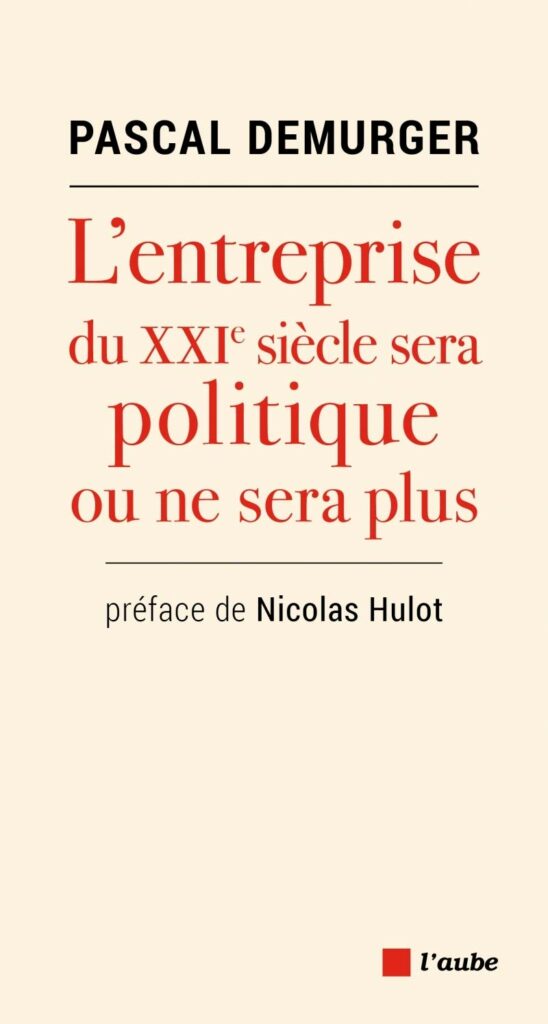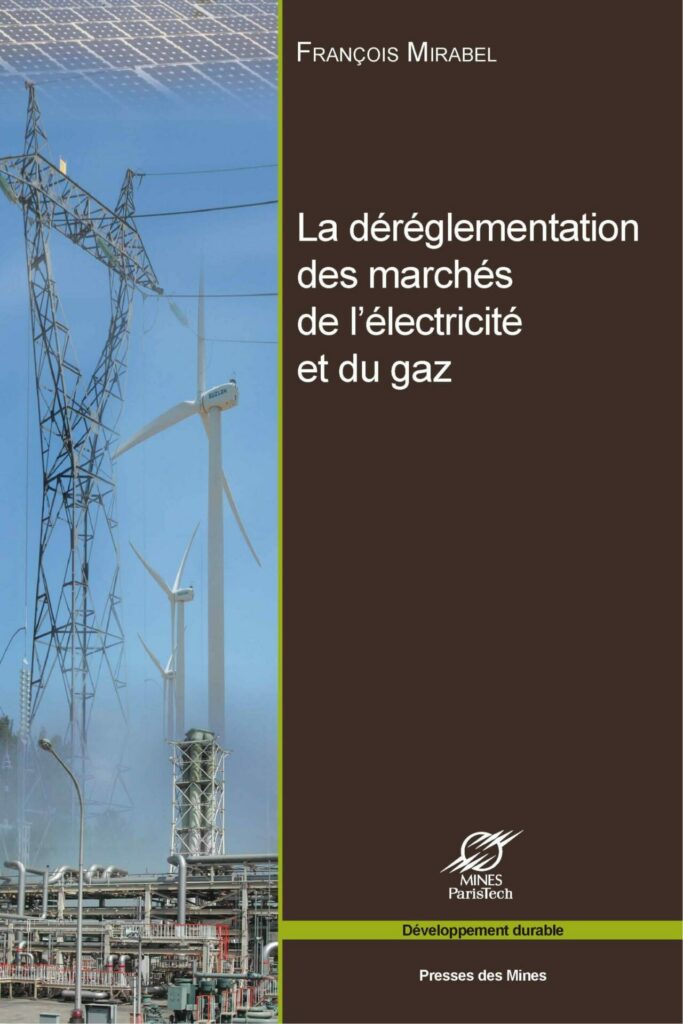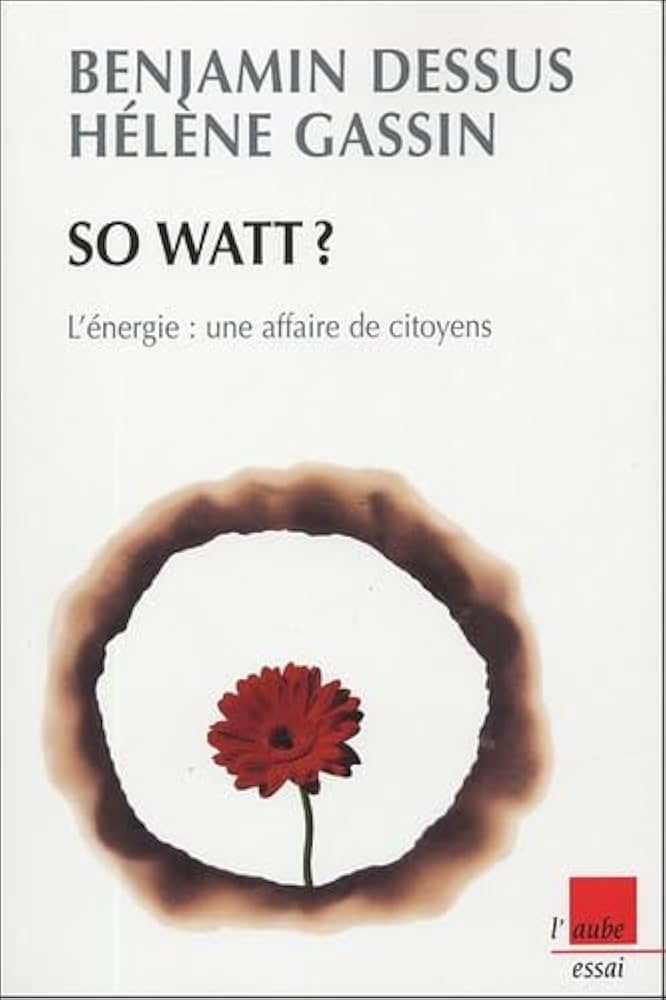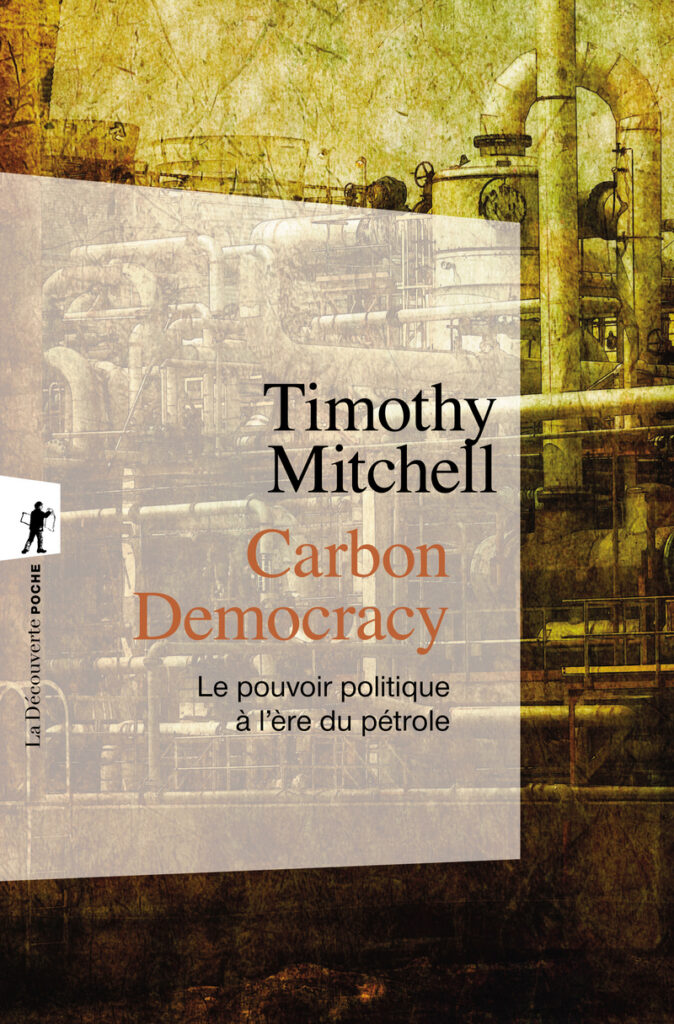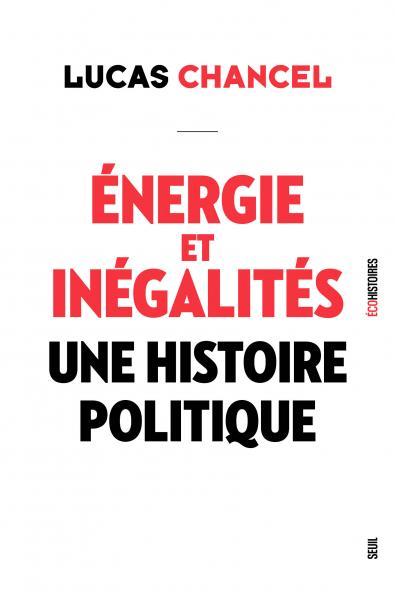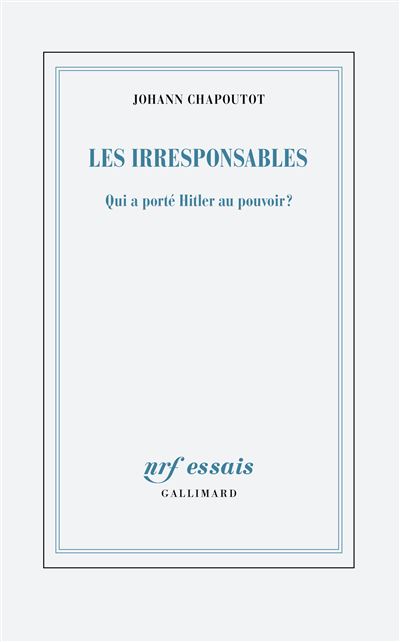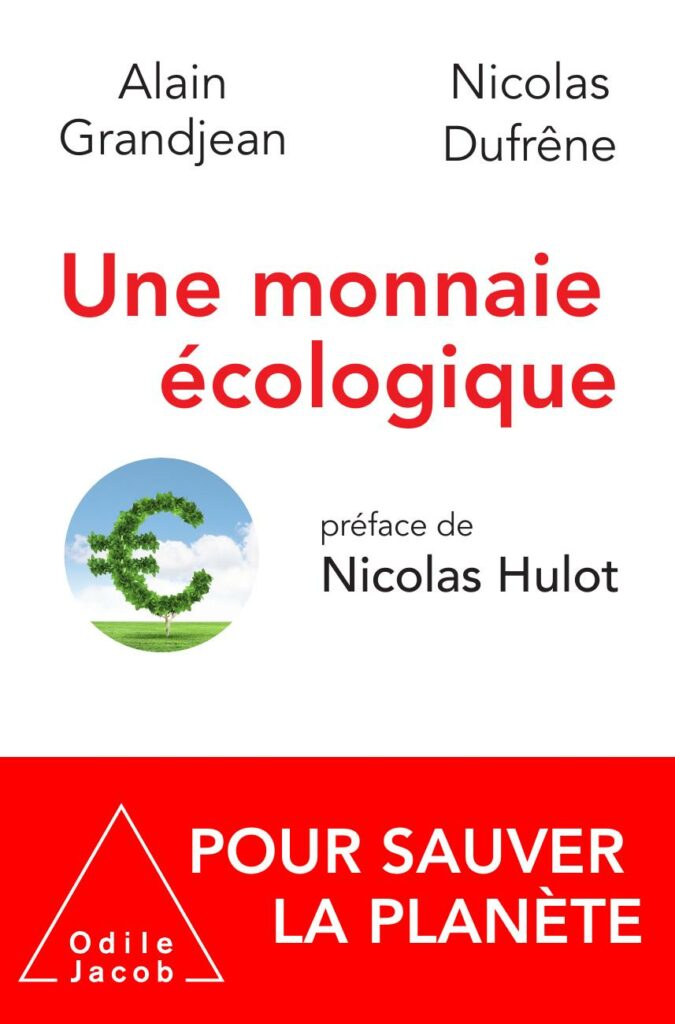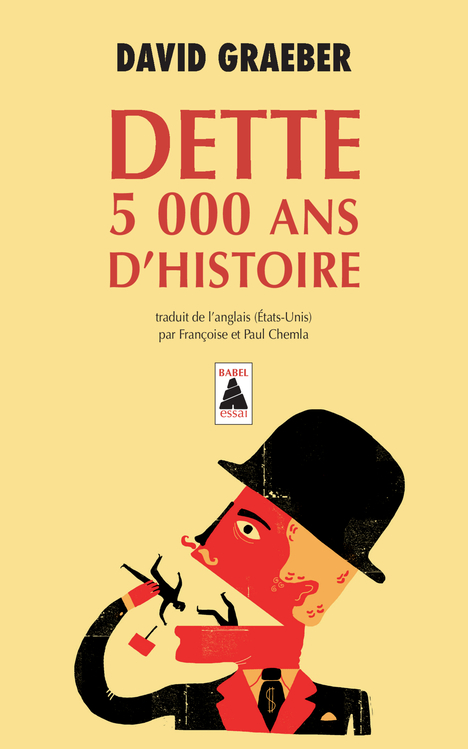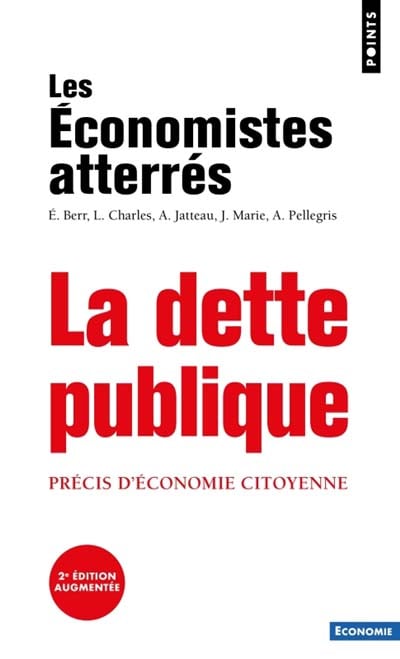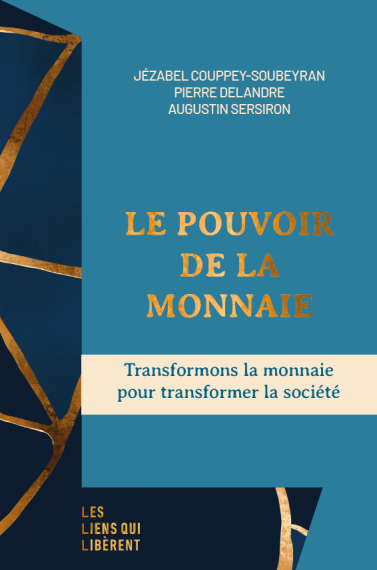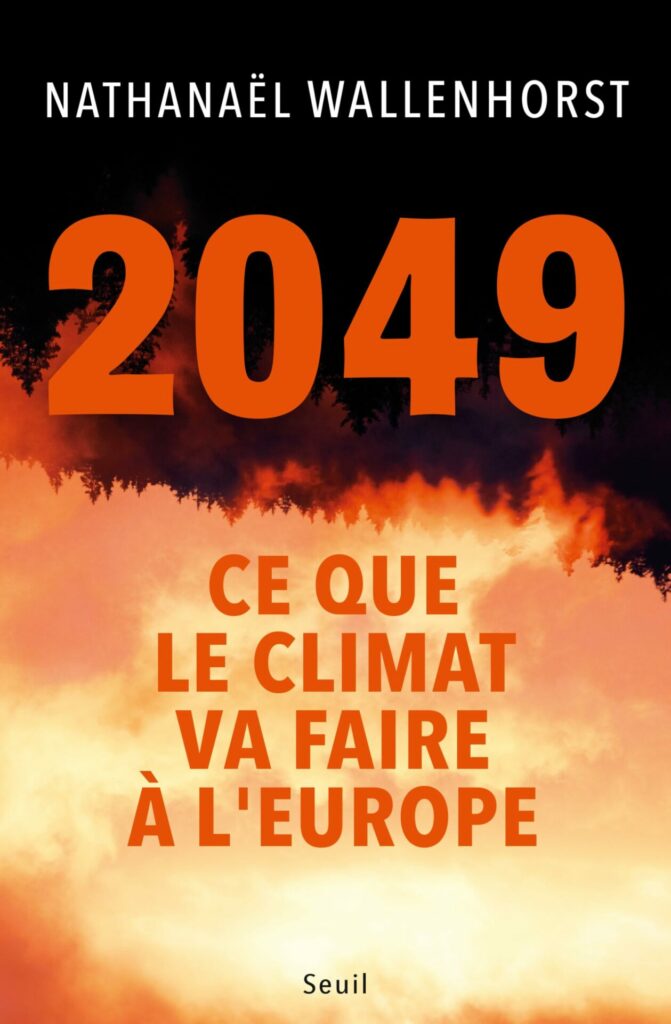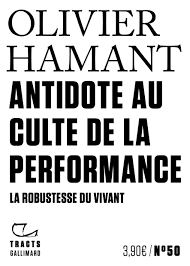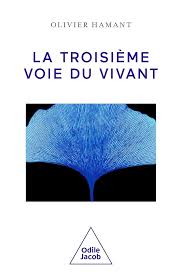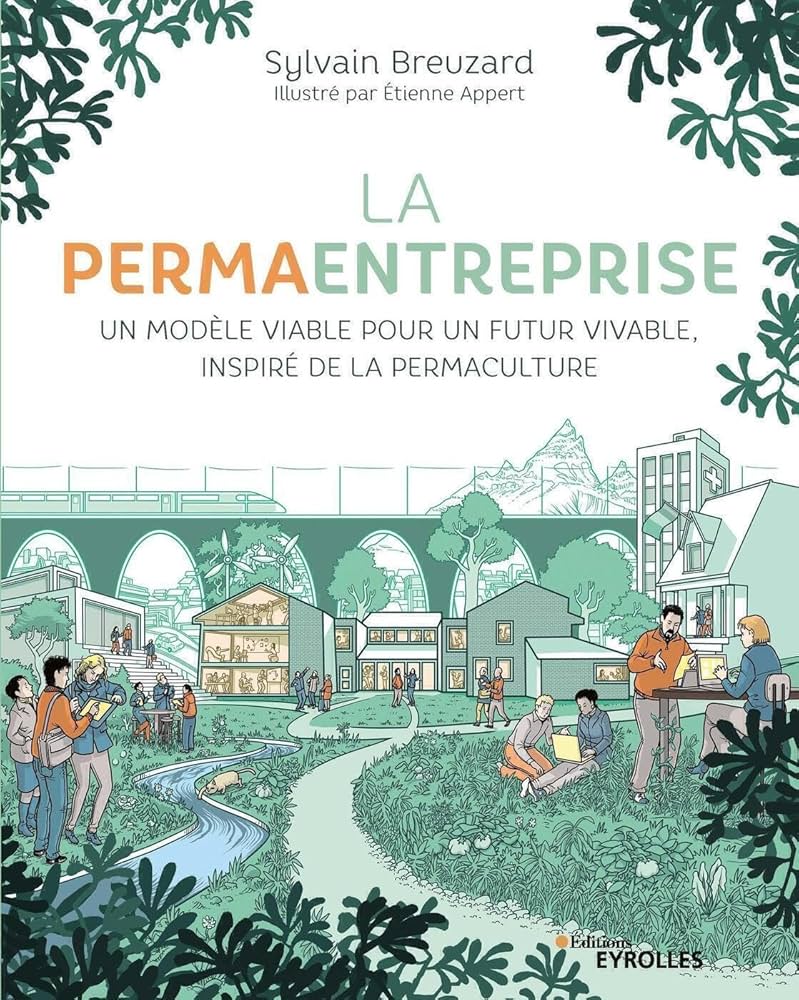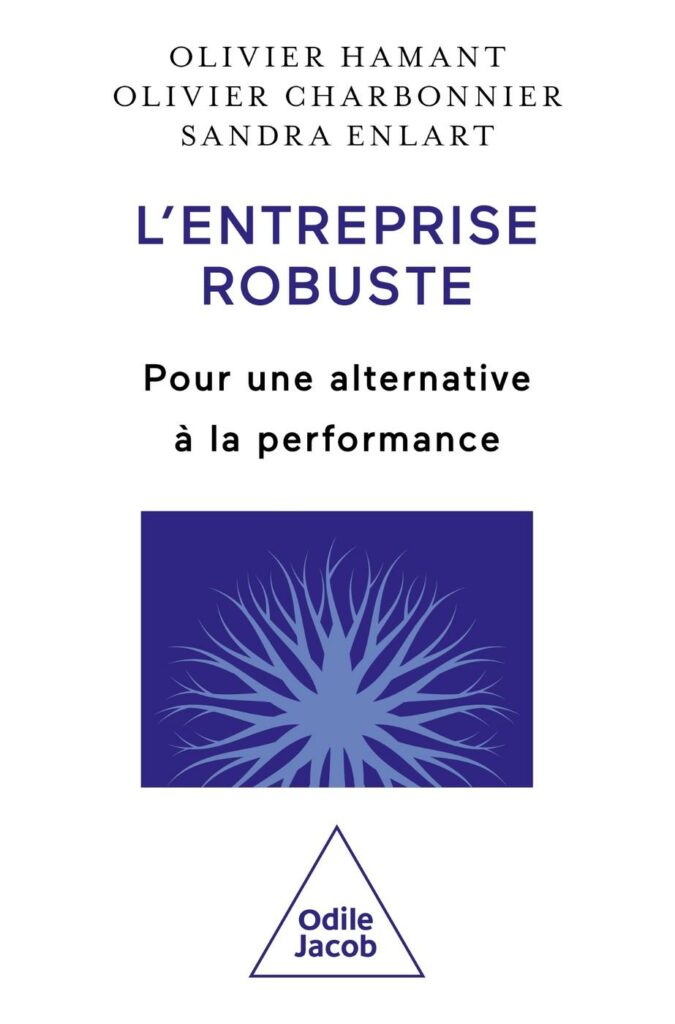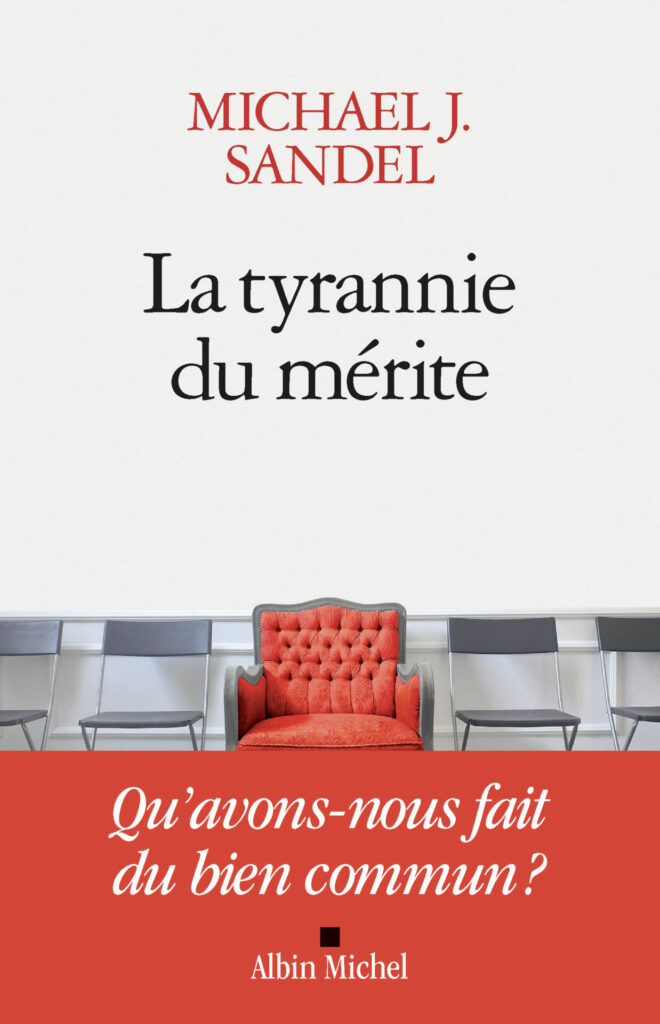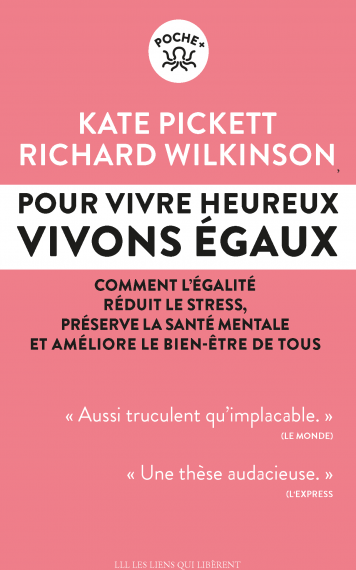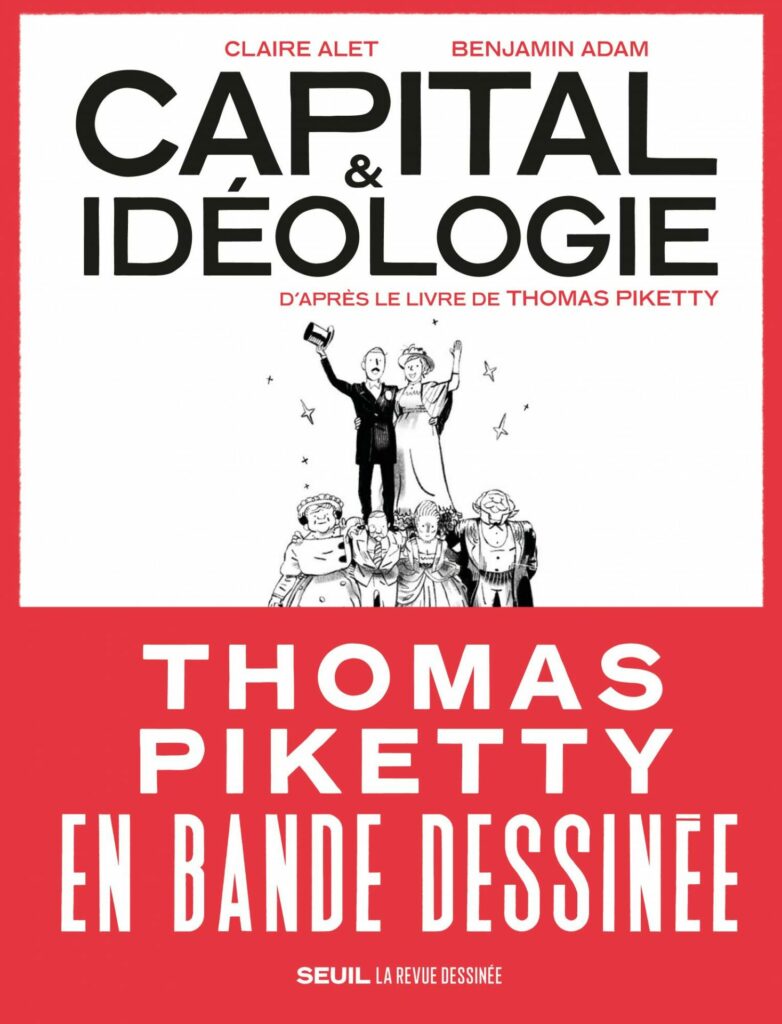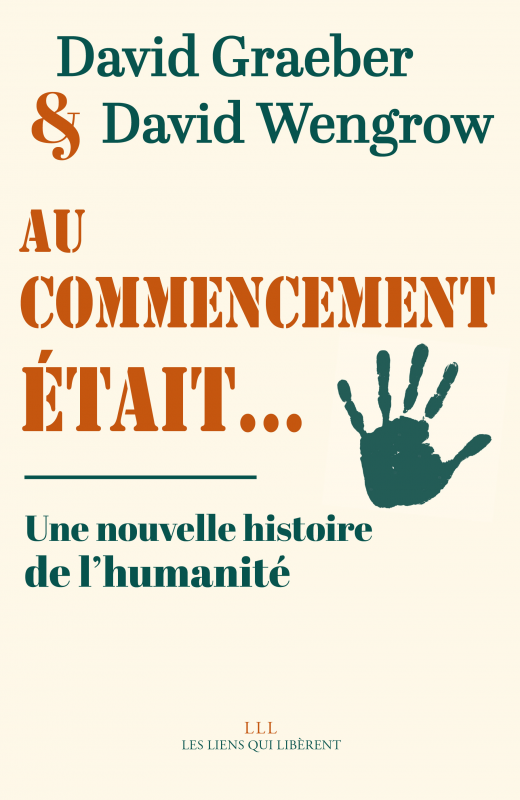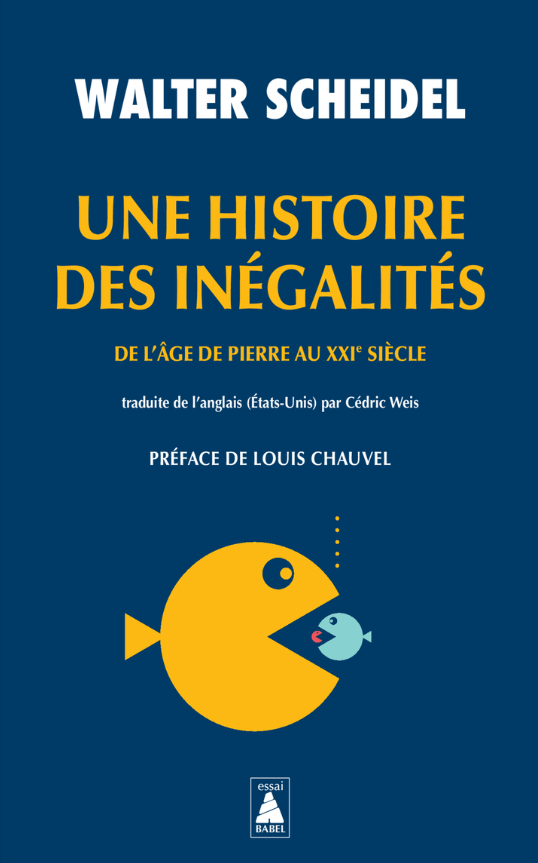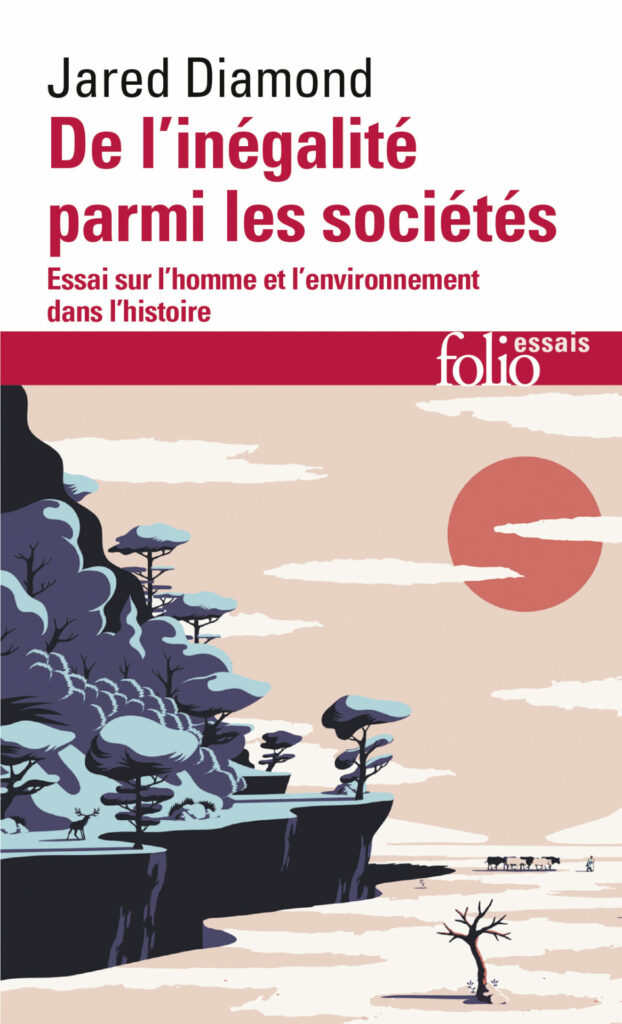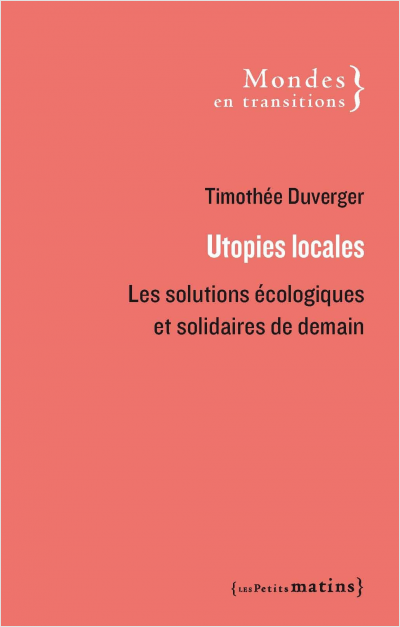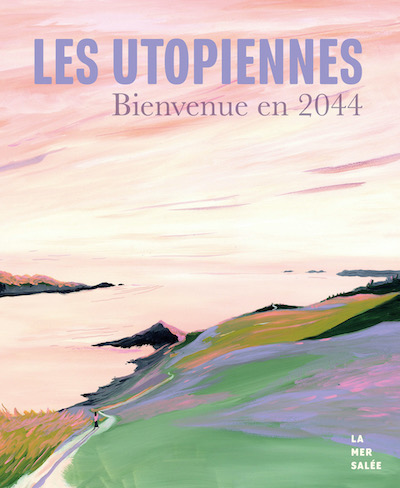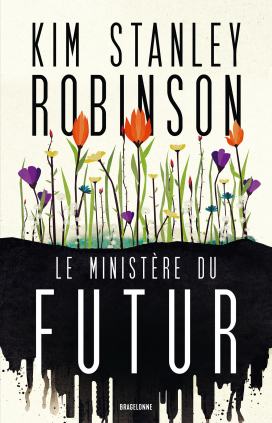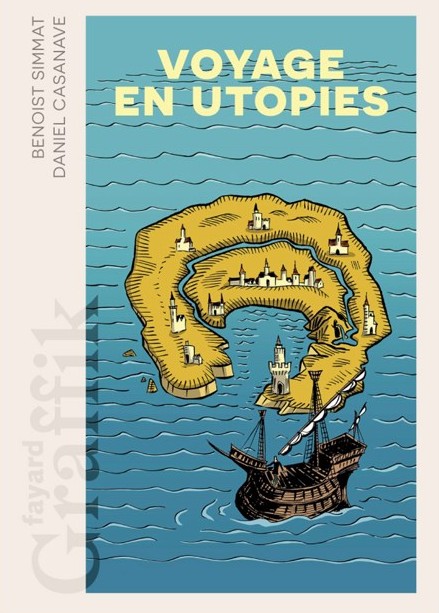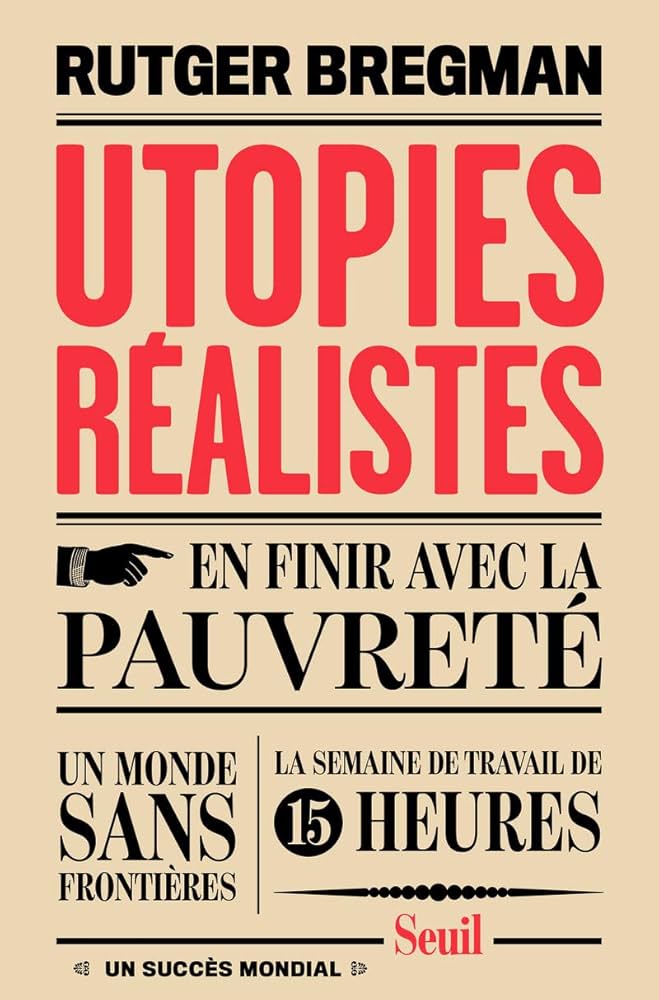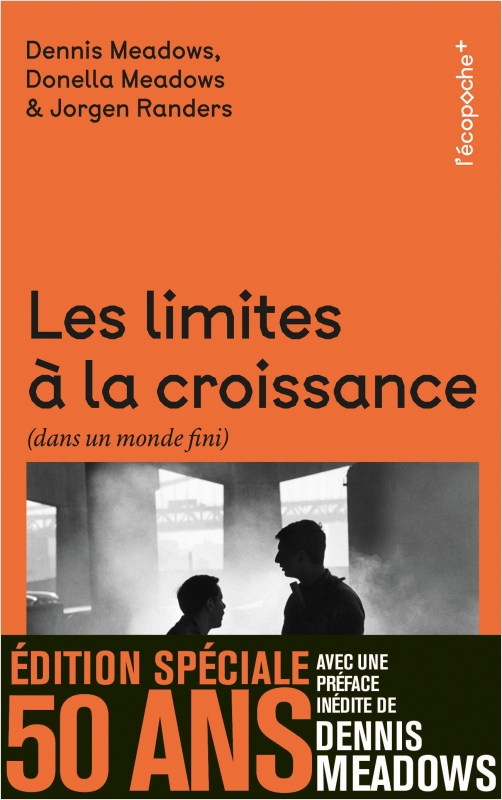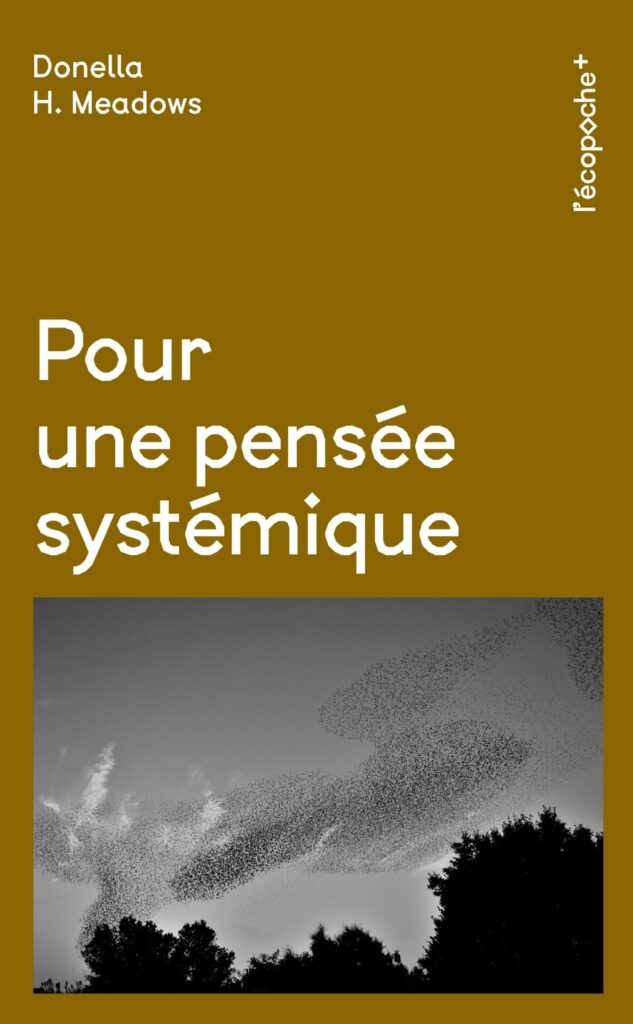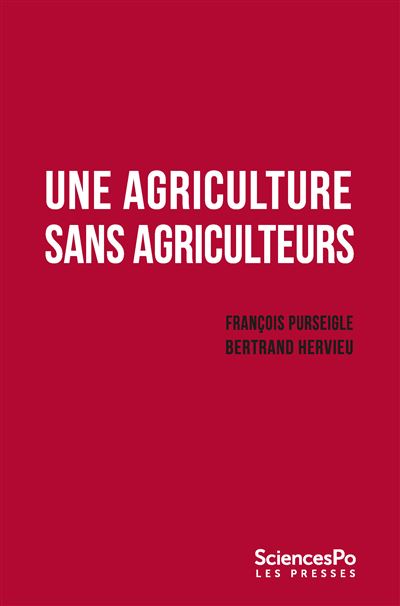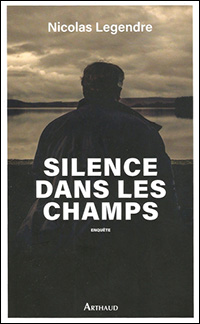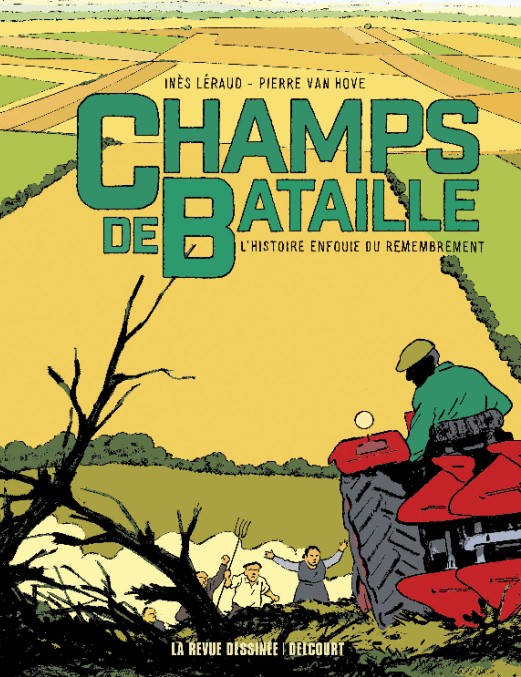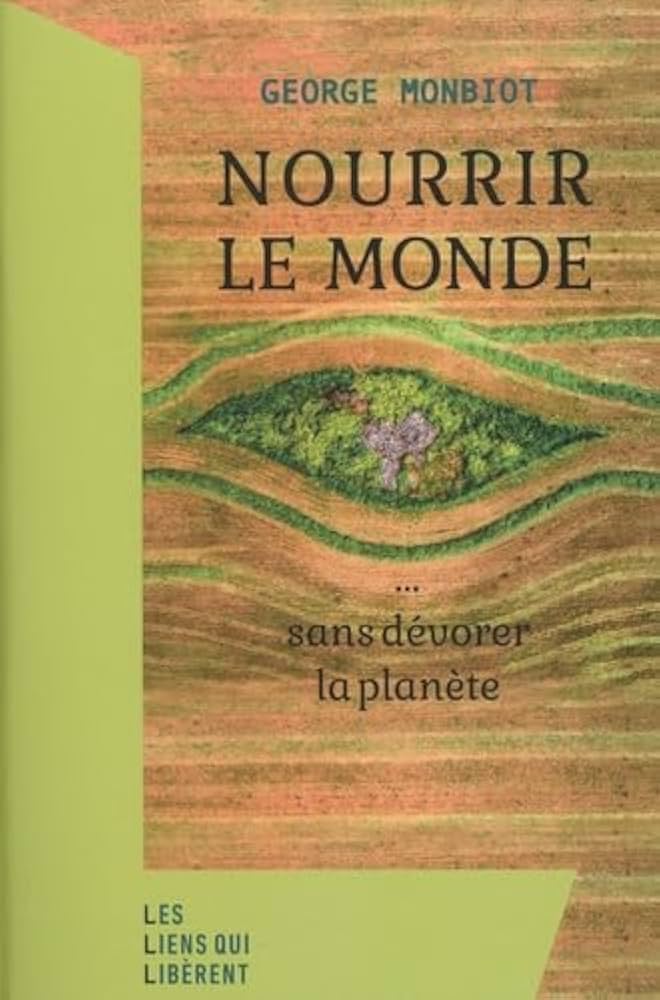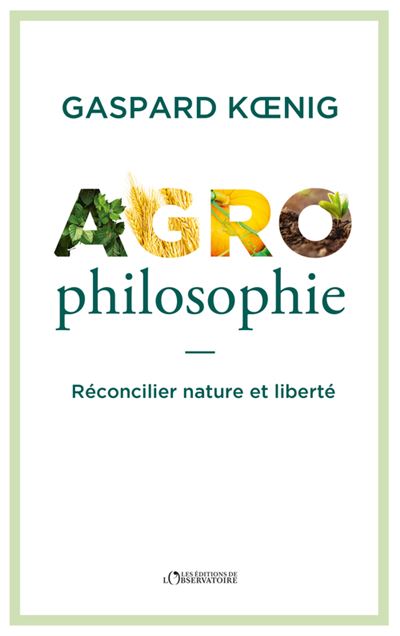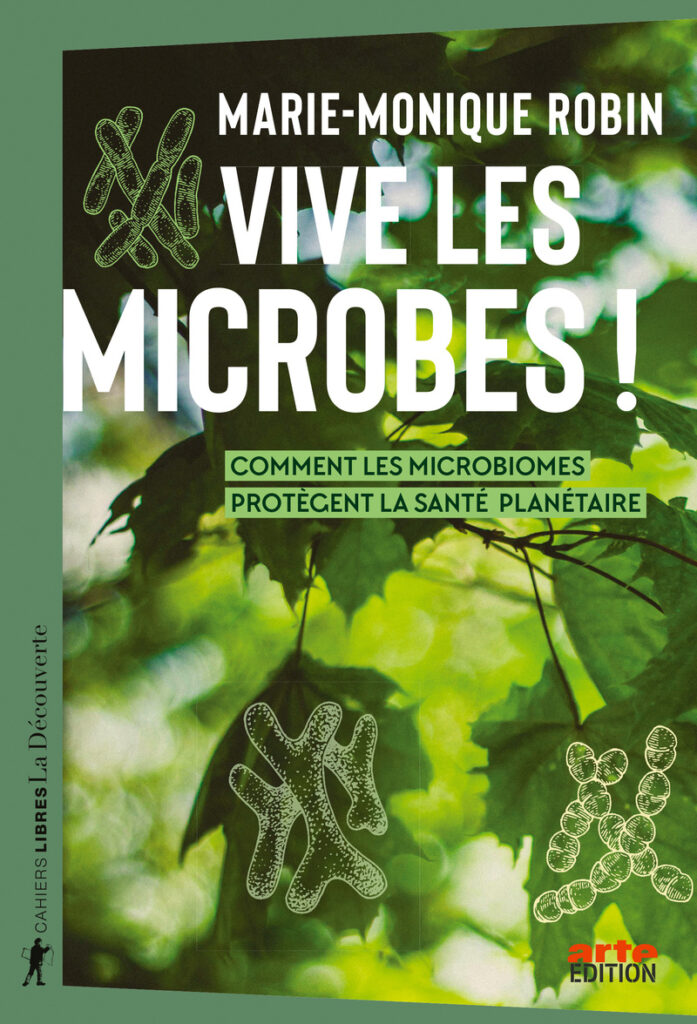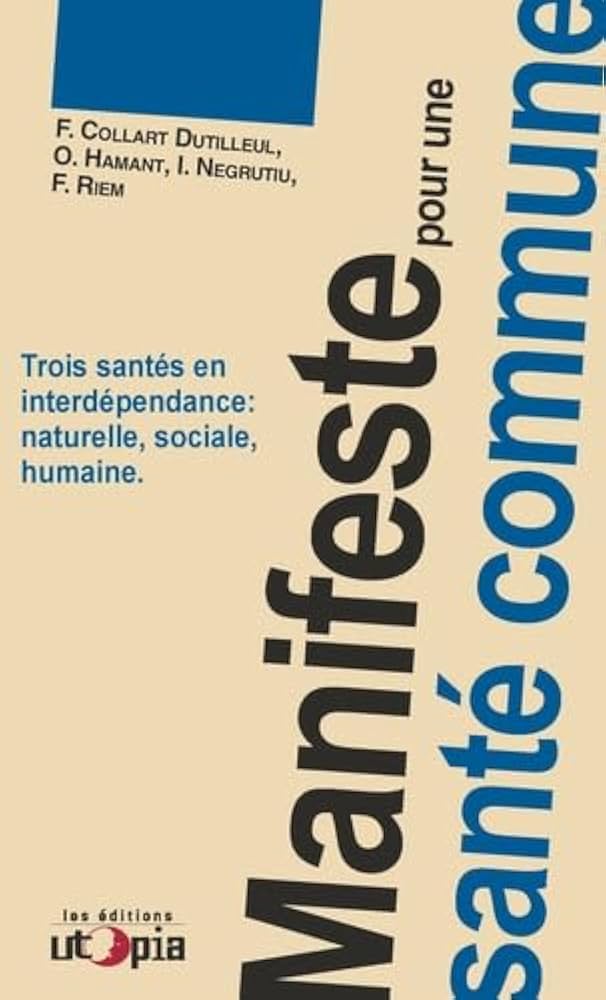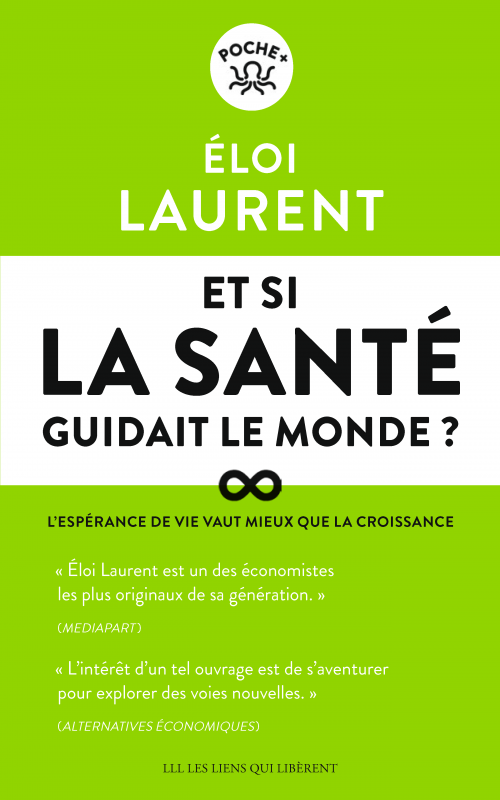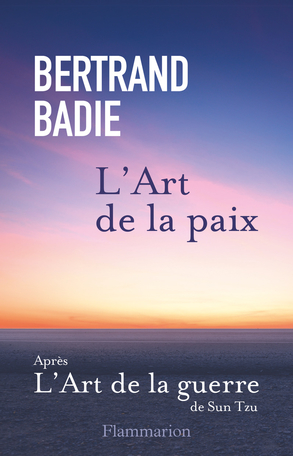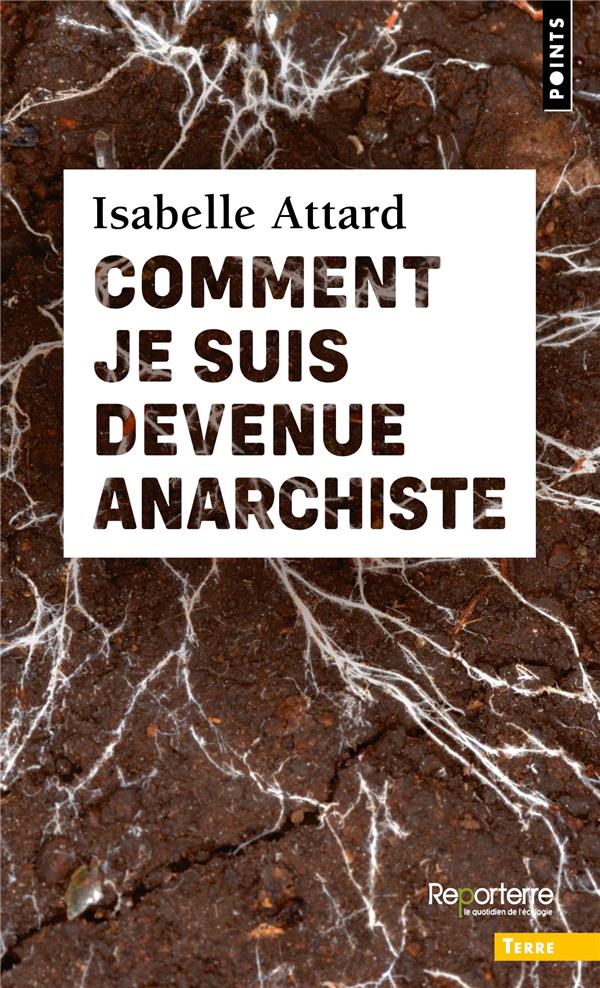Comment l’égalité réduit le stress, préserve la santé mentale et améliore le bien-être de tous
Kate Pickett, Richard Wilkinson, Éditions Les Liens qui Libèrent, 2019
En 2009, Kate Pickett et Richard Wilkinson, tous deux professeurs d’épidémiologie sociale, ont publié « Pourquoi l’égalité est meilleure pour tous ? ». Un livre qui soutenait une thèse simple : « les habitants de sociétés marquées par de profonds écarts de revenus entre riches et pauvres ont beaucoup plus de risques que ceux des sociétés plus égalitaires de souffrir d’un large éventail de problèmes sanitaires et sociaux ». Dans ce nouvel ouvrage, publié 10 ans plus tard, ils explorent les effets psychologiques et le stress générés par les inégalités : « Nous allons nous demander comment l’inégalité s’immisce dans nos esprits et intensifie notre anxiété, comment nous y réagissons, quelles sont les conséquences sur la prévalence des maladies mentales et des troubles émotionnels – en somme comment on le fait de vivre dans une société inégalitaire modifie notre façon de penser, nos émotions et nos modes de communication avec les autres ».
Le titre du premier chapitre « Ceci n’est pas un livre de développement personnel » pose d’entrée le sujet : il ne s’agit pas de comprendre comment soigner les phobies sociales, le stress et les maladies mentales, mais d’analyser « les puissants facteurs externes capables d’accroître ou d’atténuer leur gravité selon les personnes ». Les hiérarchies de statuts, la perte des communautés bien établies, la mobilité sociale, les inégalités de revenus font partie de ces facteurs externes qui affectent la très grande majorité de la population (et non pas seulement les plus pauvres). « Un élément crucial permettant d’identifier à la fois la racine du problème et sa solution nous est livrée par les travaux scientifiques : dans les sociétés où règne de très grands écarts de revenus entre riches et pauvres, la vie locale est indigente. À l’inverse, les sociétés avec de faibles écarts sont beaucoup plus soudées.
L’ouvrage s’articule ensuite en trois parties. Une première partie, « l’égalité dans nos têtes » traite principalement des symptômes : anxiété du statut social, folie des grandeurs, fausses solutions de compensation.
Le chapitre 2 est consacré à l’anxiété du statut social. « Chacun, indépendamment de sa richesse objective, est plus inquiet du regard et du jugement porté sur lui… dans les pays où il règne de grands écarts de revenus ».
Le chapitre 3 décrypte la réaction à l’anxiété du statut et à la crainte du regard des autres, qui consiste à projeter une image exagérément positive de soi. Les données présentées montrent clairement que la tendance au narcissisme et à l’auto glorification augmentent avec le niveau d’inégalité dans le pays.
« L’anxiété sociale implique un besoin croissant de béquilles pour se mettre à l’aise, se donner de l’assurance, atténuer ses complexes et ses inhibitions ». Ces béquilles, ce sont l’alcool, les drogues, l’addiction au jeu mais aussi l’hyper consommation, tous phénomènes plus marqués dans les pays les plus inégalitaires (chapitre 4).
La deuxième partie explore les origines évolutives de l’anxiété sociale et démonte les mythes de la méritocratie et des classes sociales.
« Notre vulnérabilité à l’anxiété sociale semble donc puiser à 2 sources qui ont creusé leurs sillons dans notre cerveau. La première est le legs des hiérarchies de dominance pré humaines. La seconde nous vient de notre passé égalitaire préhistorique » En effet, si les sociétés des singes qui ont précédé les humains sont fortement hiérarchiques, « Pendant environ 95% de la période qui s’est écoulée depuis que notre cerveau a atteint sa taille actuelle – soit les 200 000 à 250 000 dernières années de notre existence-, les sociétés humaines ont été résolument égalitaires ». Dans la mesure où il correspond à un plus grand bien être, il serait très souhaitable de nous appuyer sur notre histoire égalitaire plutôt que de développer les hiérarchies de dominance et les inégalités qui vont avec.
Le chapitre 6 déconstruit l’idée que les prédispositions génétiques en termes d’intelligence et d’aptitude serait fondamentalement différente d’une personne à l’autre. « Les principales différences d’aptitude résultent de la position d’un individu dans la hiérarchie sociale bien plus qu’elles n’en sont la cause ».
Dans le chapitre 7, les auteurs analysent les comportements de classe. Fortement développées au 19e siècle, elles ont eu tendance à se réduire au début du 20e siècle en même temps que les inégalités se réduisaient. « Les écarts de revenus ont recommencé à se creuser dans de nombreux pays à compter de 1980 environ. Parallèlement le poids de la classe et du statut social est reparti à la hausse ».
Dans la dernière partie de l’ouvrage, les auteurs formulent « des propositions politiques concrètes pour favoriser l’égalité », propositions qui soient compatibles avec la soutenabilité environnementale. Cette dernière partie est beaucoup moins convaincante que le reste de l’ouvrage. En effet comme le constatent les auteurs, « ce sont des processus idéologiques et politiques qui … ont joué le rôle le plus déterminant dans la définition du mode de répartition des revenus ». Et c’est donc bien à une déconstruction des idéologies qu’il faut s’attaquer, ce qui n’est pas l’objet de l’ouvrage.
Basé sur une multitude d’études scientifiques, illustré par de nombreux graphiques issus de ces études et quelques dessins humoristiques, l’ouvrage brosse un tableau général remarquable de cohérence sur l’impact négatif des inégalités sur une multitude d’aspect de la vie des humains. On en sort convaincu, s’il en était besoin, qu’aller vers plus d’égalité, c’est aller vers une vie plus heureuse pour la très grande majorité de la population.