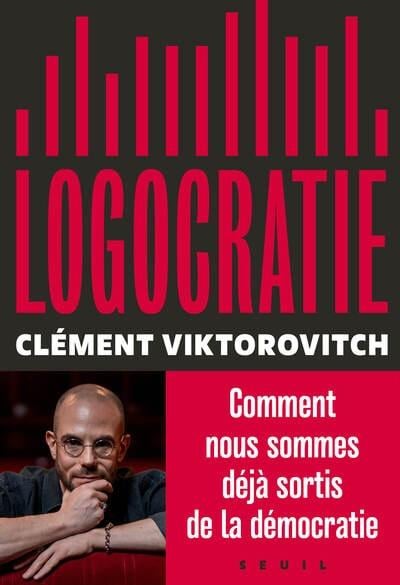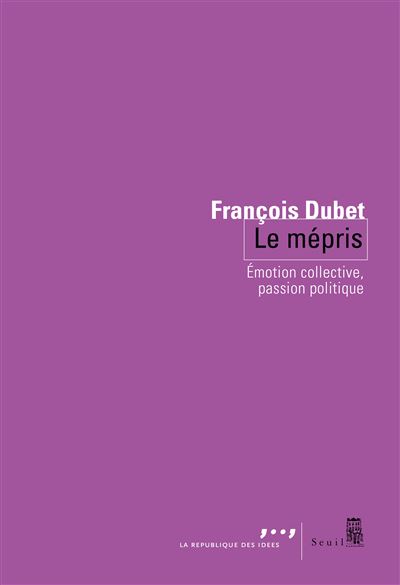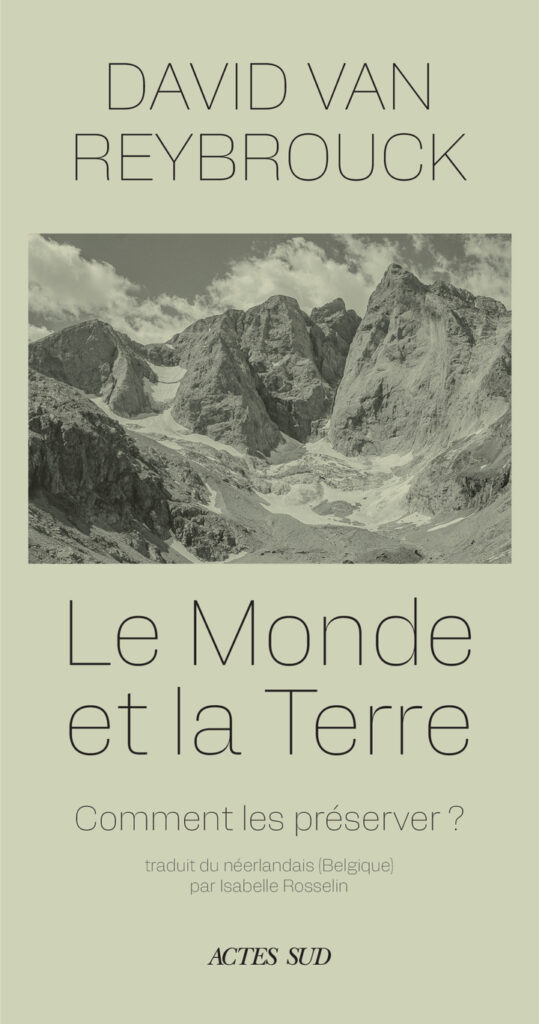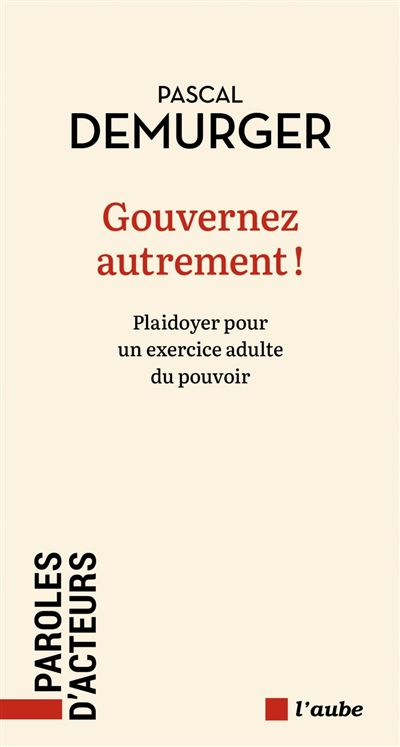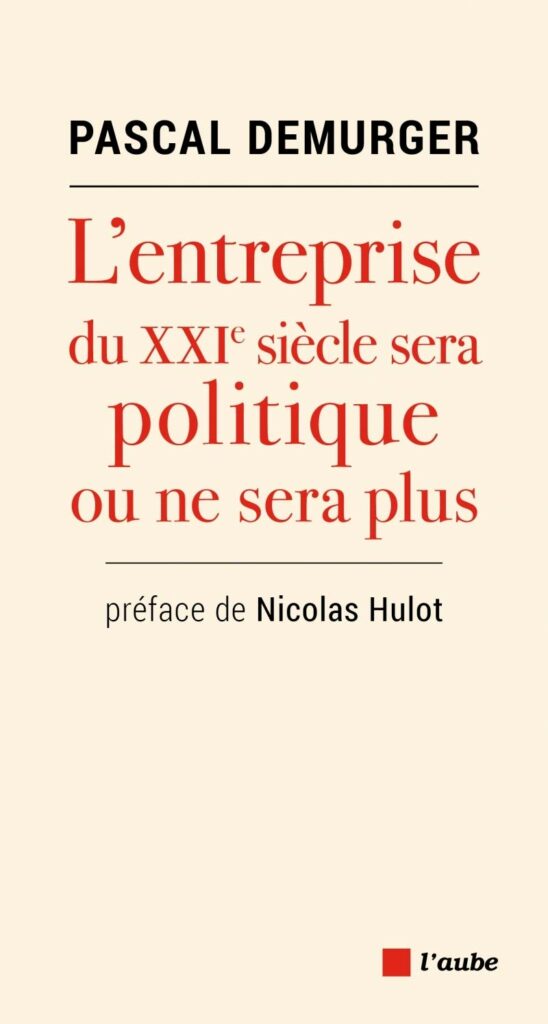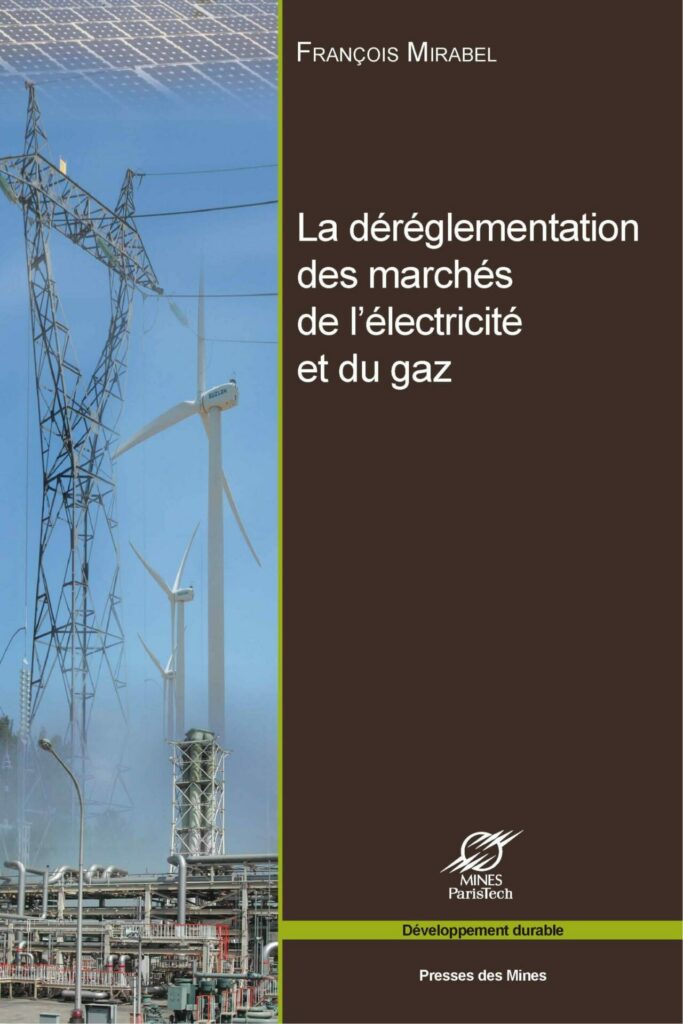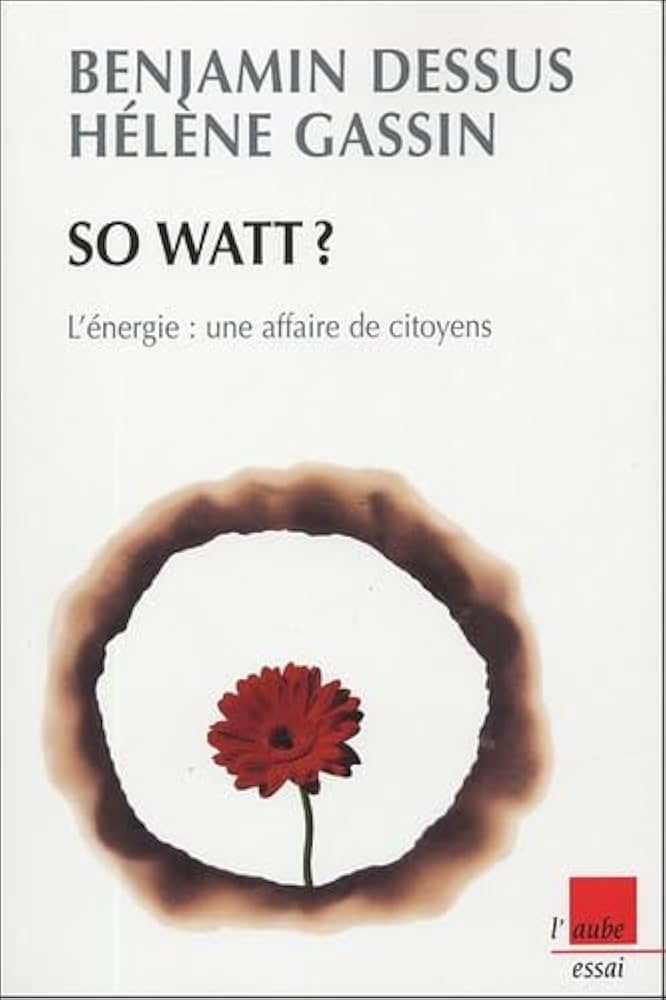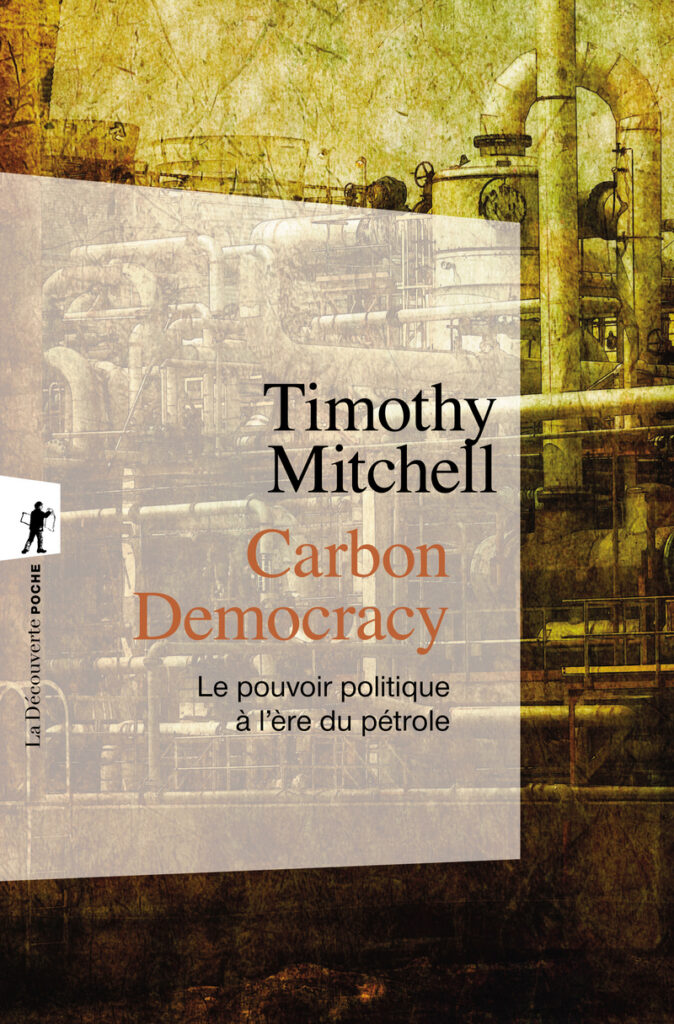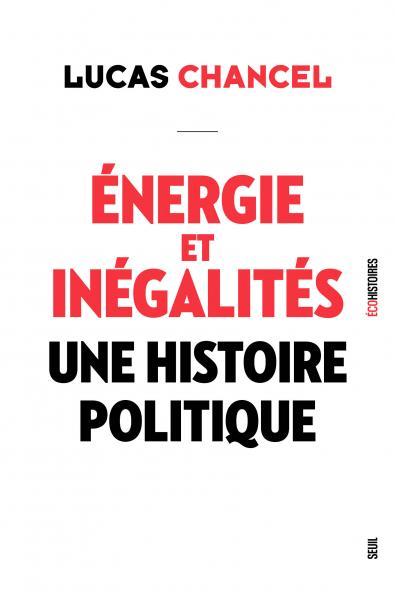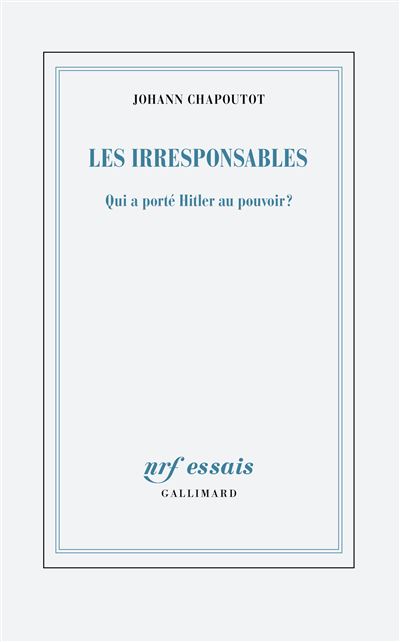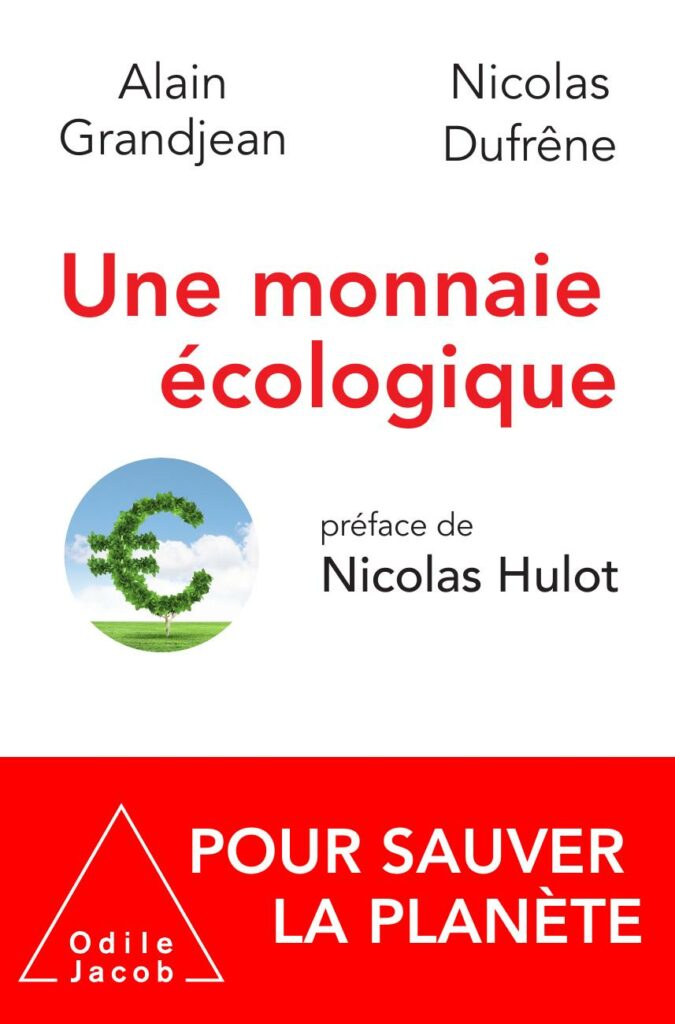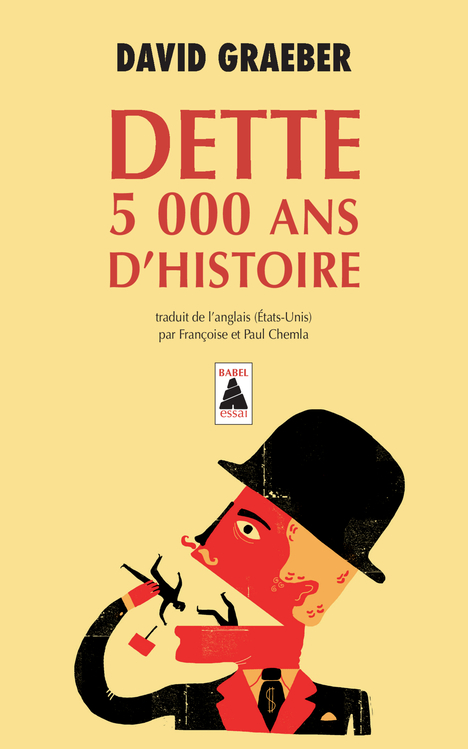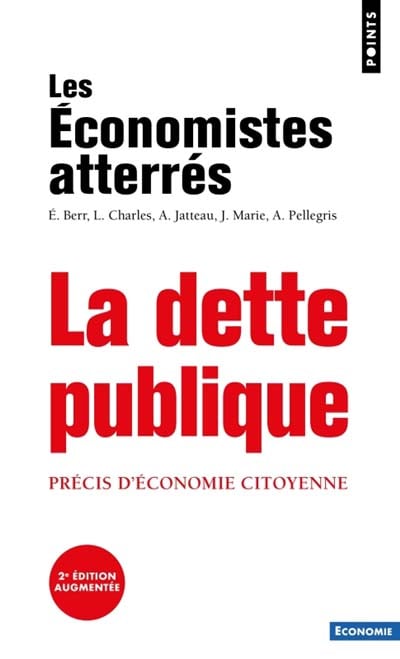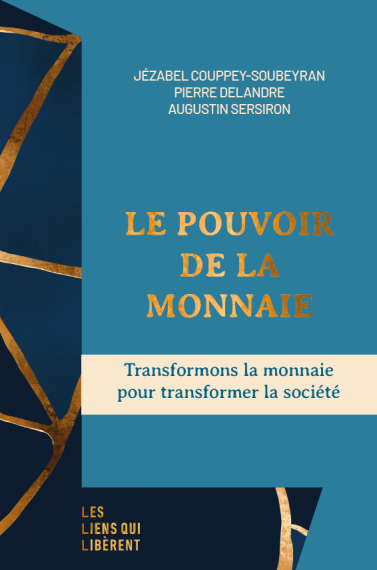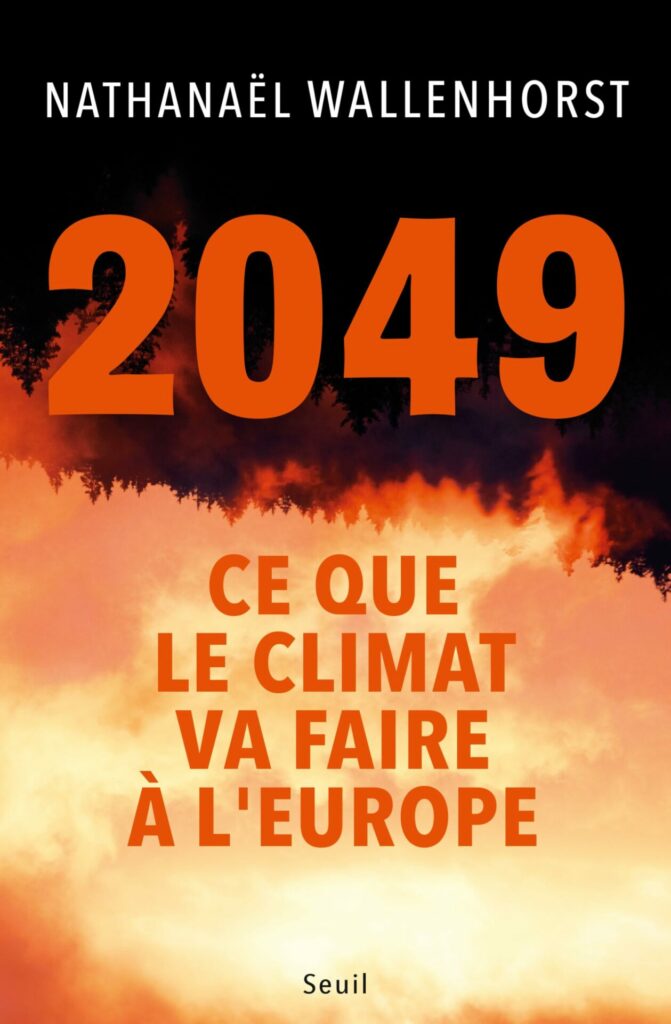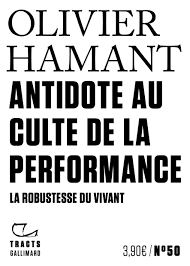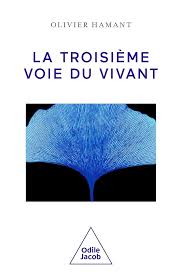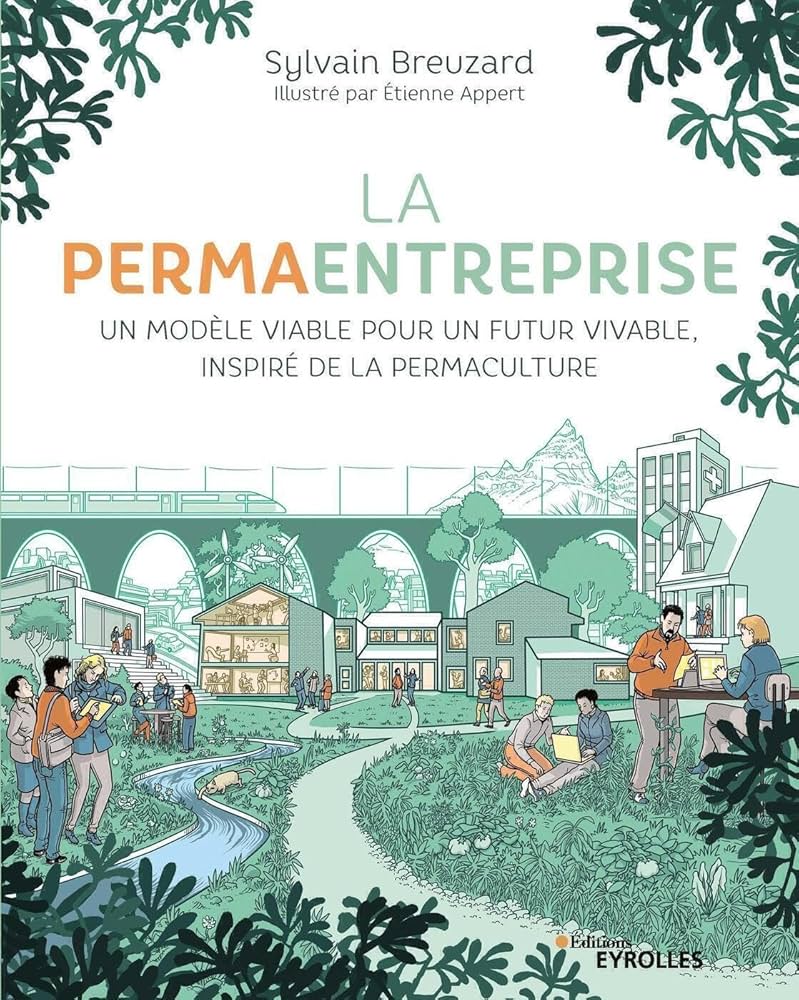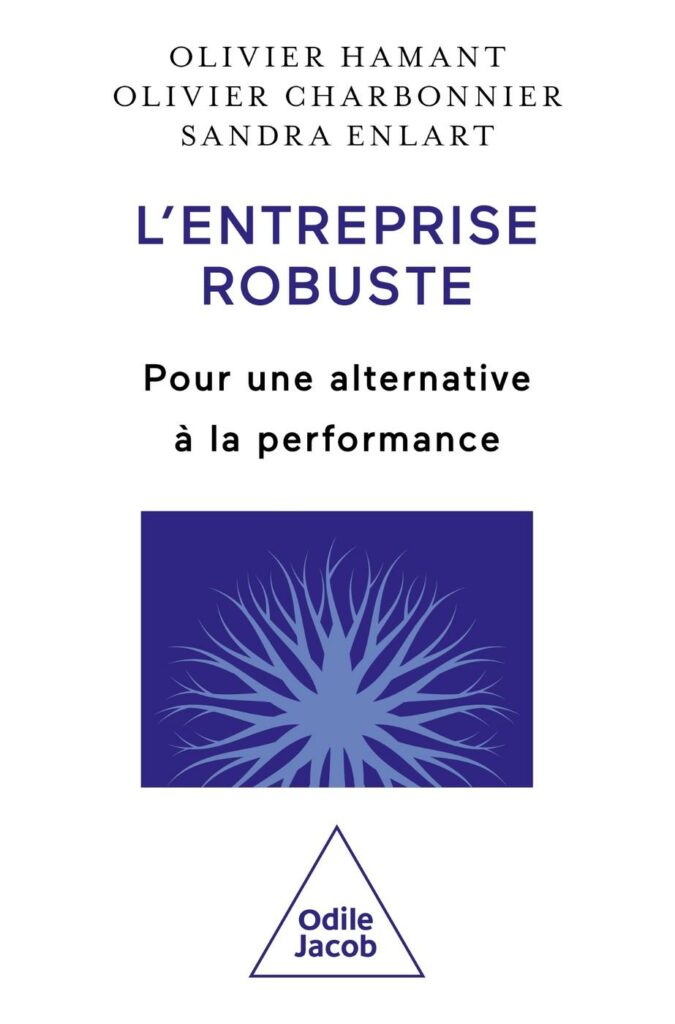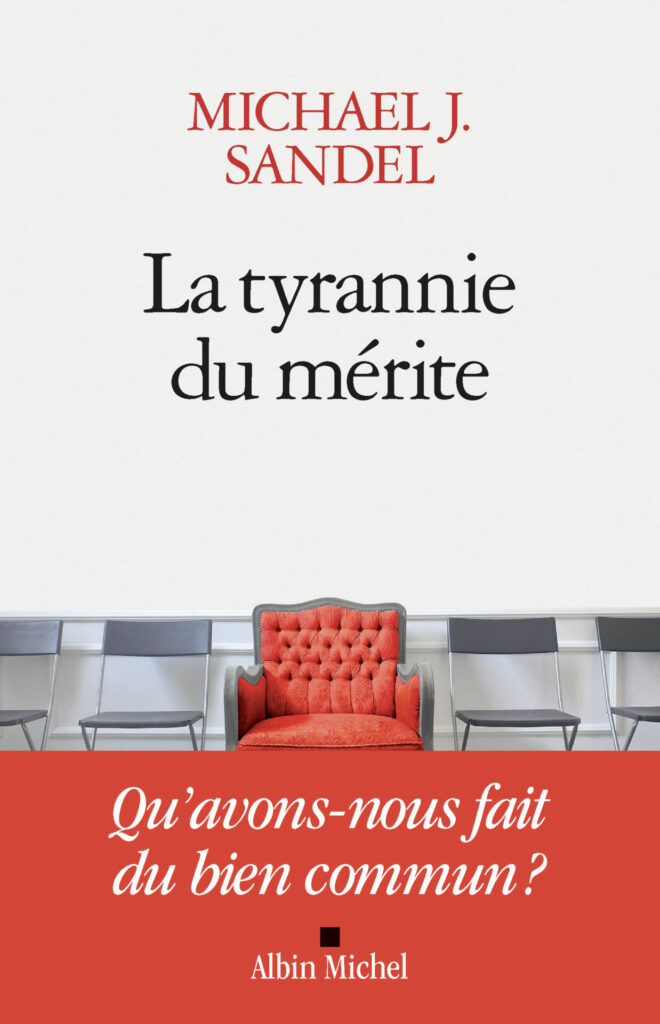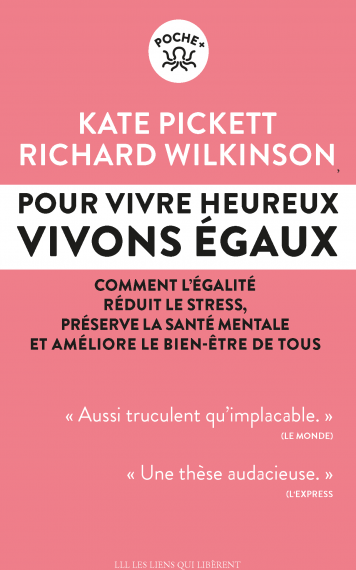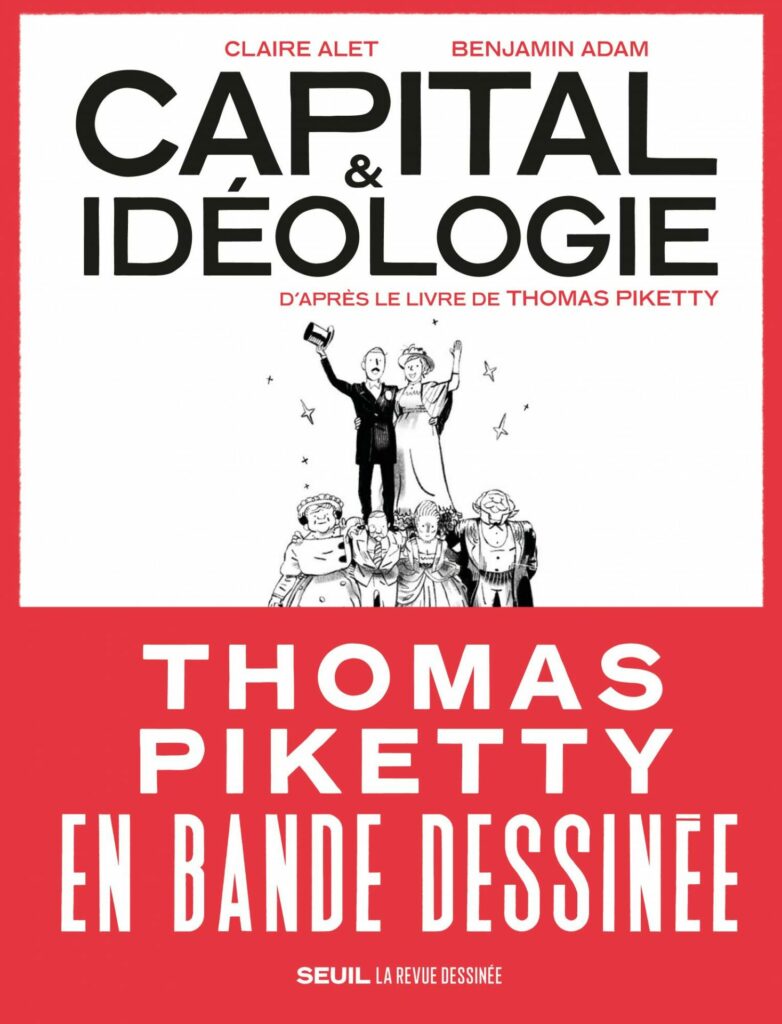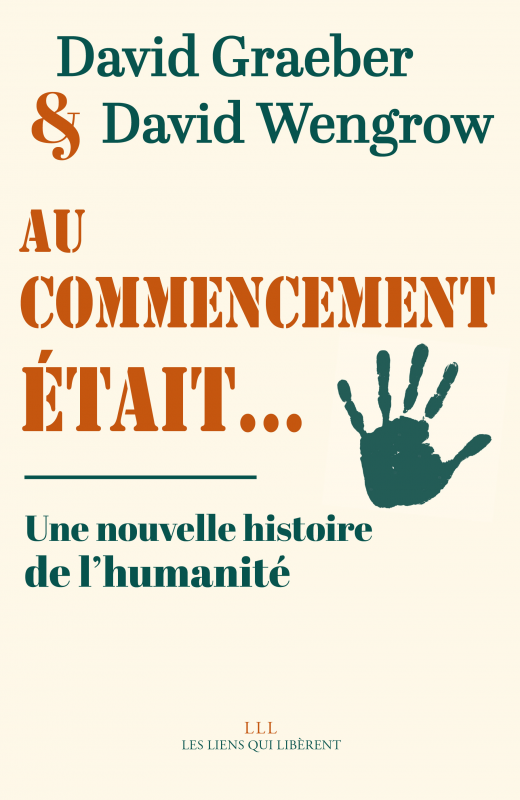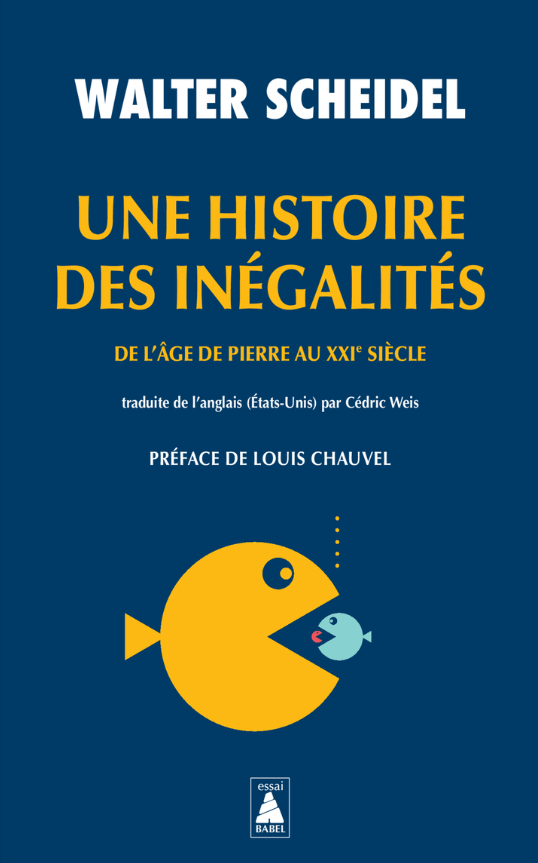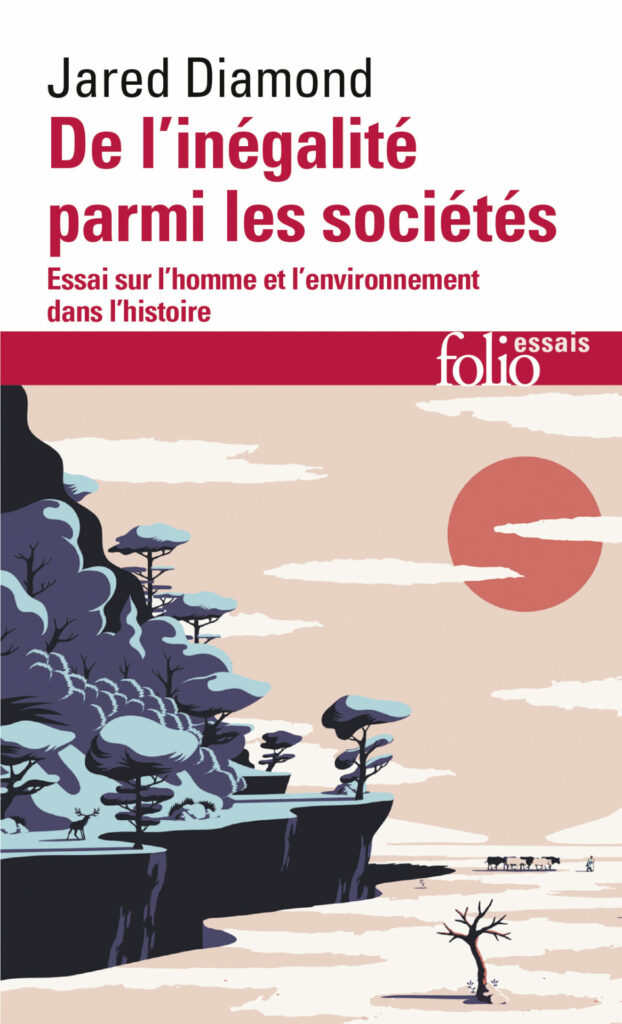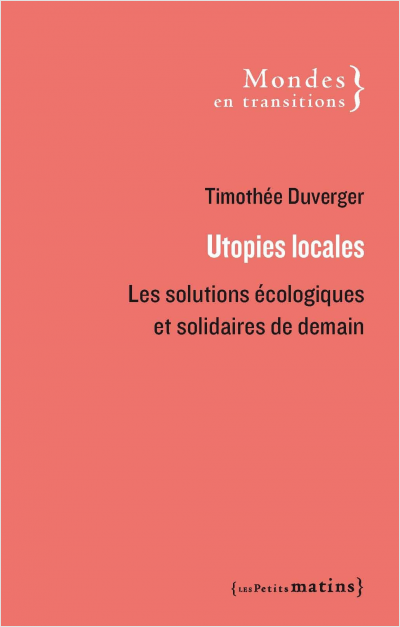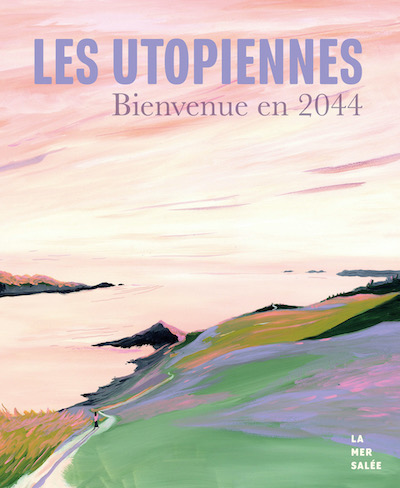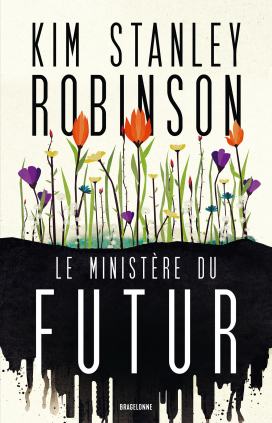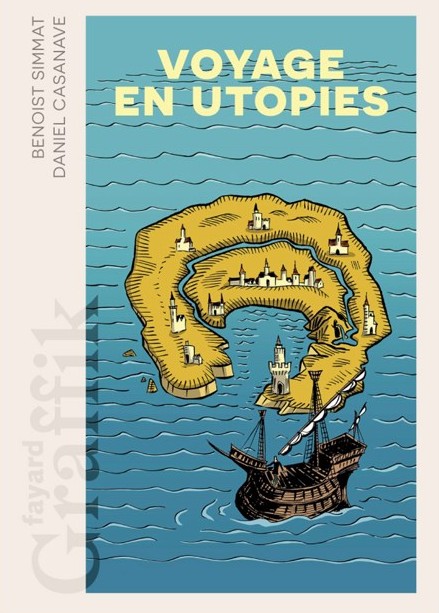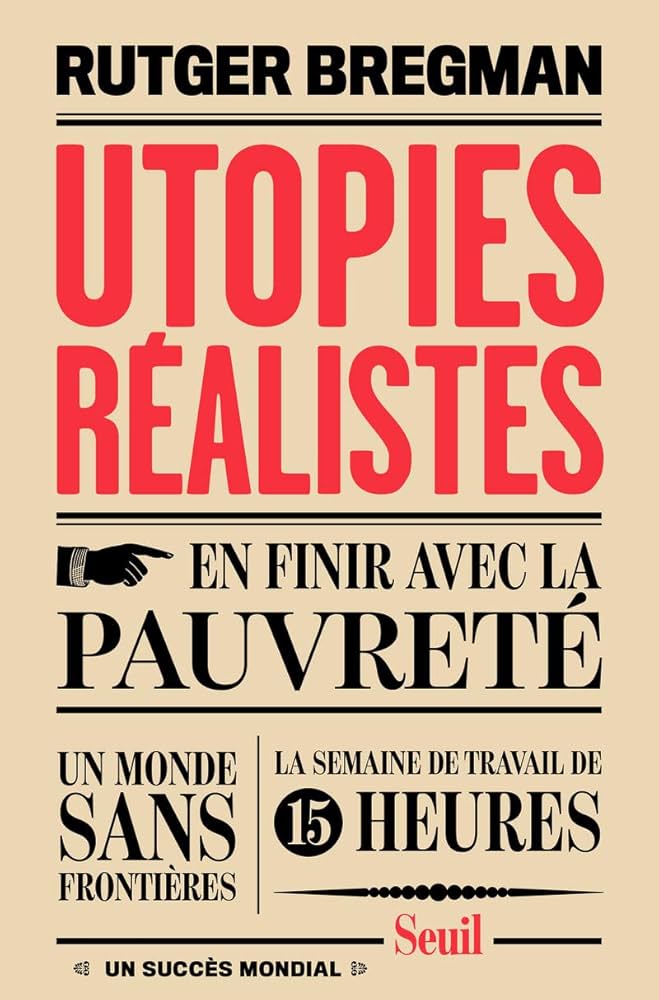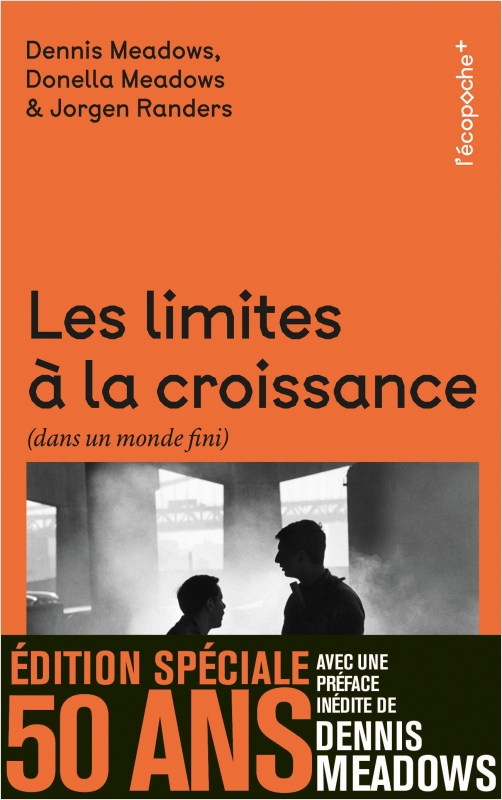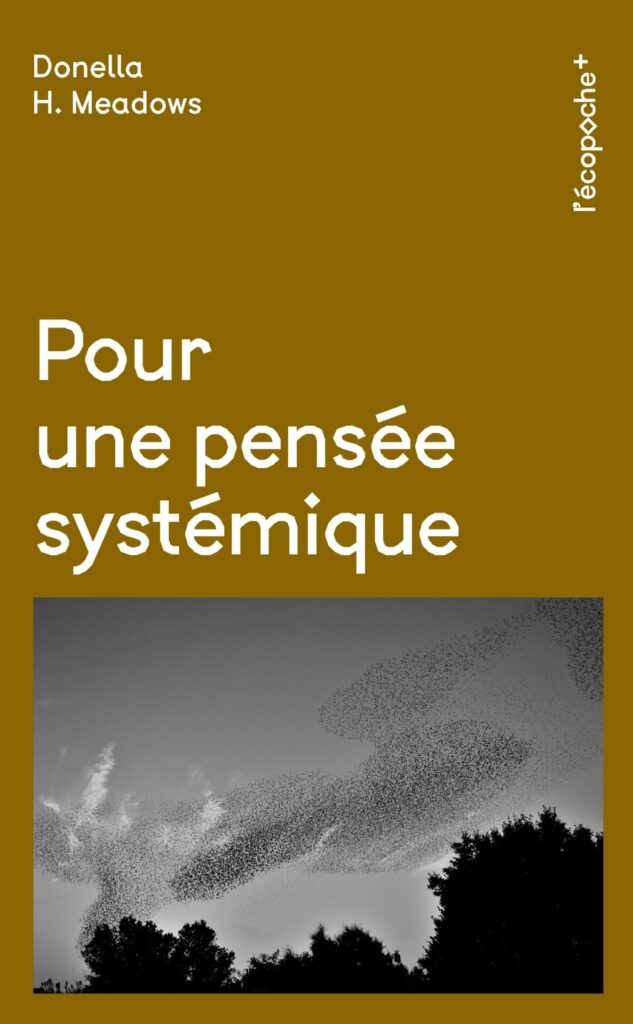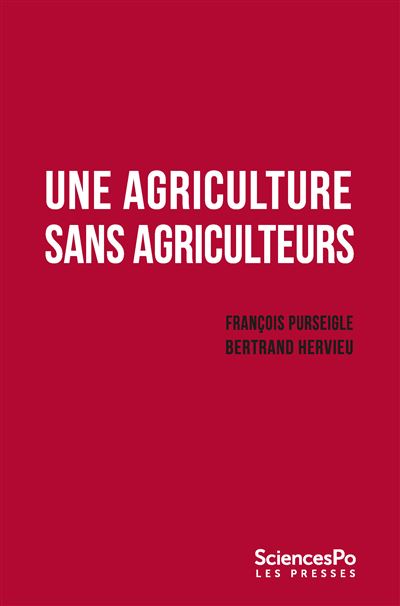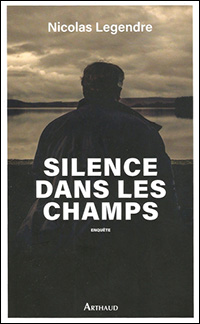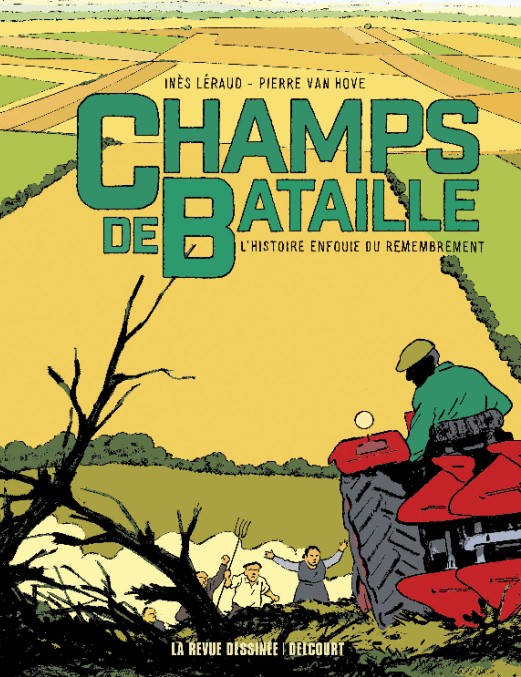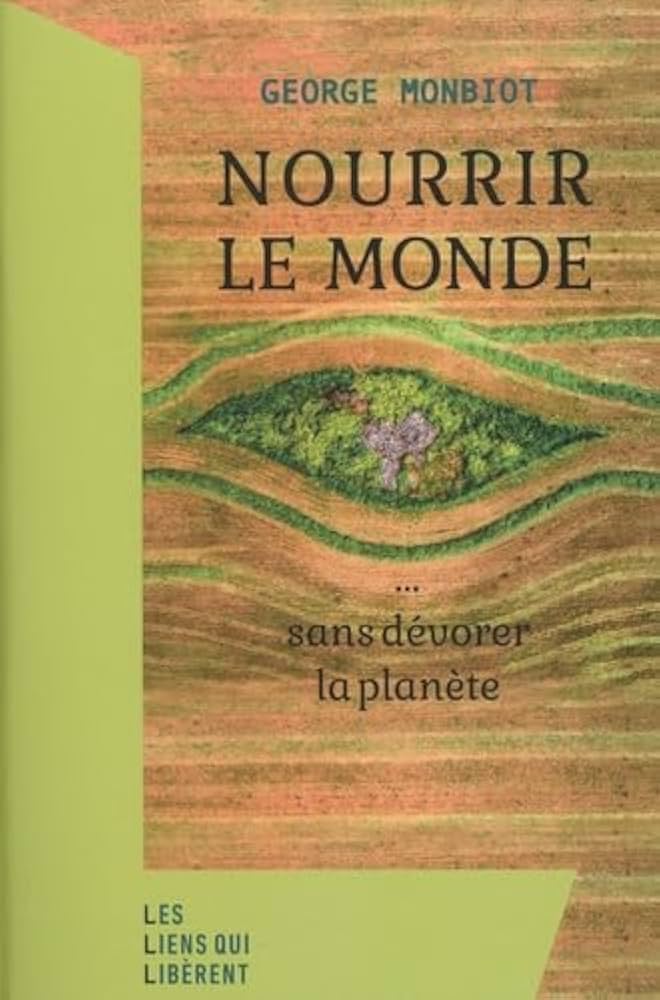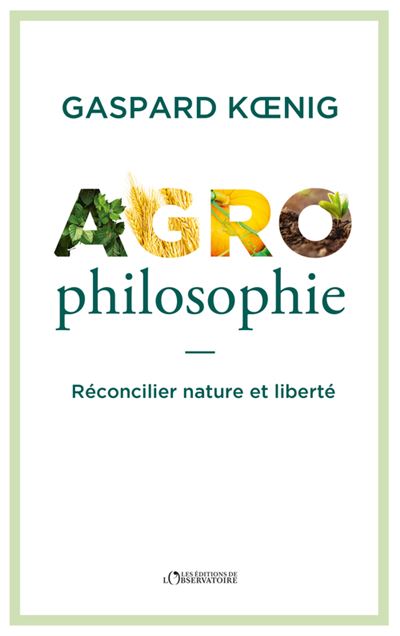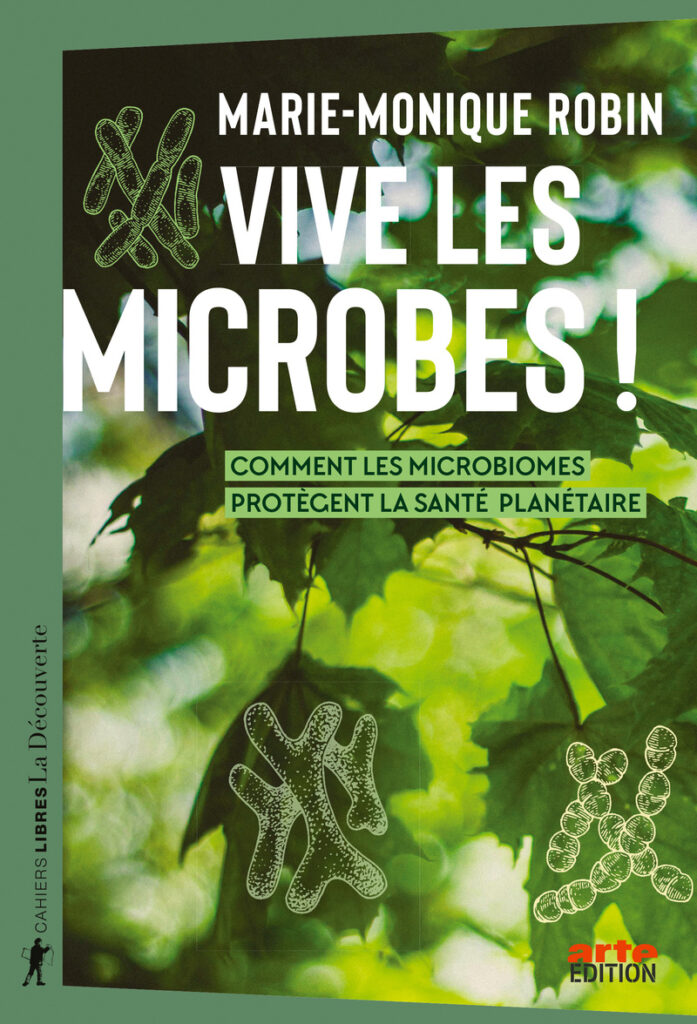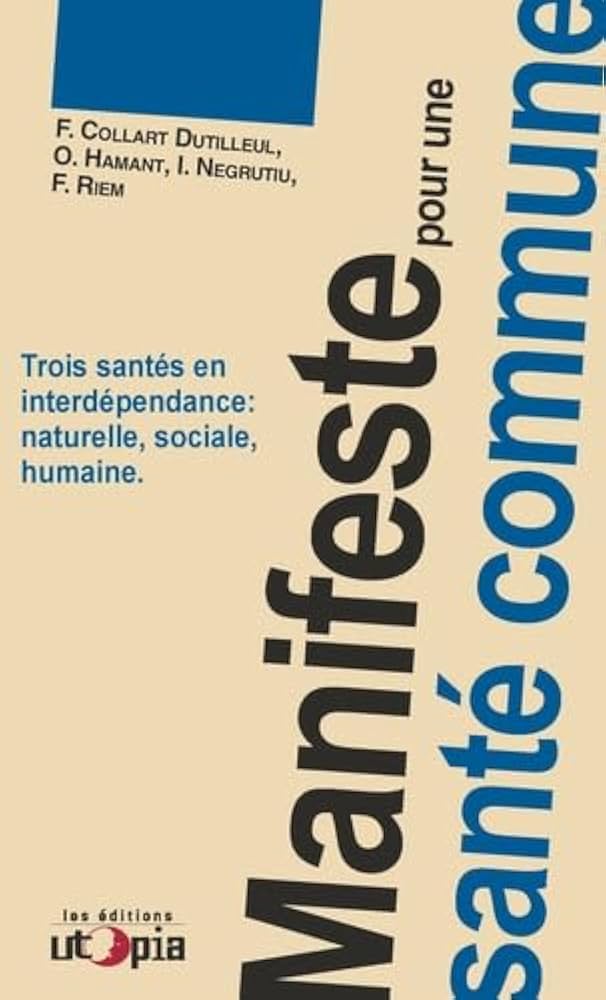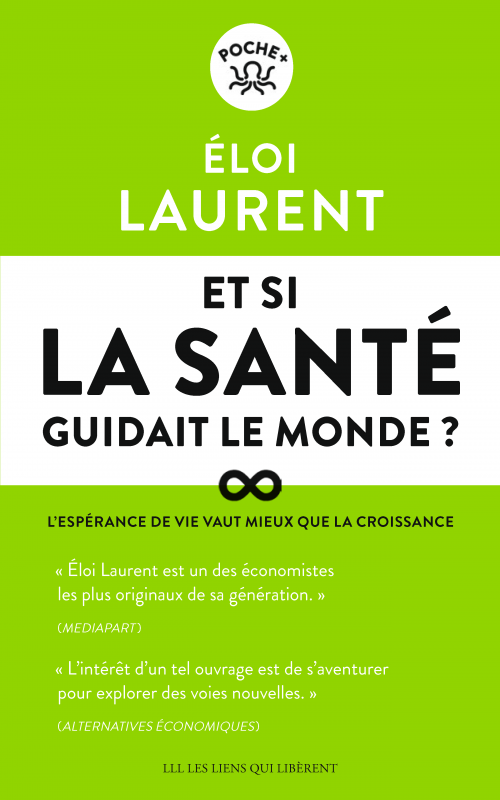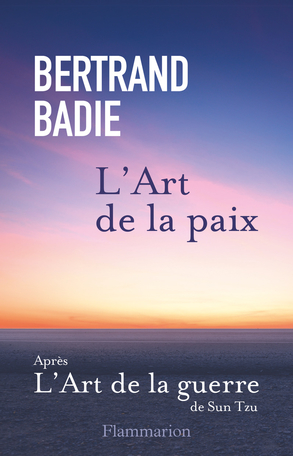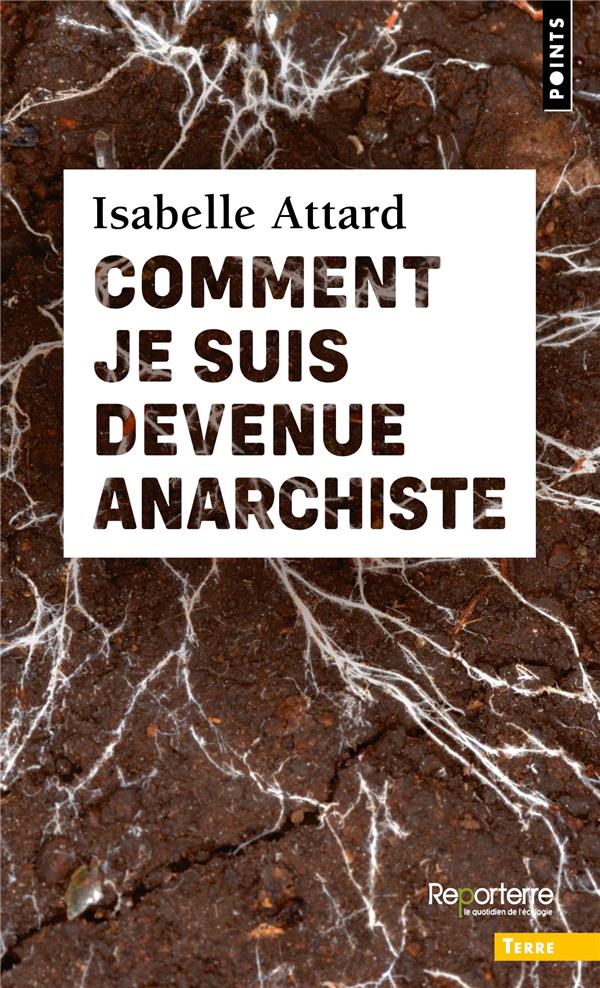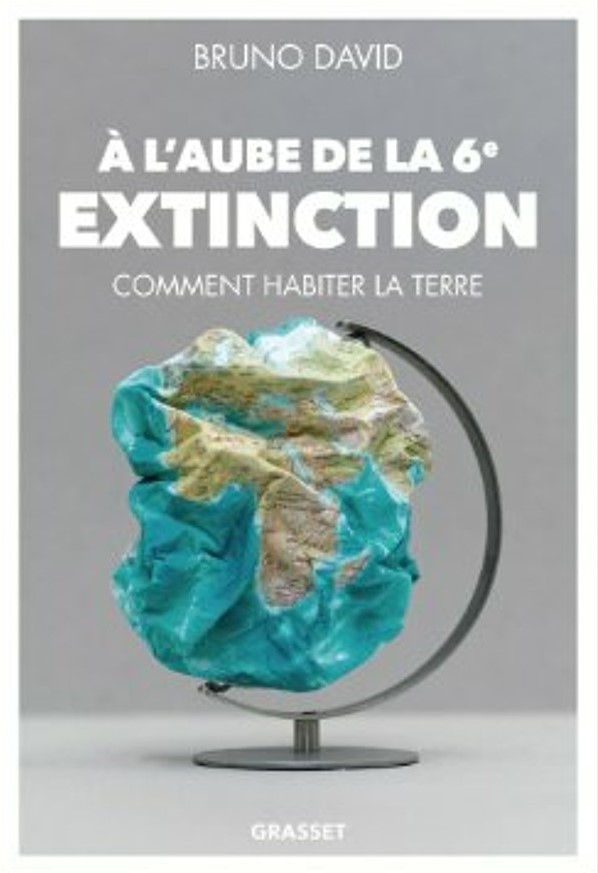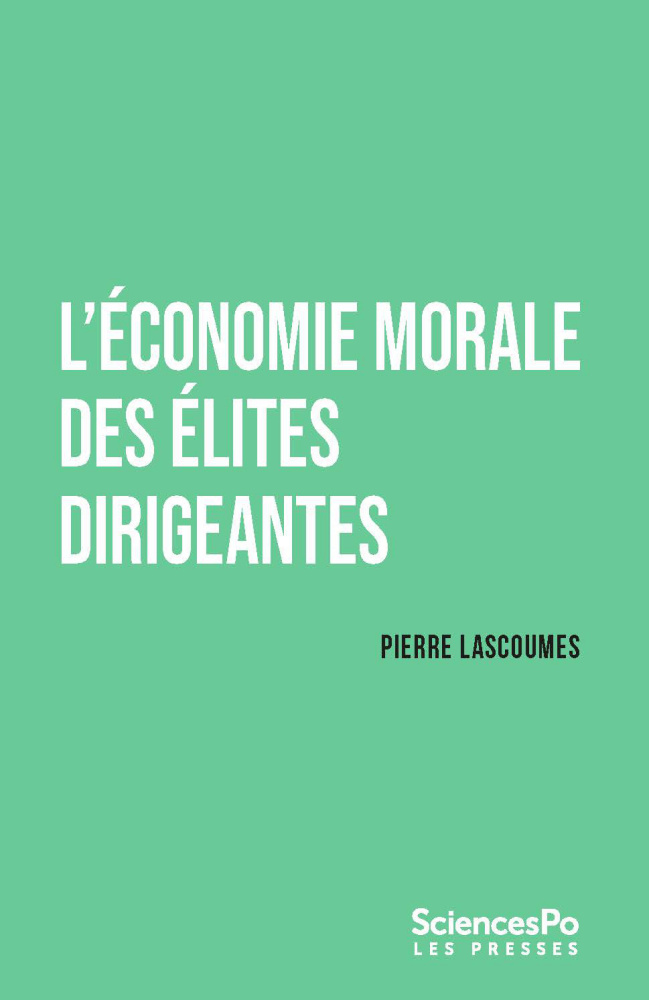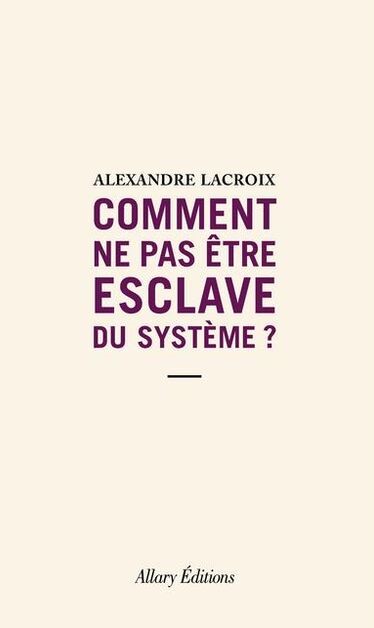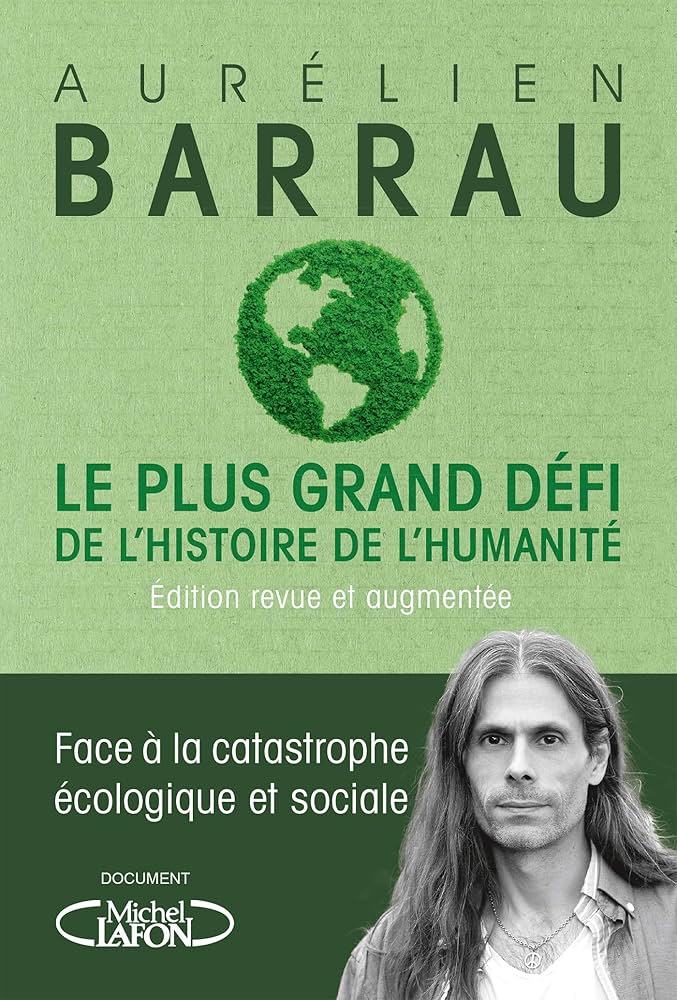Essai sur l’homme et l’environnement dans l’histoire
Jared Diamond, Editions Gallimard, 2000
Le point de départ de l’ouvrage de Jared Diamond, c’est un échange qu’il a eu avec un chef local alors qu’il étudiait, en tant que biologiste, les oiseaux locaux de Nouvelle Guinée. La question que posait Yali, le chef local, c’est une explication de la différence de développement entre une population neo-guinéenne, qui vivait encore « à l’âge de pierre » dans des villages indépendants il y a encore deux cent ans et les européens qui sont arrivés avec leur organisation centralisée, leurs biens matériels, leurs armes… et leurs maladies. « Ces disparités considérables devraient avoir des causes puissantes qu’on aurait pu croire évidentes ». De fait, la réponse n’est pas évidente et il faut 600 pages à Jared Diamond pour nous raconter comment la géographie, et l’environnement dans lequel ils vivent, a impacté l’histoire des groupes humains. « L’histoire a suivi des cours différents pour les différents peuples en raison des différences de milieux, non pas de différences biologiques entre ces peuples ». La dernière partie de cette phrase explicite une des motivations fortes de l’auteur pour écrire l’ouvrage : évacuer l’explication biologiste et raciste.
Jared Diamond est un biologiste de l’évolution, principalement des oiseaux, ce qui l’a amené à travailler en Amérique du Sud, en Afrique australe, en Indonésie, en Australie et surtout en Nouvelle Guinée, et ainsi côtoyer de nombreuses sociétés humaines, dont certaines très différentes (beaucoup moins avancées, diraient certains) de nos sociétés occidentales. Sa carrière scientifique a évolué vers la géographie dont il est aujourd’hui professeur. Son ouvrage est très transversal et fait appel à de multiples disciplines : biologie, géographie, mais aussi linguistique, épidémiologie, archéologie, histoire des technologies…
Dans une première partie, il nous propose un survol de l’histoire humaine qui voit les humains se séparer des singes et commencer à migrer depuis l’Afrique vers les autres continents. Il s’intéresse ensuite aux effets des milieux (continentaux ou insulaires) sur la naissance des empires ou le maintien des tribus de chasseurs cueilleurs. Et il termine cette première partie par le sujet des collisions entre populations de différents continents, en particulier la colonisation de l’Amérique par les espagnols.
La deuxième partie est consacrée à l’essor et l’extension de la production alimentaire. Elle analyse les facteurs qui font que « les populations de certaines parties du monde ont développé d’elles même cette production alimentaire, d’autres l’ont acquise dès la préhistoire de centres indépendants ; d’autres ne l’ont ni développé, ni acquise à la préhistoire, mais sont demeurées des chasseurs cueilleurs jusque dans les temps modernes ». Parmi ces facteurs, il ressort la disponibilité locale de plantes et d’animaux sauvages disponibles pour la domestication.
Le développement de la production alimentaire conduit à une densification de la population et ainsi un développement de maladies et de germes portés par les individus. Ces germes ont joué un rôle fondamental dans les colonisations, en particulier la colonisation de l’Amérique qui a vu la grande majorité de la population autochtone mourir à cause des germes apportés par les conquistadors.
L’auteur aborde ensuite le sujet de l’écriture qui est apparue dans les zones dans lesquelles se développait la production alimentaire. L’étude de la diffusion de l’écriture est un bon moyen d’étudier « l’effet de la géographie sur la facilité avec laquelle les idées et les inventions se propagent ». La production alimentaire par des humains spécialisés (les paysans) a permis à certains humains d’avoir du temps pour d’autres activités : les scribes pour l’écriture, les artisans pour développer des technologies, mais aussi des politiques, des bureaucraties et des armées.
Dans une dernière partie « le tour du monde en cinq chapitres », l’auteur applique les leçons des parties précédentes à chacun des continents et à quelques iles importantes.
Un ouvrage de synthèse remarquable qui nous permet de sortir de « l’occidentalocentrisme » qui irrigue souvent notre vision du monde. D’autant que l’auteur ne porte pas de jugement sur la qualité des voies de développement empruntées par les différents groupes humains : « En me penchant sur ces différences géographiques des sociétés humaines, mon propos n’est pas de célébrer un type de société de préférence à une autre, mais uniquement de comprendre ce qui s’est passé dans l’histoire ».