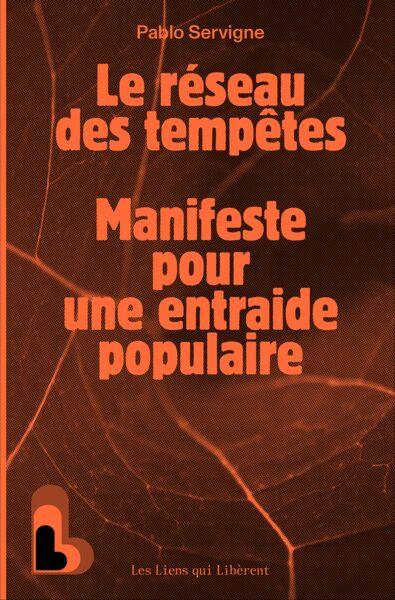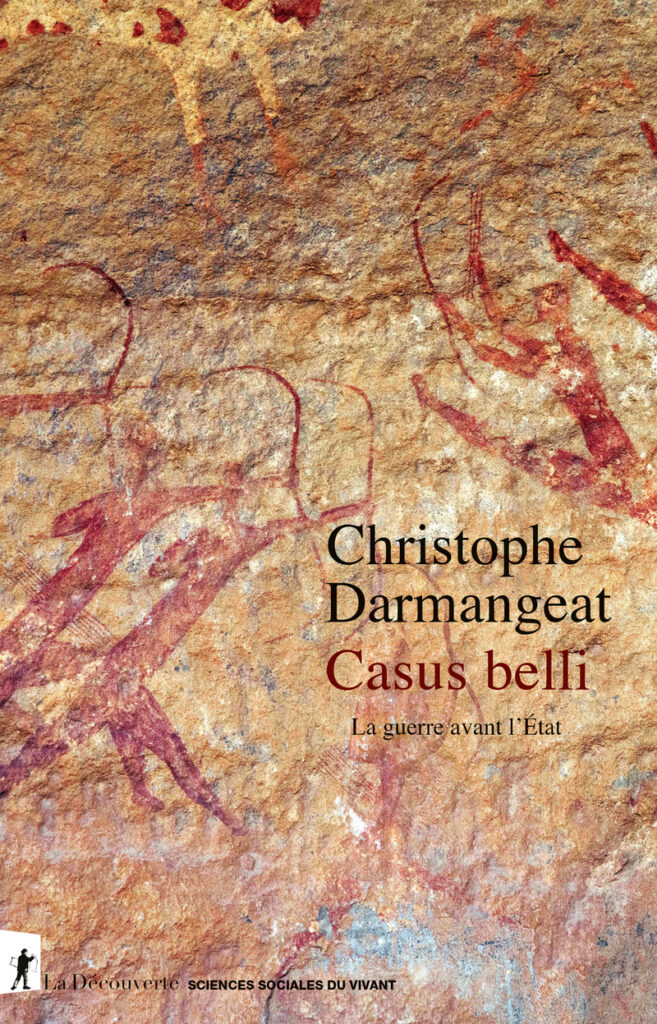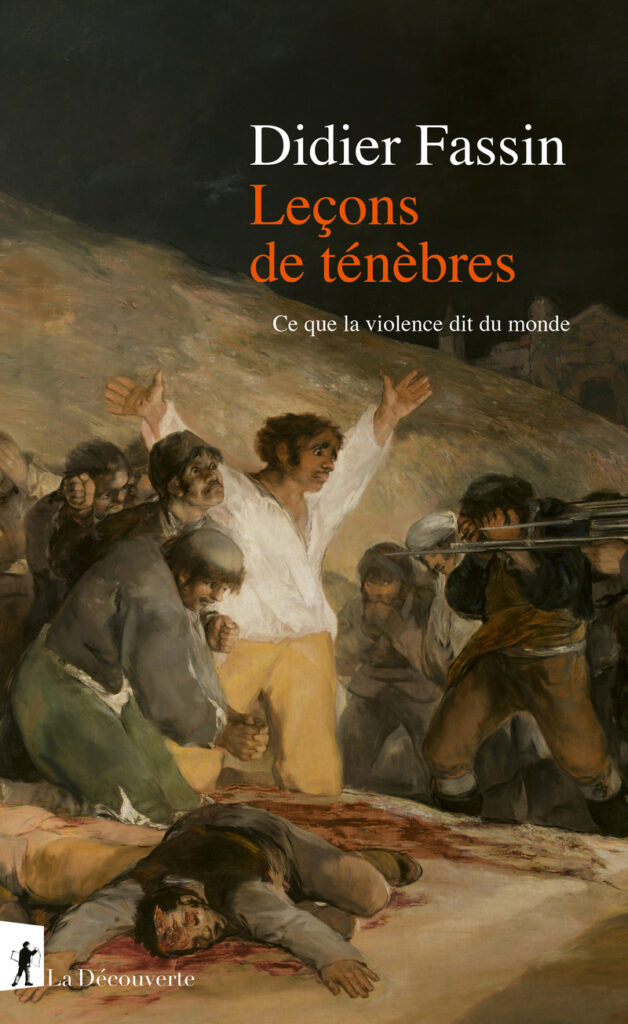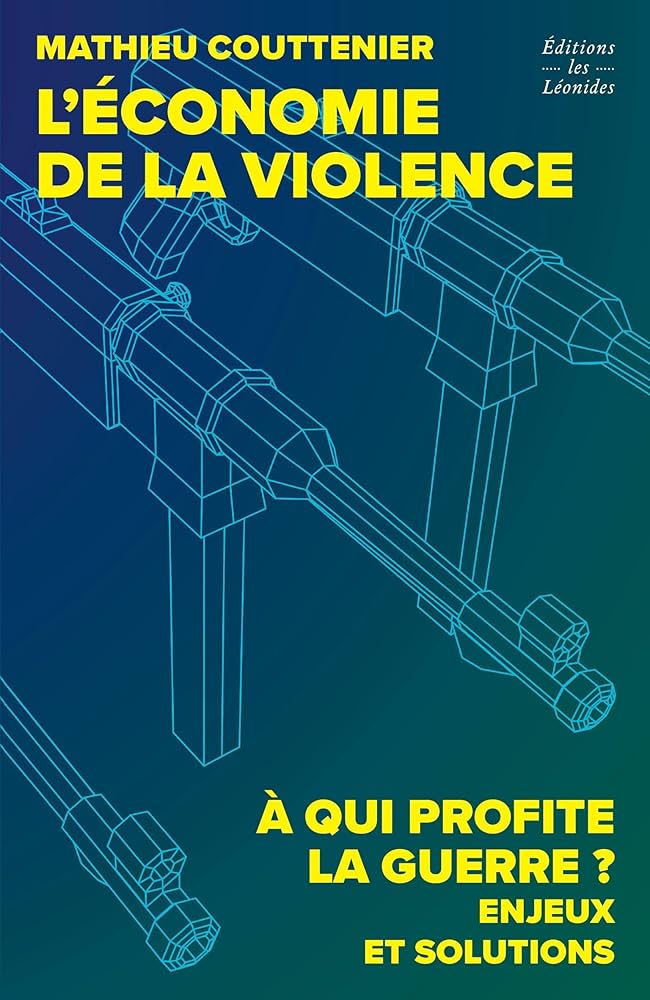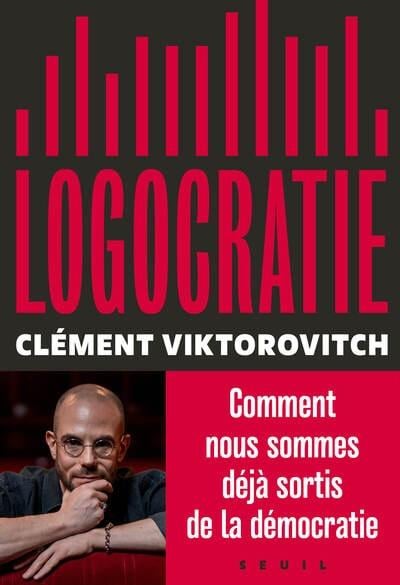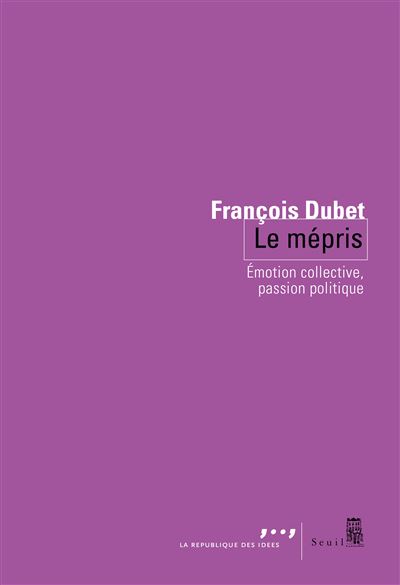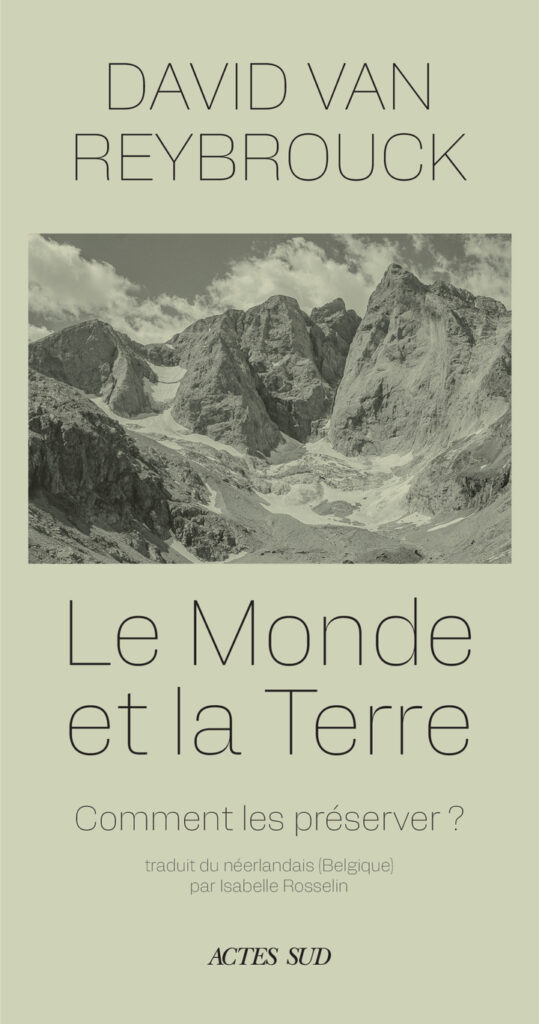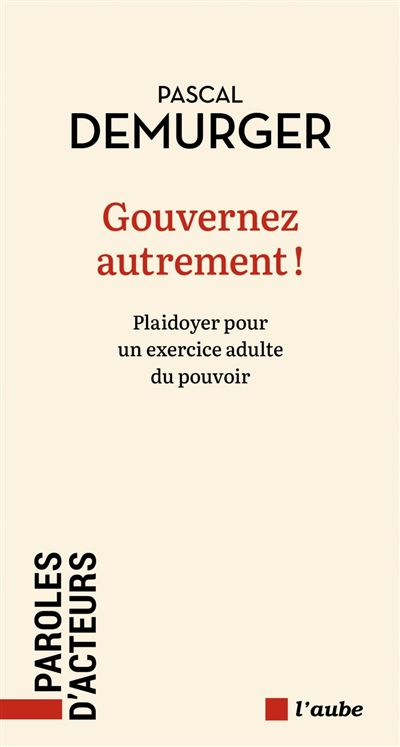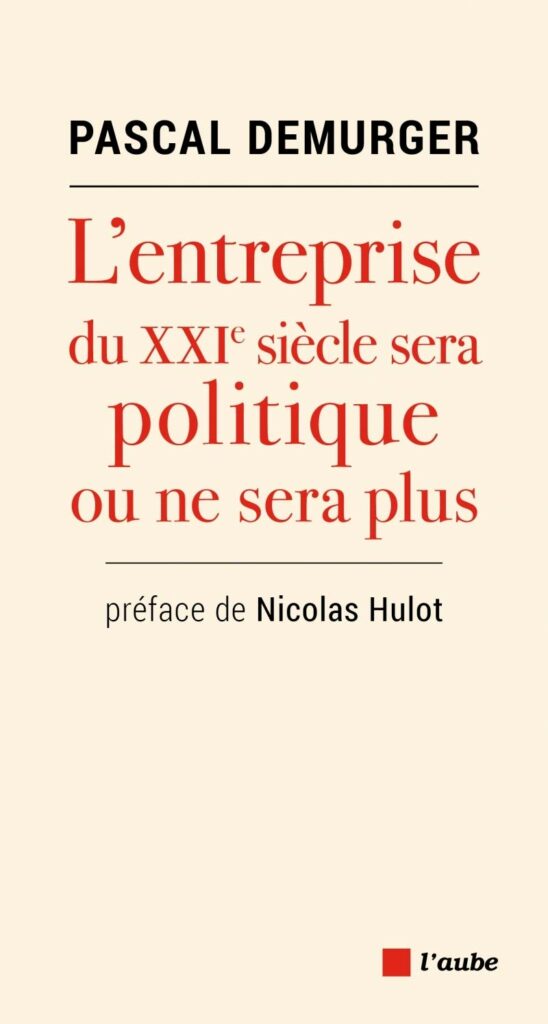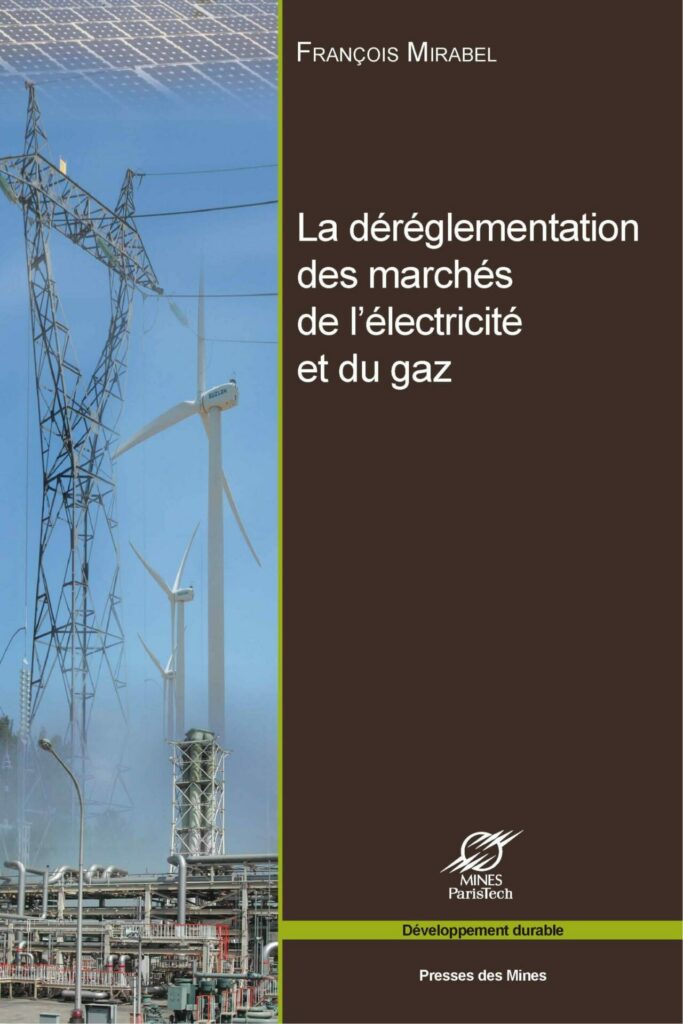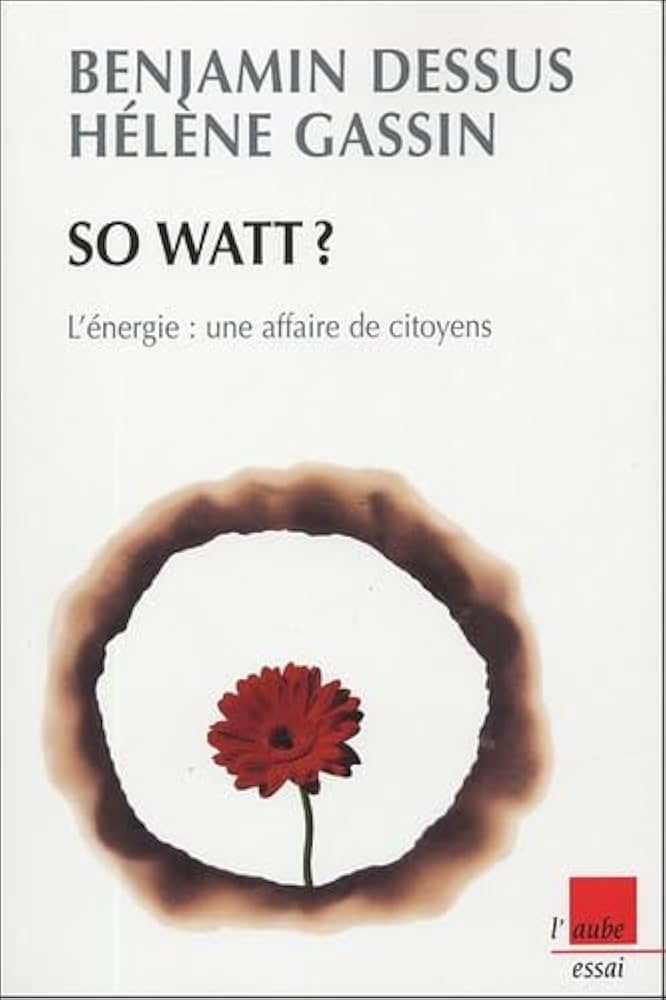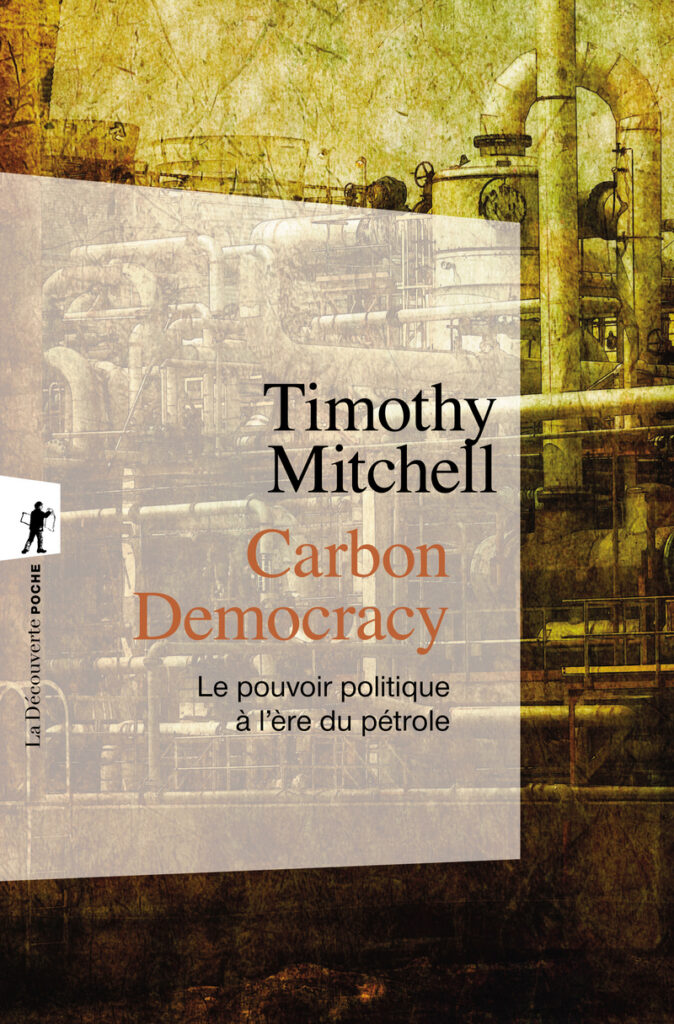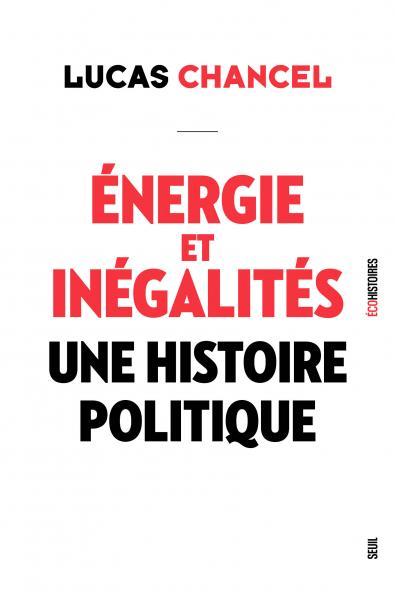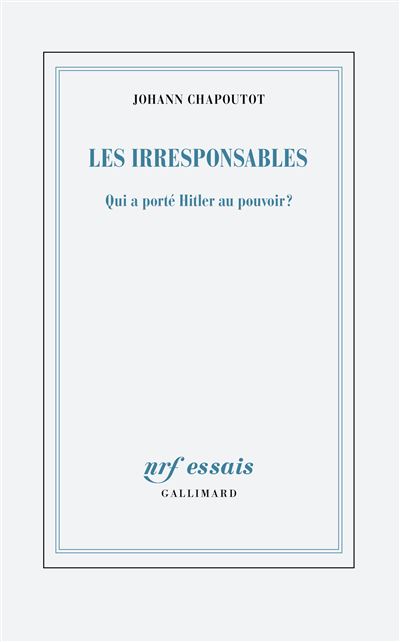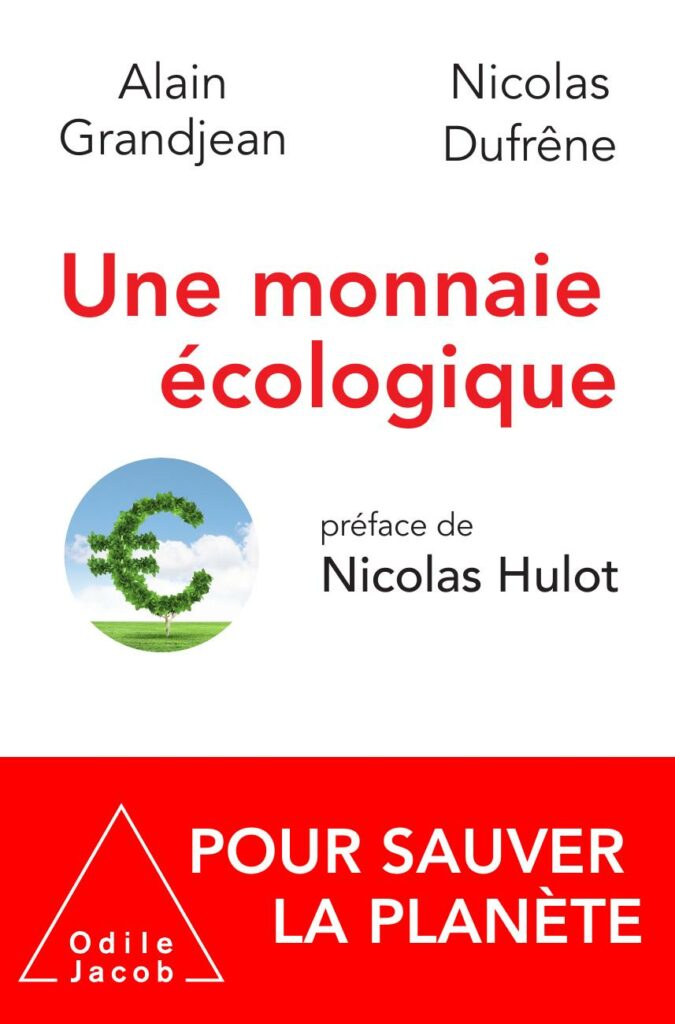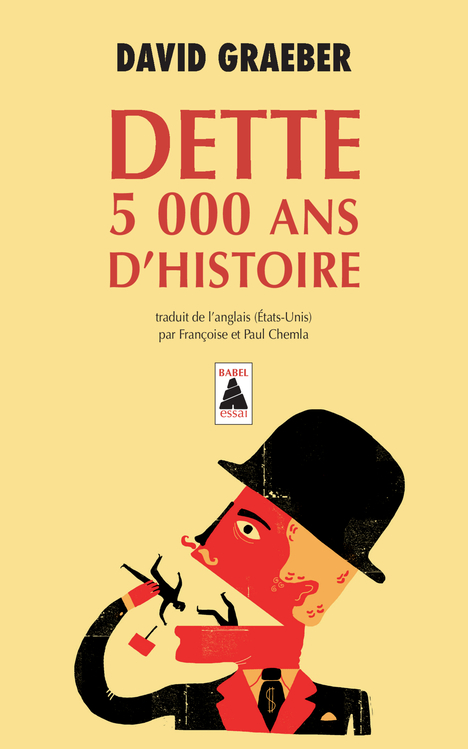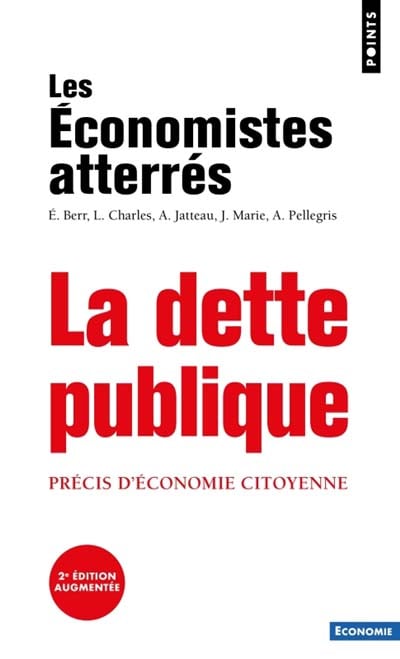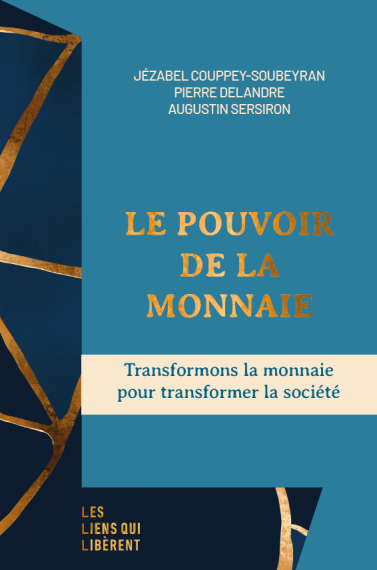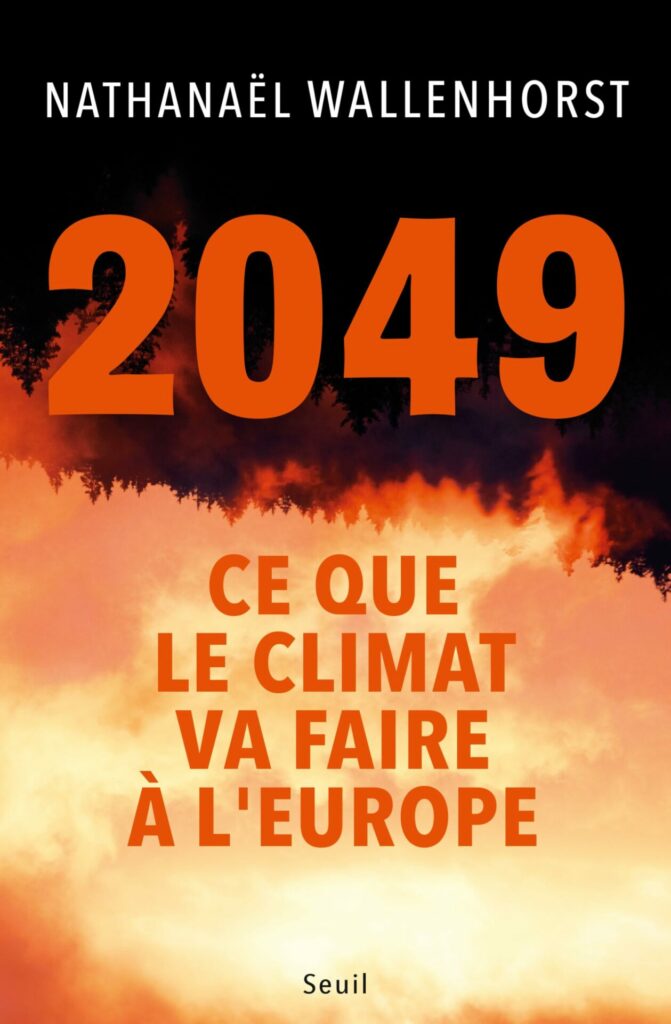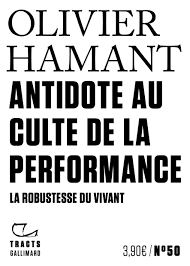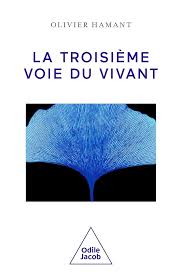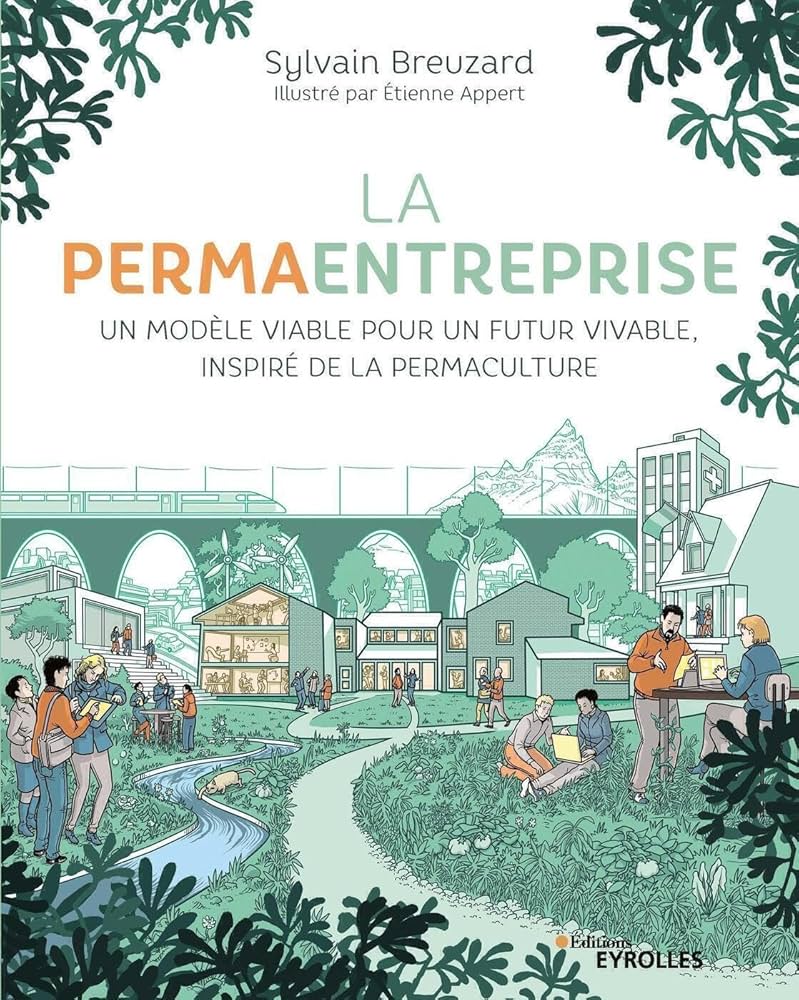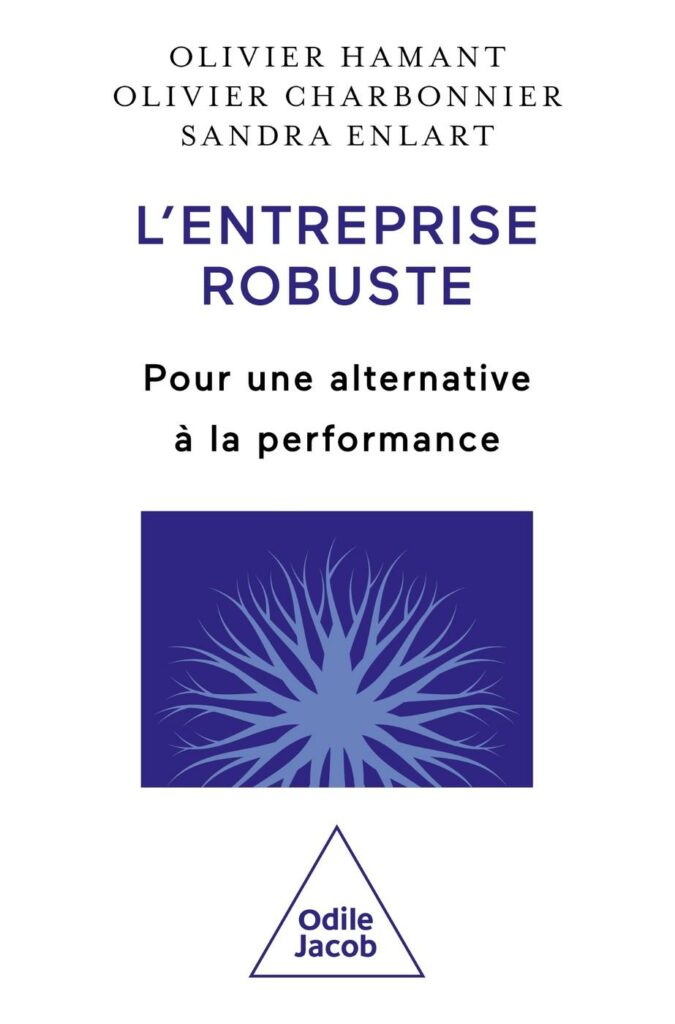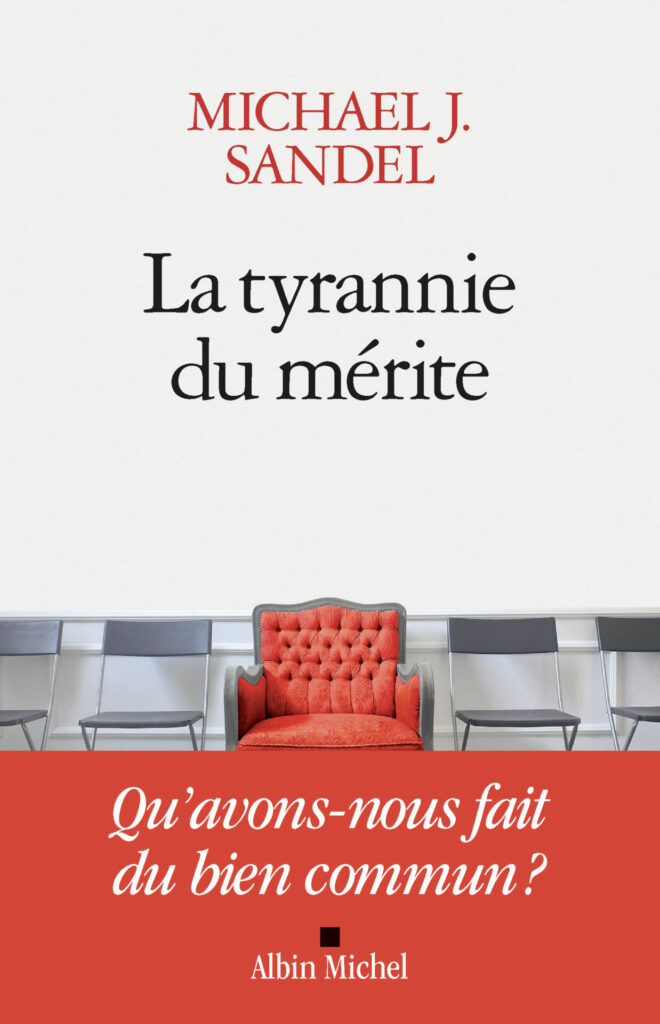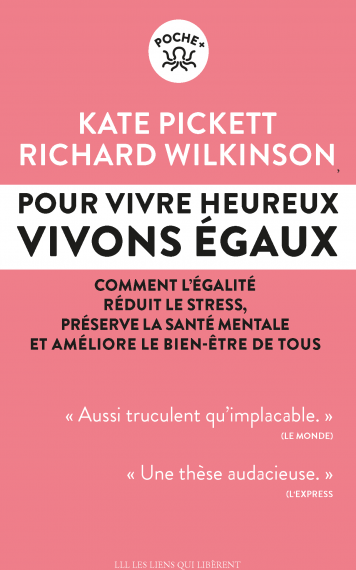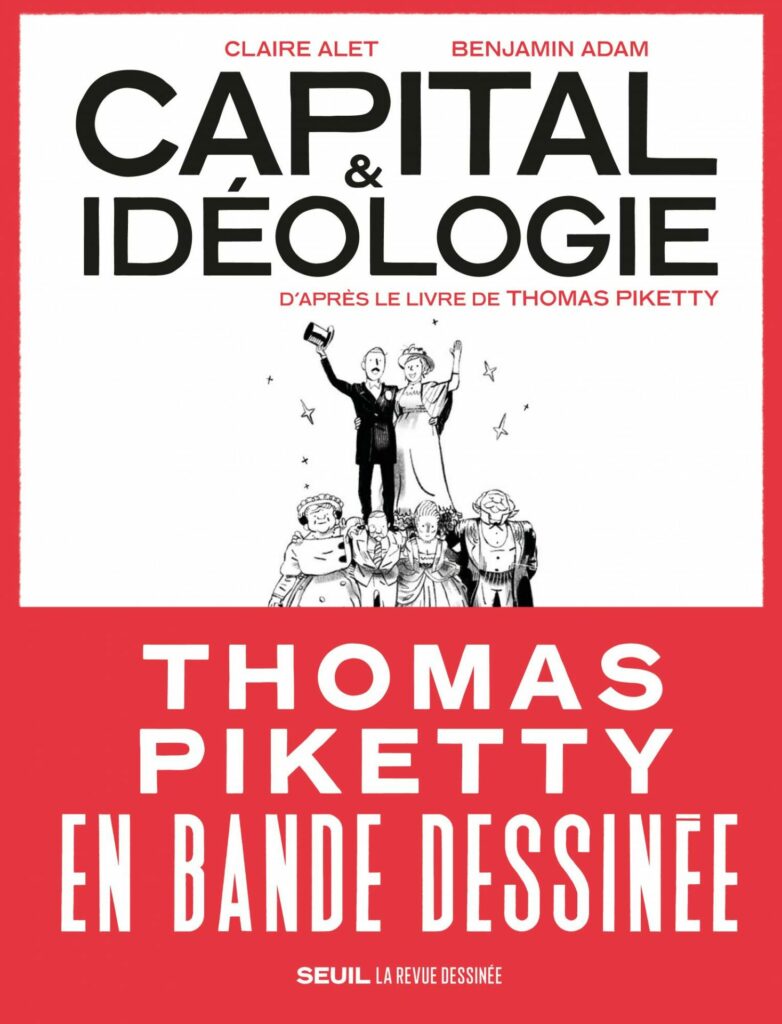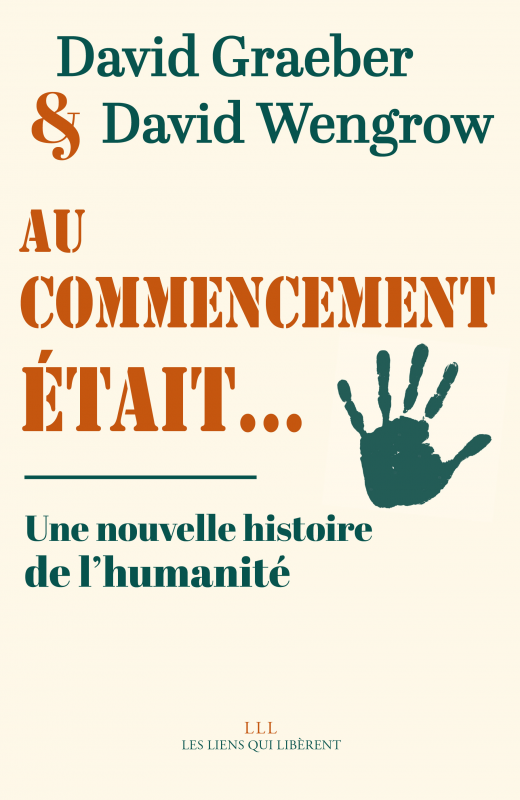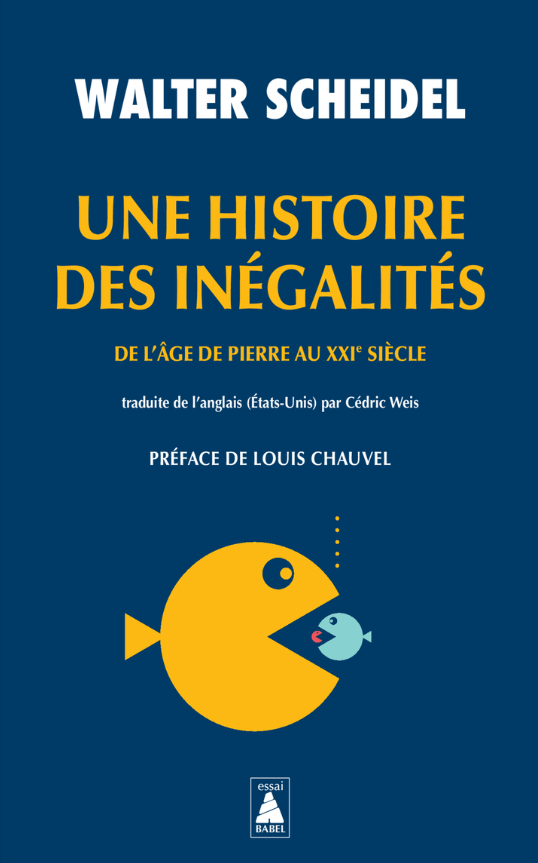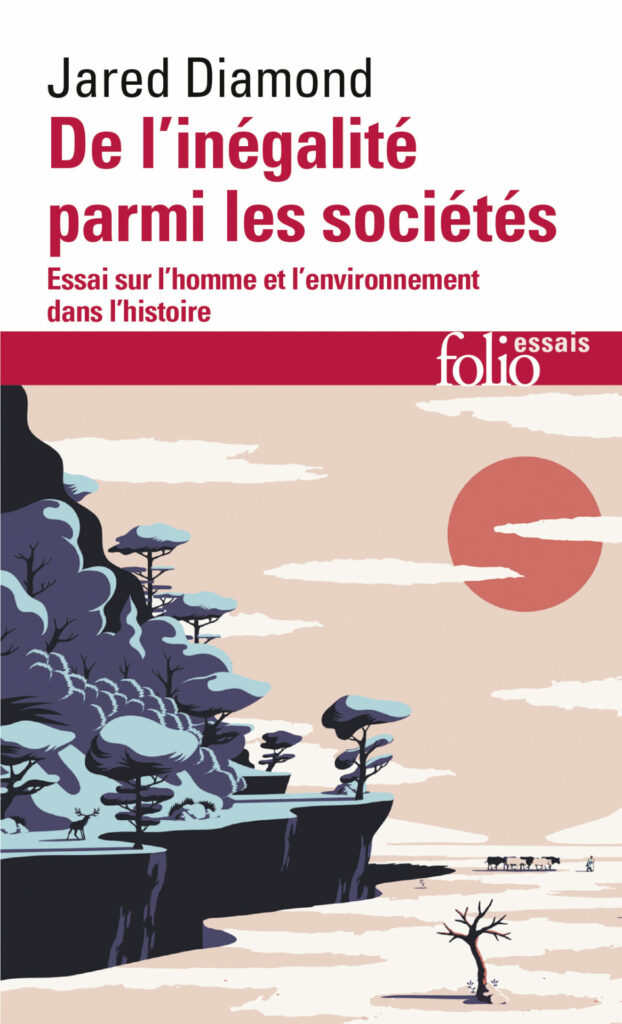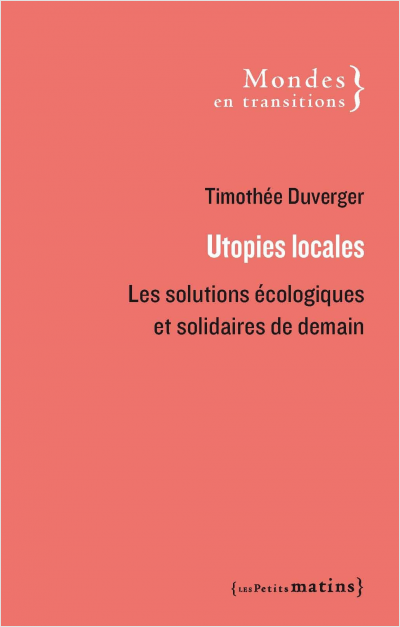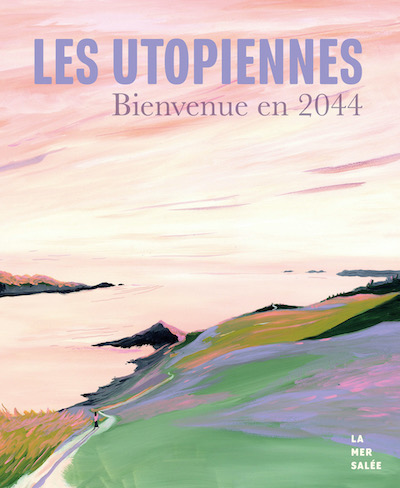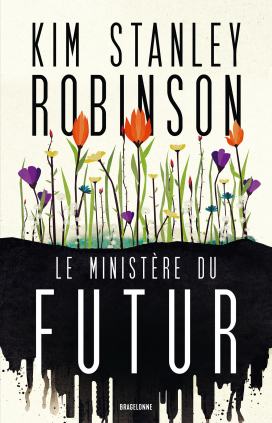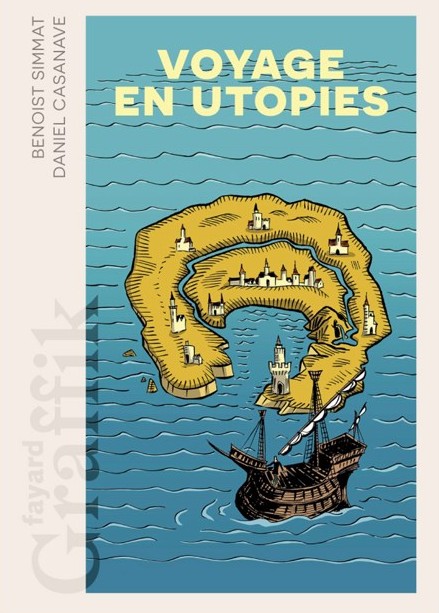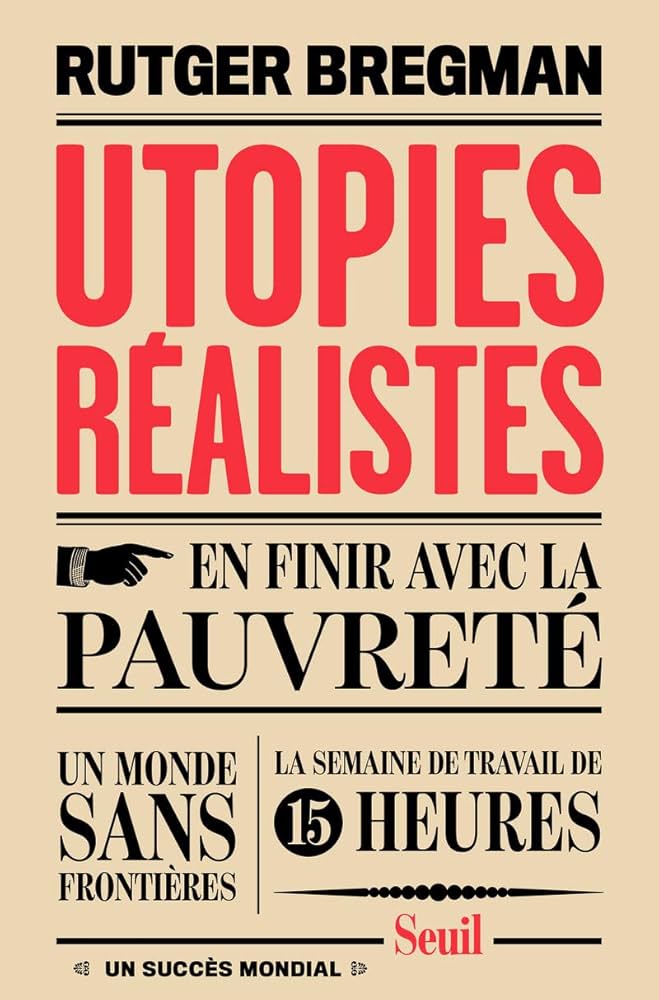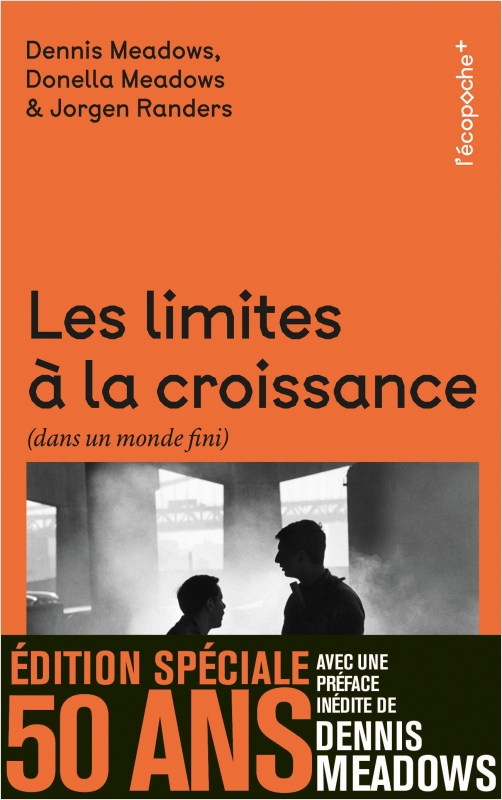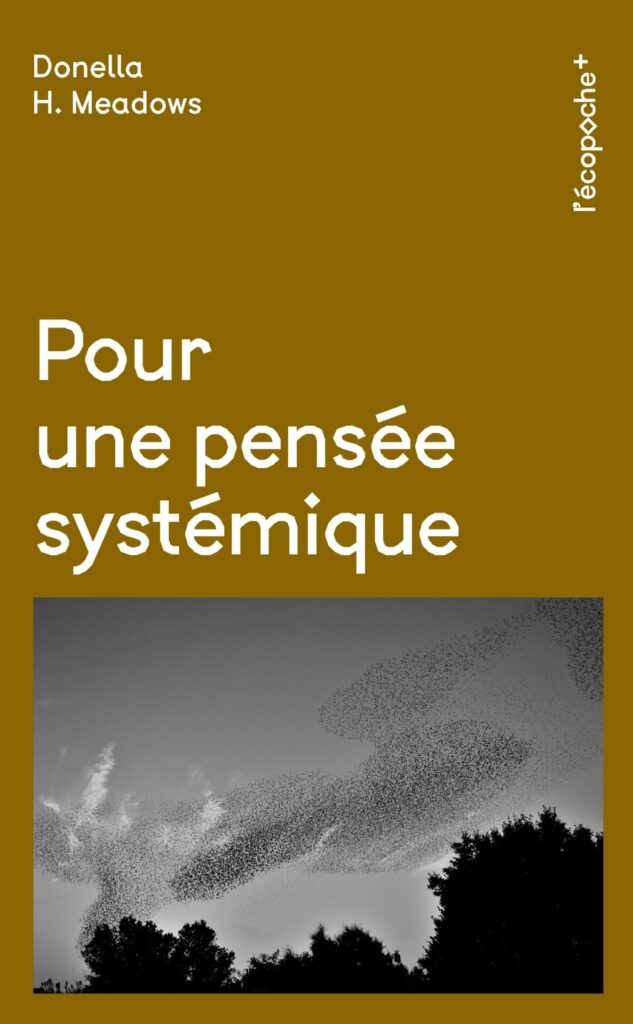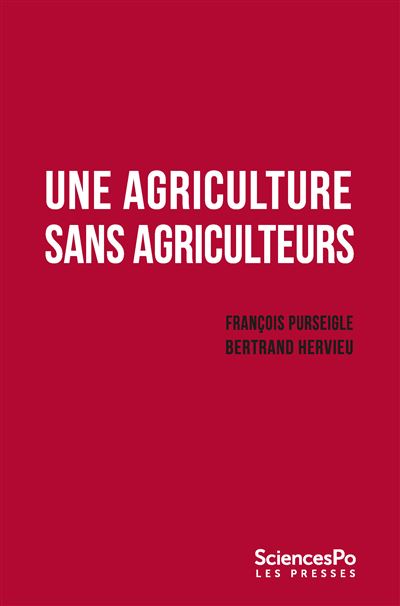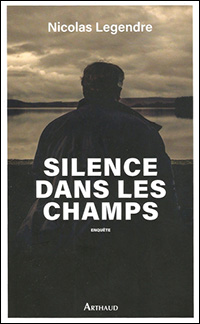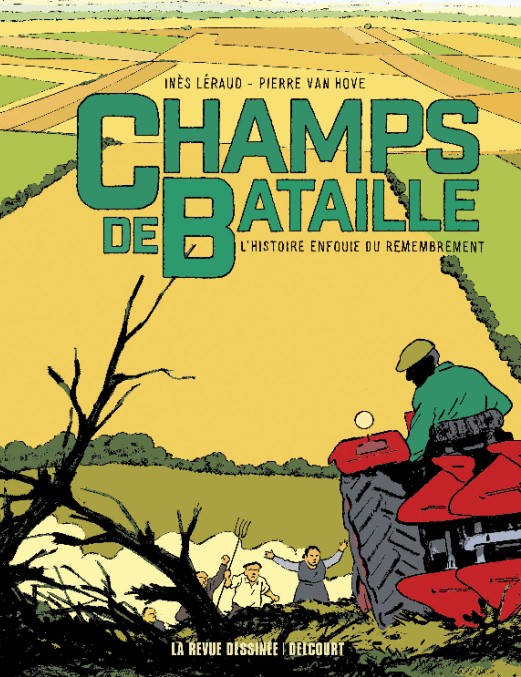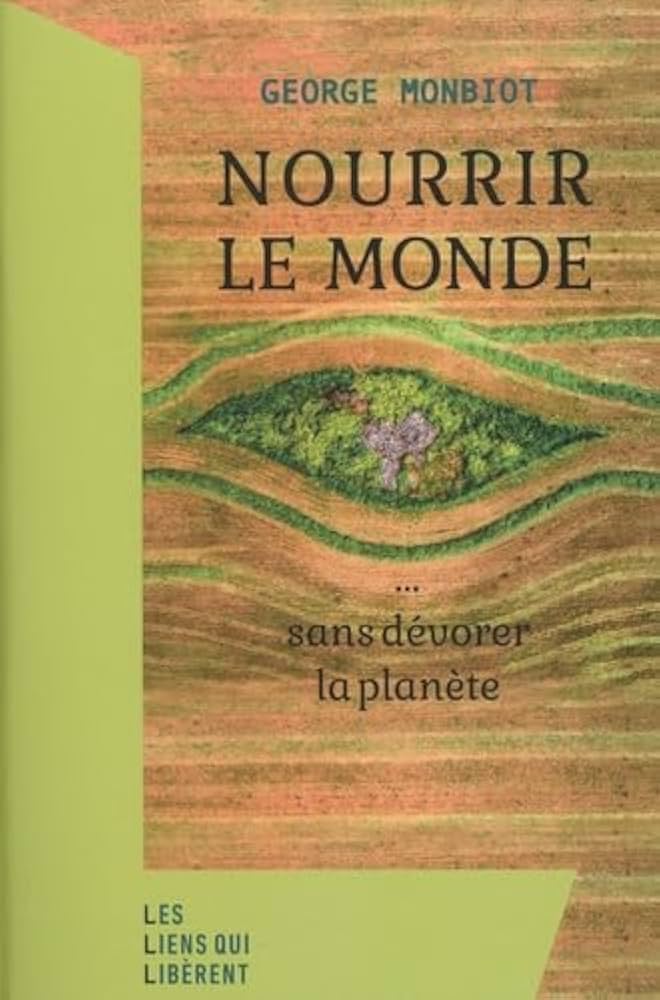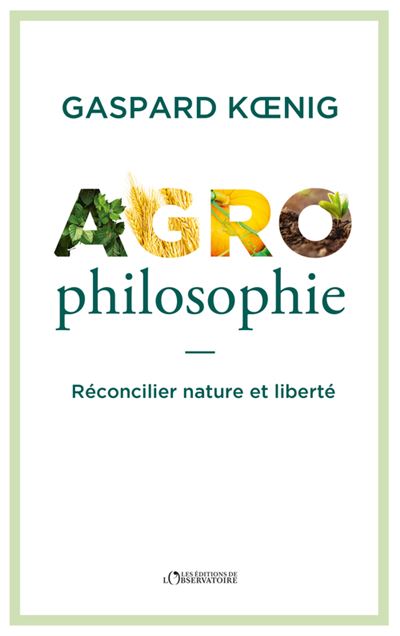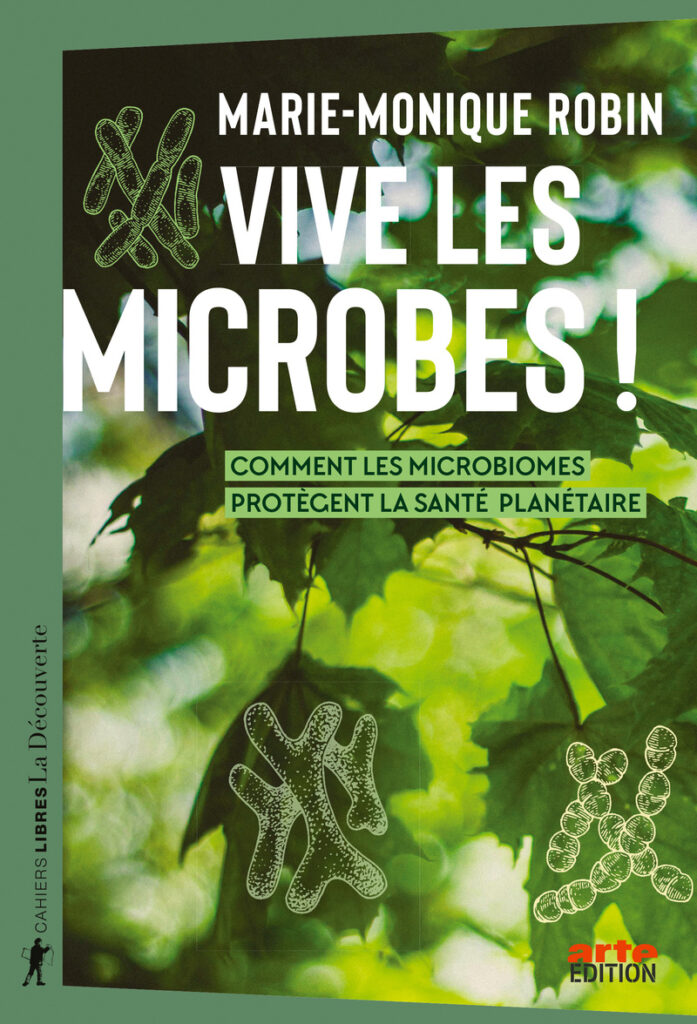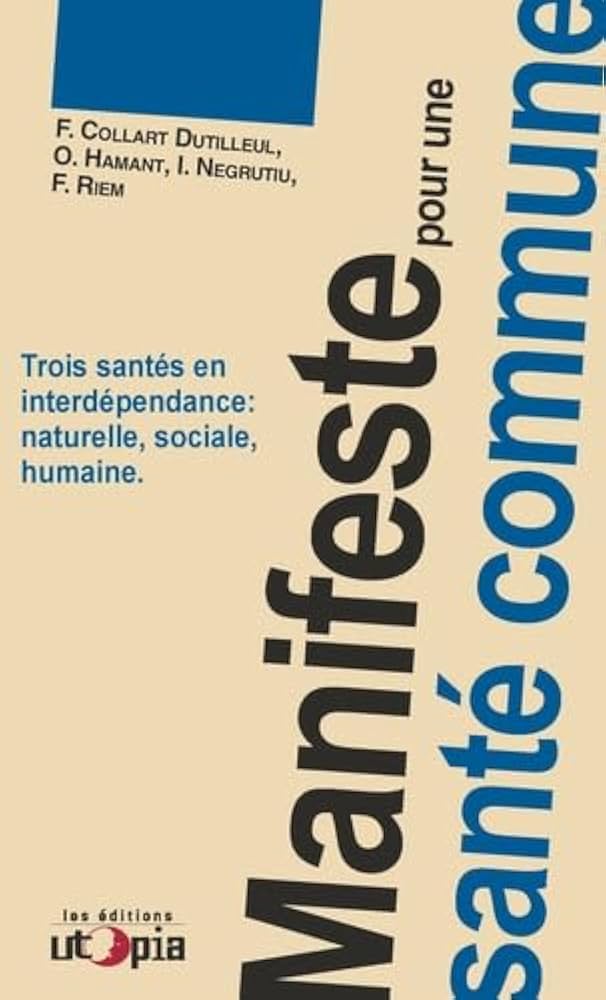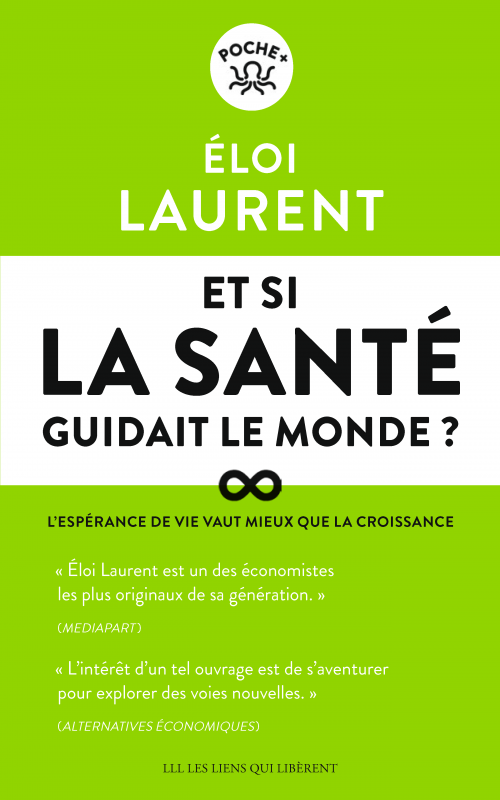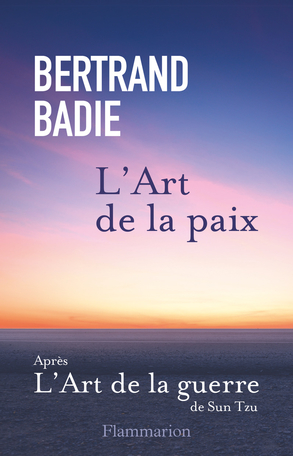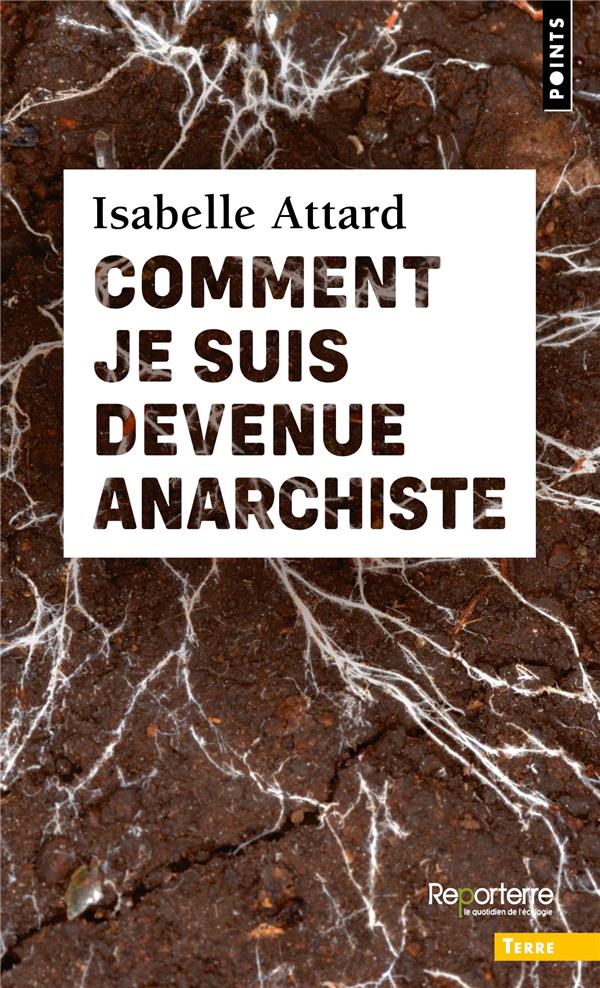Donnella Meadows, Editions rue de l’Echiquier, réédition 2023
Après avoir démarré sa carrière en faisant une thèse de biophysique en 1970, Donnella Meadows a bifurqué pour étudier la théorie des systèmes au MIT. Ce qui l’a conduit en 1972 à être l’autrice principale du rapport au club de Rome « Les limites de la croissance », appelé aussi rapport Meadows. Elle a ensuite enseigné pendant 30 ans l’approche systémique au Dartmouth Collège en s’efforçant d’aider ses étudiants à « maitriser la pensée systémique sans recourir à tout l’arsenal des modélisations informatiques ». C’est cette « distillation » de 30 ans d’enseignement, mais aussi de recherches à la fois théoriques et pratiques (Donella Meadows pratiquait l’agriculture)qui nous est proposé dans « Pour une pensée systémique ».
L’autrice commence par nous donner de manière très pédagogique les éléments de base de la structure et du comportement d’un système, avec, en particulier, les boucles de rétroaction. Elle nous emmène ensuite dans le « zoo des systèmes » : avant de regarder plus globalement des écosystèmes (composés de plusieurs systèmes imbriqués), elle nous fait rencontrer un à un les « animaux systémiques », les systèmes à stock unique, et les systèmes à deux stocks, les systèmes avec délais…
« Pourquoi les systèmes fonctionnent-ils aussi bien ? Réfléchissez aux propriétés des systèmes hautement efficaces – machines, communautés humaines ou écosystèmes – qui vous sont familiers. Vous repèrerez sans doute une de ses trois caractéristiques : la résilience, l’auto-organisation ou la hiérarchie ». La description de ces trois propriétés des systèmes fait l’objet du troisième chapitre.
Connaitre les propriétés des systèmes est loin d’être suffisant pour les maitriser. « La mauvaise nouvelle, ou la bonne selon que vous cherchez à contrôler le monde ou que vous souhaitez vous délecter de ses surprises, est que même si vous connaissez toutes ces caractéristiques des systèmes, vous serez probablement surpris moins souvent, mais vous le serez encore ». Car il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les systèmes nous surprennent : d’abord parce que l’on se concentre souvent sur les évènements sans chercher à comprendre l’histoire du système, ensuite car nous avons « un esprit linéaire dans un monde non linéaire », car là où nous cherchons des limites claires au système, il n’y en souvent pas, parce qu’il existe des facteurs limitants que nous n’avons pas identifiés, qu’il y a des délais que nous avons du mal à appréhender, ou enfin parce que nous sommes des êtres de rationalité limitée.
« Certains systèmes sont plus que surprenants, ils sont pervers ». Le chapitre 5 décrit quelques archétypes, des systèmes assez communs qui sont de nature à créer de gros ennuis, des pièges systémiques, qui, si on sait les corriger deviennent des opportunités. Parmi ces archétypes, il y a la résistance qui fait échouer les solutions proposées par les politiques : la solution contre-intuitive peut être le laisser-faire. Il y a la tragédie des communs que l’on peut combattre par « coercition mutuelle par consentement mutuel », la dérive des performances quand les acteurs croient que les choses sont pires qu’elles ne le sont vraiment, l’escalade, dont l’exemple le plus marquant est la course aux armements, l’exclusion compétitive (le succès va au succès) qui augmente les inégalités et qui doit être combattue par des mécanismes fiscaux ou sociaux d’égalisation, l’addiction qui « consiste à trouver une solution mauvaise et rapide au symptôme du problème, ce qui nous empêche et nous détourne de la tâche plus difficile et plus longue de résoudre le véritable problème », le contournement des règles ou la poursuite du mauvais objectif.
Dans le chapitre 6, Donnella Meadows analyse les différents points de levier qui permettent de « modifier la structure d’un système pour qu’il produise davantage de ce que nous souhaitons et moins de ce qui est indésirable ». Cela la conduit à classifier 12 points de levier par ordre croissant d’efficacité depuis agir sur les simples paramètres du système (« s’exciter sur ces détails revient à réarranger les chaises longues sur le pont du Titanic »), jusqu’à modifier les paradigmes, l’état d’esprit dont découle tout le système, ses objectifs, ses flux d’information ses règles, ses boucles de rétroaction.
Dans le dernier chapitre, l’autrice répond à tous ceux qui, comme elle l’a fait au début de sa carrière, croient qu’avec l’analyse systémique et la puissance de l’ordinateur, ils pourraient trouver la clé de la prédiction et du contrôle. « Nous ne pourrons jamais comprendre entièrement le monde, pas de la manière dont notre science réductionniste nous a conduit à l’espérer ». Il nous faut donc apprendre à « danser avec les systèmes », sentir le rythme du système, rester humble et continuer à apprendre…
L’autrice termine ainsi en résumant « les sagesses systémiques » au cours de sa carrière de modélisatrice et d’enseignante. Un livre, d’une grande clarté pédagogique et illustré par de multiples exemples pris dans tous les compartiments de la vie en société. Essentiel pour qui veut comprendre les ressorts derrière les évènements du monde.